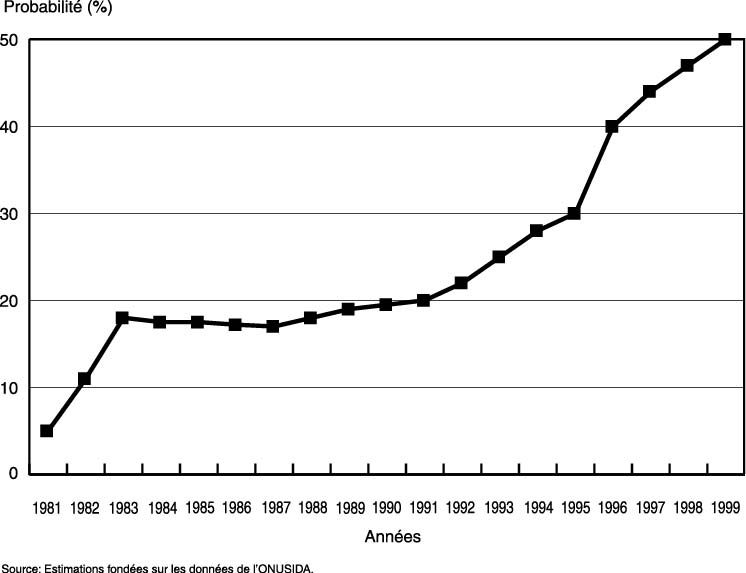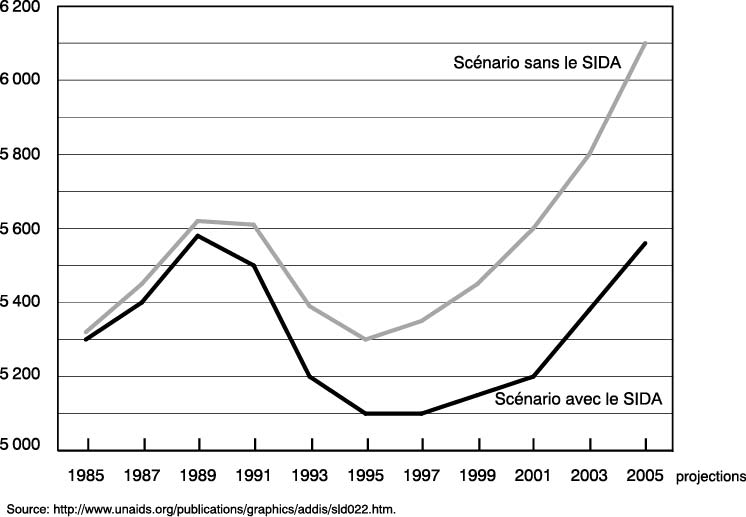89e session, juin 2001 |
Rapport VI |
Sécurité sociale |
Sixième question à l'ordre du jour |
Bureau international du Travail Genève |
ISBN 92-2-211961-4 |
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I. Perspectives de la sécurité sociale
Contexte mondial
Sécurité
sociale et travail décent
Questions
fondamentales
Chapitre II. Sécurité sociale, emploi et développement
Impact social et économique de la sécurité sociale
Dépenses
de sécurité sociale, chômage et croissance
Productivité
et stabilité sociale
Cotisations
des employeurs et compétitivité internationale
Prestations
de chômage, chômage et emploi
Retraite
anticipée
Chapitre III. Extension de la couverture sociale
Droit à
la sécurité sociale
Problème
de l’absence de couverture
Politiques
propres à étendre la couverture sociale
Chapitre IV. Egalité entre hommes et femmes
Normes
internationales du travail et égalité entre hommes et femmes
Lien
entre la protection sociale et l’égalité entre hommes et femmes
Impact
des inégalités du marché du travail sur la protection
sociale
Promotion
de l’égalité dans la protection sociale et par la protection
sociale
Chapitre V. Financement de la sécurité sociale
Evolution
des dépenses de sécurité sociale
Les
trois grands défis
Mondialisation
et financement de la sécurité sociale
Conclusions
Chapitre VI. Renforcement et élargissement du dialogue social
Chapitre VII. Activités futures de l’OIT
Recherche
et analyse des politiques
Activité
normative
Coopération
technique et autres moyens d’action
Points suggérés pour la discussion
En 1999, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a décidé que la sécurité sociale ferait l’objet d’une discussion générale à la session de 2001 de la Conférence internationale du Travail. Cette discussion doit permettre à l’OIT de définir une conception de la sécurité sociale qui, tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux, aidera à relever les défis d’aujourd’hui et de demain. Dans un deuxième temps, cette discussion pourrait conduire à l’élaboration de nouveaux instruments ou à l’actualisation ou révision des normes existantes(1).
Ces vingt dernières années, la Conférence a eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur divers aspects de la sécurité sociale. La dernière fois, en 2000, elle a examiné les prestations de maternité lorsqu’elle a révisé la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, et la recommandation no 95 qui l’accompagne. En 1987 et 1988, c’est aux prestations de chômage qu’elle s’est intéressée durant les discussions qui ont conduit à l’adoption de la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988. En 1987, la convention sur la sécurité sociale des gens de mer a été révisée. Enfin, pour répondre aux besoins particuliers des migrants, la Conférence a adopté en 1982 la convention (nº 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982.
Toutefois, il faut remonter aux années cinquante – avec l’adoption en 1952 de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 – et soixante – avec l’adoption de normes supérieures – pour voir la Conférence traiter de toute la gamme des prestations assurées par la sécurité sociale.
La Conférence a examiné pour la dernière fois l’ensemble de la sécurité sociale à sa 80e session, en 1993, lorsqu’elle a été saisie par le Directeur général d’un rapport intitulé Assurances sociales et protection sociale. La discussion qu’elle a eue à cette occasion a confirmé le sombre tableau brossé dans le rapport au sujet des pays en développement. Elle a fait ressortir que les femmes sont désavantagées en matière de protection sociale et que les politiques d’ajustement structurel ont eu de lourdes conséquences sociales. En ce qui concerne les pays industrialisés, certains délégués ont jugé le rapport trop optimiste: ils ont estimé que la protection sociale se dégrade et que ce sont les catégories les plus vulnérables qui sont le plus souvent victimes de cette dégradation. Les problèmes sociaux des pays en transition ont été soulignés et il a été jugé capital de renforcer la protection sociale dans ces pays afin d’assurer une transformation économique sans heurts et d’asseoir solidement la démocratie. Beaucoup de délégués ont insisté sur le lien entre croissance économique et protection sociale mais de grandes divergences se sont fait jour sur ce point.
Le Conseil d’administration a mentionné un certain nombre de questions clés qui devraient être examinées lors de la discussion générale de 2001: relations entre la sécurité sociale, l’emploi et le développement; extension du champ de la protection sociale; égalité entre hommes et femmes; financement de la sécurité sociale; développement du dialogue social; conséquences pour l’action future de l’OIT(2) . Le présent rapport consacre un chapitre à chacune de ces questions. Il commence par examiner le contexte dans lequel opèrent désormais les régimes de sécurité sociale ainsi que le lien entre sécurité sociale et travail décent.
Perspectives de la sécurité sociale
Dans de nombreuses régions du monde, les régimes de sécurité sociale ont été mis à rude épreuve dans les dernières années du XXe siècle. Ces systèmes sont controversés: certains estiment qu’ils sont trop coûteux et qu’ils nuisent à la croissance et au développement économiques, d’autres mettent en avant l’insuffisance de la protection et du taux de couverture et considèrent que, avec l’aggravation du chômage et de l’insécurité professionnelle, la sécurité sociale est plus nécessaire que jamais. Dans les pays industrialisés en particulier (y compris les pays en transition d’Europe centrale et orientale), les régimes de sécurité sociale doivent relever de nouveaux défis liés à la conjoncture démographique – vieillissement, évolution des structures familiales, etc. – qui ont des retombées importantes sur le financement de la protection sociale. Dans certains pays, l’administration des régimes de sécurité sociale est jugée insatisfaisante et des appels à la réforme sont lancés: il faudrait revoir le rôle de l’Etat et les responsabilités des partenaires sociaux et accroître l’engagement du secteur privé.
L’un des plus grands problèmes en matière de sécurité sociale aujourd’hui est que plus de la moitié de la population mondiale (à savoir, des travailleurs et des personnes à leur charge) n’a accès à aucune forme de protection sociale et ne bénéficie par conséquent ni d’un système de sécurité sociale financé par des cotisations, ni de prestations sociales financées par l’impôt, tandis qu’une proportion non négligeable de ceux qui sont couverts ne sont protégés que contre quelques risques. En Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, on estime que 5 à 10 pour cent seulement de la population active sont couverts par le régime légal de sécurité sociale et que dans certains cas ce taux est même en baisse. En Amérique latine, les taux s’étagent entre 10 et 80 pour cent et ne donnent dans la plupart des cas aucun signe d’évolution. En Asie du Sud-Est et de l’Est, les taux varient entre 10 et près de 100 pour cent et, jusqu’à une date récente, étaient dans de nombreux cas en hausse. Dans la plupart des pays industrialisés, le taux de couverture est proche de 100 pour cent, mais dans un certain nombre de pays, notamment parmi ceux en transition, l’observation des obligations en matière de sécurité sociale a décliné ces dernières années.
Dans ses activités normatives et dans l’essentiel de ses activités de coopération technique dans le domaine de la sécurité sociale, l’OIT est partie du principe qu’une proportion croissante de la population active des pays en développement finirait par trouver un emploi dans le secteur formel de l’économie ou par exercer une activité indépendante en étant au bénéfice de la sécurité sociale. Elle faisait implicitement l’hypothèse que les régions en développement suivraient la même évolution que celle qu’avaient connue les pays industrialisés au cours de leur développement économique et social. L’expérience a toutefois montré, dans les pays en développement – et, plus récemment, dans les pays industrialisés –, que cette proportion stagne, voire diminue dans de nombreux cas. Même dans les pays à forte croissance économique, les travailleurs – souvent les travailleuses – qui occupent des emplois précaires (travail occasionnel, travail à domicile, certains travaux indépendants, par exemple) sont de plus en plus nombreux.
Le développement du travail au noir, non protégé, comporte des risques pour les travailleurs du secteur structuré comme pour ceux du secteur informel de l’économie. Le domaine de la protection sociale illustre l’intérêt direct et très réel des travailleurs pour un emploi «normal» et celui qu’ont leurs organisations à ramener les travailleurs de l’économie informelle sur le marché de l’emploi primaire, organisé. Avec la contraction de l’emploi sur le marché structuré, les travailleurs supportent directement, et de plus en plus, la charge du financement des besoins sociaux, ce qui nuit à leur qualité de vie. Cette charge peut aussi miner la capacité des entreprises de soutenir la concurrence dans l’économie mondiale.
La mondialisation, seule ou conjuguée à l’évolution des techniques, expose souvent les sociétés à une plus grande insécurité du revenu. Les études consacrées aux pays développés semblent indiquer que c’est dans les pays dont l’économie est simultanément très ouverte et exposée à un risque important de fluctuation des prix sur les marchés mondiaux que les transferts de revenus sont le plus importants. Cependant, d’autres observateurs soutiennent que le recul de la sécurité du revenu et de la protection sociale est lié au fait que les gouvernements s’efforcent de promouvoir la compétitivité et d’attirer l’investissement étranger direct. D’aucuns prédisent aussi que la concurrence fiscale entraînera de nouvelles baisses des impôts, notamment sur le rendement du capital, et réduiront l’aptitude des gouvernements à financer la protection sociale.
Les politiques d’ajustement structurel poursuivies dans la plupart des pays en développement ont souvent contribué à réduire le pourcentage déjà faible de la population active qui travaille dans le secteur structuré. Les vagues successives de programmes d’ajustement structurel ont aussi entraîné des baisses de salaire dans le secteur public et le secteur privé, érodant ainsi la base financière des régimes légaux de sécurité sociale. Simultanément, un grand nombre de ces régimes ont pâti de leur gestion déplorable et de leur mauvais fonctionnement, qui ont souvent ébranlé la confiance de leurs adhérents. En outre, les programmes d’ajustement structurel ont souvent donné lieu à des coupes sombres dans les budgets sociaux. Au Bénin, par exemple, la part du budget total consacrée aux dépenses de santé est tombée de 8,8 à 3,3 pour cent entre 1987 et 1992. Comme la plupart des gouvernements ne peuvent plus garantir l’accès à des soins de santé et à un enseignement gratuits, la demande de financement et d’organisation de ces services sociaux aux échelons mondial et local est plus forte.
Dans les pays à faible revenu en particulier, l’ajustement structurel et les transformations socio-économiques ont aussi produit d’importants groupes vulnérables qui ne peuvent cotiser aux régimes de sécurité sociale. Parmi les groupes qui ne font pas partie de la population active, les plus vulnérables sont les handicapés et les personnes âgées qui ne peuvent compter sur le soutien de leur famille et qui n’ont pas pu prendre de dispositions au moment voulu pour s’assurer une pension de retraite. Certains pays, comme la Chine et l’Inde, ont pris des mesures d’aide sociale spécifiques pour répondre aux besoins de ces groupes.
Aujourd’hui, le monde affronte également un grand nombre
de crises complexes qui ont souvent des répercussions d’ampleur mondiale.
La crise financière asiatique, qui a entraîné des suppressions
d’emplois massives dans le secteur formel de l’économie, en a été
l’un des exemples récents les plus notoires. Il y a eu également
de nombreux conflits armés ces dernières années, en particulier
en Afrique subsaharienne (Angola, Congo, Libéria et Rwanda, par exemple),
mais aussi en Europe (Bosnie, Kosovo). Beaucoup de pays restent affligés
par des catastrophes sanitaires, comme la pandémie du VIH/SIDA, qui laisse
orphelins un grand nombre d’enfants (voir encadré). Les catastrophes
naturelles, comme les sécheresses et les inondations périodiques
(en Afrique et en Asie), les séismes et les ouragans (en Turquie et en
Amérique centrale, par exemple), ont non seulement privé de foyers
et de sources de revenus de nombreuses communautés, mais aussi annihilé
des années d’efforts de développement de leurs pays. Enfin, certains
pays éprouvent des difficultés à effectuer leur transition
économique ou politique et à passer d’une économie centralement
planifiée à une économie de marché ou d’un régime
politique restrictif (comme le régime d’apartheid) à une société
multiraciale et démocratique. La transition dans les pays d’Europe centrale
et orientale a entraîné un chômage sans précédent
qui persiste dans certains cas. Dans ces pays et dans l’ex-URSS, la responsabilité
de la sécurité du revenu et de certains services sociaux, autrefois
assumée par les entreprises dans le contexte de la planification économique
centralisée, est maintenant assumée par des régimes souvent
déficients et inadéquats, et de nombreux travailleurs risquent
de voir leurs prestations réduites ou de ne plus bénéficier
d’aucune protection. En Afrique du Sud, la transition pacifique d’un régime
politique d’apartheid à un régime démocratique et inclusif
en Afrique du Sud n’a pas eu pour effet d’assurer à la majorité
de la population un travail décent, un revenu suffisant et une meilleure
situation économique.
Le défi du VIH/SIDA pour la sécurité sociale La plus lourde hypothèque qui pèse sur la sécurité sociale dans certains pays, notamment en Afrique, est celle de la pandémie du VIH/SIDA. Ses conséquences sur le plan humain deviennent par trop évidentes, mais on n’en saisit pas encore parfaitement les retombées sur les systèmes de sécurité sociale. La pandémie a mis en évidence l’inadéquation criante des systèmes de protection sociale dans les pays les plus touchés. Nombreux sont ceux, parmi les personnes qui ont contracté la maladie, qui ne sont affiliés à aucun régime de sécurité sociale et qui, par conséquent, n’ont pas accès aux soins médicaux de qualité dont ils ont besoin. S’ils sont soutiens de famille, les personnes à leur charge ne reçoivent pas non plus de revenus de remplacement lorsqu’ils ne peuvent plus travailler ou lorsqu’ils décèdent. La figure 1.1. montre à quel point la situation est dramatique dans de nombreux pays d’Afrique. Dans un pays comme le Zimbabwe, un garçon de 15 ans n’a plus aujourd’hui que 50 pour cent de chances d’atteindre l’âge de 50 ans. Le chiffre équivalent pour les femmes n’est pas connu, mais il ne doit pas être très différent. Cela signifie implicitement qu’un nombre considérable de familles perdront leur soutien de famille appartenant aux classes d’âge de forte activité avant que l’on puisse juguler la pandémie. Les mécanismes informels de protection sociale (famille élargie, collectivité locale) sont étirés bien au-delà du point de rupture du fait qu’un nombre considérable de soutiens de famille sont frappés dans la fleur de l’âge. Il n’est jamais apparu aussi clairement que la sécurité sociale et la mise en commun des risques doivent être organisées sur la base la plus large possible: cela est crucial pour que toute l’aide nécessaire soit canalisée vers les familles, les groupes, les collectivités et les régions les plus directement touchés. Il est urgent que la communauté internationale se montre solidaire et soutienne les efforts déployés au niveau national – et en particulier qu’elle appuie les campagnes de prévention et aide à assurer l’offre de soins de santé. Il faut établir des partenariats entre les autorités sanitaires compétentes, les organisations gouvernementales et non gouvernementales et l’industrie pharmaceutique afin d’assurer aux patients appartenant à certaines communautés la fourniture de médicaments qui, s’ils étaient facturés aux tarifs internationaux en vigueur, seraient totalement hors de leur portée. Au niveau local, les régimes de sécurité sociale, les prestataires de soins de santé et les services sociaux doivent coordonner leurs efforts pour que les malades du SIDA reçoivent les soins dont ils ont besoin dans le cadre le plus approprié. Les finances des régimes de sécurité sociale sont affectées de diverses manières par la pandémie. D’une manière générale, leur base de ressources s’amenuise avec la contraction générale que la pandémie du SIDA inflige à l’économie nationale. La figure 1.2 montre l’effet estimatif du SIDA sur le PIB du Kenya. Figure 1.1. Probabilité qu’un garçon de 15 ans décède avant l’âge de 50 ans au Zimbabwe
Dans les pays industrialisés, l’incidence financière du VIH/SIDA est beaucoup moins sévère: aux Etats-Unis, par exemple, les dépenses pour les soins aux porteurs du VIH et aux malades du SIDA représentent moins de 1 pour cent des dépenses au titre des soins de santé par personne, et le coût moyen des soins par personne est moins élevé que celui du traitement de beaucoup d’autres maladies invalidantes. Toutefois, l’incidence financière de la maladie sur les individus est souvent dramatique, surtout s’ils ne bénéficient pas d’une bonne assurance maladie. Aux Etats-Unis, 32 pour cent seulement des personnes séropositives bénéficient d’une assurance maladie privée (contre 71 pour cent des Américains); près de 50 pour cent des séropositifs sont tributaires de Medicaid (assurance maladie pour les plus démunis) ou de Medicare (assurance maladie pour les plus de 65 ans) et environ 20 pour cent d’entre eux ne sont pas assurés. Même en ce qui concerne les personnes qui disposent de ressources, le coût des soins en cas de VIH/SIDA (environ 20 000 dollars E.-U. par an et par patient) peut épuiser rapidement leurs avoirs et les laisser appauvries1. Dans la plupart des autres pays industrialisés, le système de soins de santé relevant de la sécurité sociale ou le service national de santé protège les individus contre ce risque. Figure 1.2. Evolution du PIB par habitant au Kenya (en monnaie locale) sous l’effet du SIDA (projections)
Dans un grand nombre de pays, les régimes de sécurité sociale cesseront ou ont déjà cessé de recevoir les cotisations des travailleurs qui ne peuvent plus travailler. Selon la couverture qu’offre le régime, ils doivent financer des dépenses considérablement plus élevées pour les soins médicaux, des prestations de maladie en espèces, des pensions d’invalidité et, en dernier lieu, des pensions de survivants. La mortalité prématurée, par ailleurs, tend à réduire les dépenses au titre des pensions de vieillesse, mais ces économies ne seront sensibles que beaucoup plus tard. Il convient d’entreprendre des travaux de recherche pour obtenir les données qui sont indispensables pour faire des projections valables et pouvoir ainsi assurer l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale à long terme. Dans le cadre de son action contre le VIH/SIDA, l’OIT s’engage dans un projet qui vise à évaluer l’incidence du SIDA sur la viabilité financière des régimes de sécurité sociale et sur les budgets nationaux2. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont un rôle très important à jouer dans la lutte contre la pandémie. Le lieu de travail est un cadre dans lequel les activités de prévention peuvent être menées avec un grand succès. Un investissement dans ces activités est tout à fait payant car il permet de conserver une main-d’œuvre en bonne santé et expérimentée et de limiter le coût pour les employeurs des soins médicaux, des indemnités de maladie et des régimes de pension. Les entreprises peuvent maximiser les avantages de leurs activités de prévention en y associant non seulement leurs salariés, mais aussi leurs clients et la communauté à laquelle ils appartiennent. 1 Kaiser Family Foundation: «Financing HIV/AIDS care: A quilt with many holes», Capitol Hill Briefing Series on HIV/AIDS, oct. 2000 (http://www.kff.org/content/2000/1607/). 2 BIT: ILO action against HIV/AIDS: A draft framework for global and regional initiatives, document de synthèse sur le VIH/SIDA et le monde du travail (Genève). Voir aussi BIT: HIV/AIDS in Africa: The impact on the world of work, étude préparée en vue du Forum 2000 sur le développement de l’Afrique, Addis-Abeba, Ethiopie, 3-7 déc. 2000, et VIH/SIDA: Une menace pour le travail décent, la productivité et le développement, document soumis pour discussion à la Réunion spéciale de haut niveau sur le VIH/SIDA et le monde du travail, Genève, 8 juin 2000. Ces rapports, ainsi que d’autres informations sur le Programme de l’OIT sur le VIH/SIDA dans le monde du travail, sont accessibles sur le site Internet du BIT (http://www.ilo.org/aids). |
Sécurité sociale et travail décent
Chacun aspire à vivre décemment, en sécurité, et à pouvoir s’exprimer et s’organiser librement. Cette sécurité du revenu est accessible non seulement par le biais d’un emploi productif, de l’épargne et d’actifs accumulés (terrain, logement, par exemple), mais aussi par le biais des mécanismes de protection sociale. Ces mécanismes fonctionnent non seulement comme un facteur de protection, mais aussi comme un facteur productif. Les travailleurs ont besoin d’un revenu minimum garanti pour faire des projets à long terme pour eux-mêmes et pour leur famille. La sécurité du revenu des travailleurs est également bonne pour l’économie, car elle rend la demande réelle plus prévisible et fournit aux entreprises une main-d’œuvre plus productive et plus flexible.
L’objectif de la plupart des régimes de sécurité sociale est d’assurer l’accès à des soins de santé et la sécurité du revenu, c’est-à-dire un revenu minimum à ceux qui sont dans le besoin et un revenu de remplacement raisonnable à ceux qui ont cotisé proportionnellement à leurs revenus. La recommandation (nº 67) sur la garantie des moyens d’existence, 1944, par exemple, met l’accent sur les régimes de sécurité sociale nationaux obligatoires qui, en principe, protègent également les travailleurs indépendants, et prévoit une aide sociale. Dans la pratique, cependant, il est très difficile de mettre en œuvre ce concept dans le cas de travailleurs qui, comme un grand nombre de travailleurs indépendants, ont des revenus irréguliers, pour lesquels la notion de gains elle-même est difficile à mesurer et qui ont en général des besoins et des priorités différents en matière de sécurité sociale. L’apparition de nouveaux régimes contributifs pour les travailleurs du secteur informel a souligné la nécessité d’une conception plus large de la sécurité sociale incluant, par exemple, des allocations-logement, des allocations alimentaires et des allocations pour frais d’études, en plus des éventualités prévues dans la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (soins médicaux et allocations familiales, prestations en cas de maladie, indemnités de chômage, prestations de vieillesse, prestations pour lésion ou maladie professionnelle, allocations de maternité, prestations d’invalidité et allocations de veuvage).
Plusieurs auteurs et institutions, surtout ceux qui connaissent les pays en développement, ont plaidé en faveur d’une définition plus large de la sécurité sociale. Certains affirment que, dans le cadre d’une stratégie novatrice de lutte contre la pauvreté, la sécurité sociale devrait comprendre des mesures visant à assurer, par exemple, l’accès aux moyens de production, la garantie de l’emploi, un salaire minimum et la sécurité alimentaire. D’autres distinguent deux aspects de la sécurité sociale, définis comme le recours à des moyens sociaux pour prévenir les privations (promouvoir le niveau de vie) et la vulnérabilité aux privations (protéger contre une baisse du niveau de vie). Un grand nombre d’organisations internationales, dont l’OIT, retiennent aussi le concept plus large de «protection sociale» qui recouvre non seulement la sécurité sociale, mais aussi les régimes non obligatoires; l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) inclut dans ses chiffres concernant la protection sociale certains services sociaux, comme les services de crèche et l’aide à domicile.
Le concept de travail décent et l’objectif qu’il vise correspondent à cette conception plus large de la sécurité sociale. Dans son premier rapport à la Conférence internationale du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail, M. Juan Somavia, a introduit la stratégie d’«un travail décent pour tous», qui fixait comme but fondamental à l’OIT «que chaque femme et chaque homme puissent accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité»(3). La stratégie du travail décent adopte une perspective large du travail qui inclut non seulement l’emploi (rémunéré), mais aussi l’emploi à domicile afin de tenir compte des rôles différents des hommes et des femmes. Une protection sociale décente peut donc jouer un rôle important en contribuant à l’égalité entre hommes et femmes (voir chap. IV), si tous – les travailleurs et les travailleuses (rémunérés ou non), les enfants et les personnes âgées – ont accès indépendamment à la protection sociale.
L’une des principales caractéristiques de l’approche du travail décent est que chacun a droit à une protection sociale de base. Le droit à la sécurité sociale pour tous est déjà inscrit dans l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Une stratégie visant à assurer un travail décent est donc axée vers une protection universelle (voir également le chapitre III), qui est maintenant l’objectif officiel du Secteur de la protection sociale (accroître l’étendue et l’efficacité de la protection sociale pour tous). Comme indiqué plus haut, cet objectif est loin d’être réalisé.
Il apparaît à l’évidence que les sociétés ne peuvent pas toutes s’offrir le même niveau de sécurité sociale. Pourtant, il est partout inhumain de vivre et de travailler dans une insécurité permanente, qui menace la sécurité matérielle et la santé des individus ou des familles. Un monde qui est essentiellement riche peut offrir un minimum de sécurité à tous ses habitants. Ce minimum peut comprendre, dans les pays les plus pauvres, des services de santé et une alimentation de base, des droits au logement et à l’éducation et, dans les pays industrialisés, des régimes de sécurité sociale plus élaborés. Toute personne en âge de travailler a la responsabilité de contribuer au progrès économique et social de la communauté ou du pays dans lequel il vit et doit avoir la possibilité de le faire. En échange, chacun a droit à sa juste part des revenus et des richesses du pays ou de la communauté.
Dans un monde où les marchés sont de plus en plus intégrés, où les populations sont de plus en plus exposées à des risques économiques globaux, on prend de plus en plus conscience qu’une politique de protection sociale nationale à large assise peut amortir un grand nombre des effets sociaux négatifs des crises. Cependant, une telle politique doit être complétée par de nouveaux mécanismes de financement internationaux (voir chap. V), comme cela a été proposé récemment à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies à Genève consacrée au suivi du Sommet social. Ces propositions ont trait, entre autres, à l’éventuelle création d’un fonds (volontaire) mondial de solidarité, à la coopération internationale en matière fiscale, à l’allégement de la dette, au respect des engagements pris en matière d’aide au développement et à l’octroi d’un financement à des conditions plus libérales.
Compte tenu des profonds changements survenus à l’échelle mondiale qui affectent la sécurité sociale et des principaux éléments d’une approche visant à assurer un travail décent, le présent rapport examinera les grandes questions suivantes.
Sécurité sociale, emploi et développement
Le chapitre II fera le bilan des différents arguments relatifs aux effets économiques et sociaux de la sécurité sociale. Il semble que le débat actuel soit surtout centré sur ceux de ses effets qui sont perçus comme négatifs, mais ce chapitre mettra aussi en relief différents effets positifs, puis évaluera dans quelles conditions les différents arguments sont valides. Il examinera le rôle des régimes d’assurance chômage, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire, puis analysera les éventuels avantages des systèmes de garantie limitée de l’emploi qui pourraient assurer un emploi temporaire aux travailleurs sous-employés, surtout dans les pays en développement les plus pauvres. Enfin, ce chapitre examinera les différentes manières dont la politique de l’emploi et la politique en matière de sécurité sociale peuvent se renforcer l’une l’autre et dont ces synergies dépendent de la situation économique et sociale qui prévaut dans chaque pays.
Extension de la couverture sociale
Le chapitre III évoquera quatre manières principales d’étendre la protection sociale, c’est-à-dire d’étendre l’assurance sociale obligatoire, de promouvoir la microassurance, de concevoir des systèmes universels et d’assurer des prestations soumises à des conditions de ressources. Dans les pays industrialisés, les régimes officiels de sécurité sociale sont bien établis, mais une action résolue est nécessaire dans plusieurs pays pour empêcher que la couverture actuelle de ces régimes ne soit amenuisée par le développement du travail informel. Dans la plupart des pays à revenu intermédiaire, il est peut-être possible d’étendre le bénéfice du régime de sécurité sociale officiel à de nouveaux groupes jusqu’ici non protégés. Cependant, dans les pays à revenu intermédiaire et surtout dans les pays à faible revenu, il est peut-être aussi nécessaire de promouvoir les régimes de microassurance afin de couvrir certains groupes qui évoluent dans l’économie parallèle et qui ont une certaine capacité contributive. Des prestations et des services universels et subordonnés au niveau des ressources sont d’autres manières d’assurer à la population le bénéfice de la sécurité sociale. Lorsque les ressources nationales sont insuffisantes pour financer de telles prestations, comme c’est souvent le cas dans les pays à faible revenu, des ressources internationales sont parfois fournies, en particulier en temps de crise. En général, une approche intégrée est nécessaire au niveau national afin de relier les divers mécanismes et les mesures prises dans différents domaines et d’éviter le danger d’un système à deux vitesses, d’un côté pour ceux qui font partie du système national et de l’autre pour ceux qui en sont exclus.
Egalité entre hommes et femmes
Le chapitre IV examinera les différentes façons dont la sécurité sociale peut contribuer à l’égalité entre les sexes. La plupart des systèmes de sécurité sociale étaient à l’origine structurés de façon à répondre aux besoins des familles ayant un apporteur de revenu de sexe masculin. Vu l’évolution des styles de vie, des attentes et des structures familiales, une grande partie de la population ne vit pas dans une famille de ce type, ce qui a renforcé l’exigence de l’égalité entre les sexes. Une partie du défi que la sécurité sociale doit relever consiste à s’adapter à ces changements en garantissant l’égalité de traitement entre hommes et femmes et, en même temps, à introduire progressivement des mesures d’égalisation des chances, touchant par exemple l’âge ouvrant droit à pension et les pensions de réversion. Un autre défi consiste à utiliser la protection sociale, par exemple les services de crèche et les prestations sociales pour les parents et les enfants, pour assurer une plus grande égalité entre les sexes et un partage plus équitable des responsabilités au travail et au foyer.
Financement durable de la protection sociale
Le chapitre V laisse supposer que l’élargissement de la protection sociale imposera un financement national amélioré et de nouvelles formes de financement aux niveaux local et mondial. Au niveau national, on peut rendre plus efficace le financement en améliorant la collecte des cotisations de sécurité sociale et le recouvrement de l’impôt. Le système de financement par répartition serait probablement le plus approprié pour les prestations à court terme comme les prestations d’assurance maladie et de maternité. Dans le cas des pensions de vieillesse, il est démontré que le financement par répartition et le préfinancement sont deux systèmes à la merci de l’évolution démographique. Au niveau local, on pourrait mettre des ressources à la disposition des administrations locales et exploiter la capacité contributive des travailleurs de l’économie informelle à des systèmes de microassurance. La viabilité financière de ces régimes peut être renforcée par divers mécanismes, comme la mutualisation, la réassurance et une forme ou une autre d’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale. Au niveau mondial, on pourrait trouver de nouvelles sources de financement d’une protection sociale de base pour tous et prendre des mesures pour faire face aux conséquences des crises.
Ainsi qu’il est démontré dans le chapitre VI, les perspectives d’une protection sociale décente pour tous peuvent être améliorées en élargissant le partenariat sous-jacent de la protection sociale et en galvanisant les acteurs sociaux. Ce chapitre examine le rôle des différents acteurs dans la protection sociale et suggère des manières de former entre eux des partenariats afin de renforcer l’efficacité de la sécurité sociale et d’étendre la protection sociale par le biais des régimes légaux de sécurité sociale, des systèmes de microassurance et des prestations sociales fondées sur l’impôt. Le chapitre VI conclut en indiquant succinctement comment il est possible d’élargir le dialogue social aux niveaux national et international.
Le présent rapport a pour but de soulever un certain nombre de questions importantes touchant l’avenir de la sécurité sociale dans un contexte mondial qui a fondamentalement changé. Il n’a pas pour ambition de proposer des réponses définitives mais plutôt de promouvoir un consensus sur l’évaluation de la situation et sur les manières d’aller de l’avant. Le chapitre VII fournit des repères concernant les conséquences qui peuvent en découler pour l’OIT sur le plan des activités de recherche, des normes, des services et des activités de sensibilisation.
Sécurité sociale, emploi et développement
Les effets sociaux et économiques de la sécurité sociale sont très controversés, le débat portant avant tout sur les effets négatifs qu’elle est censée avoir: la sécurité sociale découragerait les gens de travailler et de faire des économies, nuirait à la compétitivité au niveau international et à la création d’emplois et encouragerait les gens à quitter prématurément le marché du travail. Mais la sécurité sociale a également un certain nombre d’effets économiques très positifs. Elle peut renforcer la capacité des gens de gagner un revenu et d’augmenter leur potentiel de productivité; elle peut soutenir la demande effective au niveau national et favoriser des conditions propices à l’économie de marché, notamment en encourageant les travailleurs à accepter innovation et changement. Comme il est indiqué au chapitre I, protection sociale et emploi décent sont deux conditions essentielles pour qu’une économie de marché assure la sécurité du revenu de tous. La protection sociale est également censée avoir d’importants effets positifs sur la société dans son ensemble, en favorisant la cohésion sociale et en suscitant un sentiment général de sécurité parmi ses membres. Dans la première section du présent chapitre, nous ferons le point des différents arguments en présence et chercherons à en évaluer la pertinence.
Le chômage est l’un des plus grands risques sociaux auxquels sont exposées les personnes dont la subsistance dépend de la force de travail. Or l’assurance chômage n’existe que dans une minorité de pays et de nombreux travailleurs – c’est le cas de presque tous les travailleurs indépendants – ne sont pas couverts. La protection contre le risque de chômage est assurée non seulement par des allocations mais aussi par des mesures de protection (contre le licenciement, par exemple) et de promotion de l’emploi(4). La deuxième section donne un bref aperçu de la protection sociale contre le chômage et de son interaction avec les politiques de l’emploi et du marché du travail.
La troisième section récapitule les principales conclusions et met en lumière la nécessité de resserrer les liens entre les politiques visant le développement, l’emploi et une protection sociale décente.
Impact social et économique de la sécurité sociale
La protection sociale influe sur l’activité économique en agissant sur le comportement des individus (en tant que travailleurs ou candidats à l’emploi, épargnants, investisseurs et membres de la société civile), sur les décisions de l’entreprise et sur le fonctionnement des marchés (notamment dans la détermination des salaires et des prix). Voyons quelques-uns des mécanismes qu’elle peut faire jouer.
La protection sociale a une incidence sur le taux d’activité de la population. Elle peut inciter les gens à se retirer de la vie active, quand ils peuvent prendre une retraite anticipée, par exemple, ou à exercer au contraire un emploi, compte tenu de la pension et des autres prestations auxquelles ils pourront prétendre. La protection sociale peut aussi avoir une incidence sur l’emploi. L’indemnisation retarde-t-elle la recherche d’un nouvel emploi en cas de chômage? Permet-elle au contraire une meilleure réinsertion dans l’emploi, une meilleure adéquation entre travailleurs et emplois? Le problème est aussi celui de l’effet de la protection sociale sur le travail fourni. Entraîne-t-elle une diminution du nombre d’heures effectuées, en encourageant l’absentéisme, ou cet effet est-il compensé par le fait qu’elle favorise un rétablissement rapide et évite la contagion parmi le personnel? Concourt-elle avec d’autres dispositions, à accroître la productivité des travailleurs? Ce sont des questions auxquelles il n’est pas facile de répondre, notamment parce qu’il faut pouvoir isoler l’impact de la protection sociale de celui des autres facteurs. De plus, même si l’on considère ici l’incidence de la protection sociale sur la productivité des travailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la raison d’être de la protection sociale réside essentiellement dans l’influence qu’elle peut avoir sur le bien-être des travailleurs.
En ce qui concerne le marché des capitaux, l’existence de régimes publics de pensions entraînerait, selon certains économistes, une baisse de l’épargne individuelle. C’est une question complexe sur laquelle – comme il est indiqué au chapitre V – les études empiriques n’apportent pas d’arguments probants.
Dépenses de sécurité sociale, chômage et croissance
La question de l’impact économique de la protection sociale se pose d’abord pour l’emploi (le chômage) et divers objectifs économiques, dont la productivité. La figure 2.1 indique le taux de chômage et la productivité (niveau et accroissement) dans une série de pays rangés de gauche à droite selon l’importance des dépenses de sécurité sociale (par rapport au produit intérieur brut). Il faut prendre soin de fonder l’analyse sur des données portant sur une longue période. Cela a son importance car une analyse similaire effectuée sur une période plus courte pourrait donner une image déformée de la réalité, particulièrement pour les années quatre-vingt-dix où les pays de l’Union européenne (dont les dépenses de sécurité sociale sont élevées) ont appliqué – au détriment de l’emploi – une politique macroéconomique restrictive conformément aux impératifs de l’union monétaire.
Dans la partie gauche du graphique figurent les pays où les dépenses de sécurité sociale sont basses, comme l’Australie, le Japon et les Etats-Unis, à droite ceux où elles sont élevées, comme la Belgique et les Pays-Bas. Il n’y a pas de lien apparent entre les dépenses et les variables économiques en question. Si l’on considère le premier graphique, on relève de faibles taux de chômage dans certains pays situés à gauche, comme le Japon et les Etats-Unis, et aussi dans les pays situés à droite, comme l’Autriche et la Suède, mais c’est dans les pays qui se rangent au centre, l’Irlande et l’Espagne, que les taux sont les plus élevés.
La production nationale est fonction de l’emploi mais aussi de la productivité. Le deuxième graphique de la figure 2.1 indique le produit intérieur brut par heure de travail (cette mesure ne rend pas compte des divers facteurs qui peuvent intervenir). On observe, entre les pays, des différences de nature complexe. On voit par exemple que la productivité, ainsi mesurée, est aux Etats-Unis deux fois plus forte qu’au Portugal, tout en étant plus basse que dans d’autres pays d’Europe. Et les pays où les dépenses de sécurité sociale sont les plus élevées font aussi bien ou mieux que les Etats-Unis.
Le niveau actuel de la productivité est le résultat d’une progression passée plus ou moins rapide. Le troisième graphique de la figure 2.1 indique le taux annuel d’accroissement de la productivité du travail (mesurée par le PIB par heure de travail), de 1976 (après le premier choc pétrolier) à 1992. Fort au Japon, l’accroissement l’a été aussi en Irlande, en Italie et dans d’autres pays d’Europe. S’il a été faible en Suède(5), il l’a aussi été aux Etats-Unis, dans la partie gauche.
Communément utilisés dans les analyses économiques, ces indicateurs d’emplois et de productivité ne disent pas tout, on le sait bien. Ils portent sur la production marchande et ils laissent de côté d’autres éléments importants (la production non marchande, la qualité de la vie de travail, la sauvegarde de l’environnement) qui concourent à améliorer le bien-être humain, objectif ultime. De ce point de vue, la sécurité apparaît comme un bien que les citoyens recherchent mais que le marché n’est souvent guère apte à leur fournir efficacement pour des raisons diverses (problèmes d’économie d’échelle, de sélection adverse, de coûts de transaction). Cela expliquerait la relative stabilité des régimes de sécurité sociale, ces régimes que depuis trente ans on dit en crise.
Figure 2.1. Pays de l’OCDE: dépenses de sécurité sociale, chômage et productivité (les pays sont rangés de gauche à droite selon l’importance, croissante, des dépenses de sécurité sociale en pourcentage du PIB)
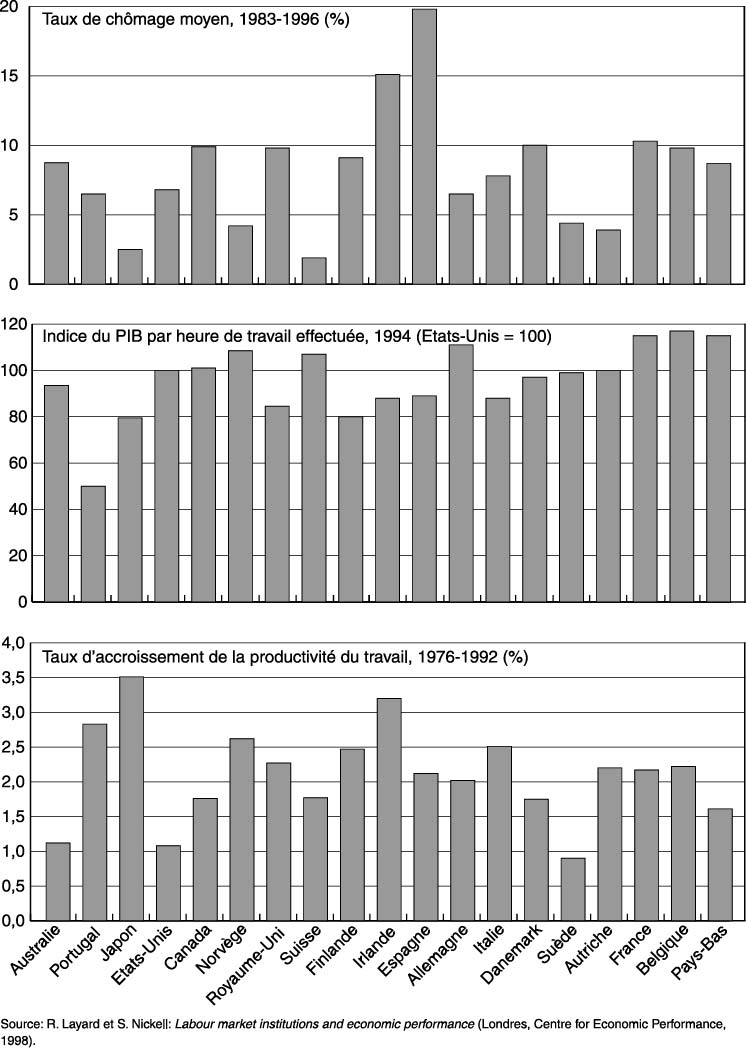
Productivité et stabilité sociale
De l’avis de divers observateurs, la sécurité sociale contribue à la croissance économique en relevant la productivité du travail et en renforçant la stabilité sociale. Divers types de sécurité sociale influent tout particulièrement sur la productivité du travail:
- Les systèmes de soins de santé permettent de maintenir les travailleurs en bonne santé et de soigner ceux qui tombent malades. Une santé médiocre est l’une des causes principales du faible niveau de la productivité dans de nombreux pays en développement où les travailleurs n’ont pas accès à des soins de santé appropriés. Ces travailleurs sont non seulement moins aptes à faire face aux exigences physiques que leur impose l’emploi mais ils sont aussi amenés à s’absenter pour raisons de santé et, même s’ils ne s’absentent pas, leur rendement peut s’en trouver fortement diminué. Les soins dispensés aux membres de la famille du travailleur contribuent à la bonne santé de la main-d’œuvre de demain.
- Les régimes de pension permettent aux travailleurs âgés de quitter plus facilement la vie active, ce qui résout le problème posé par les travailleurs poursuivant leurs activités alors que leur productivité est tombée à un faible niveau.
- Les indemnités de maladie en espèces contribuent au rétablissement des travailleurs malades en supprimant la pression financière qui les contraindrait à poursuivre le travail malgré leur état de santé. Ce système permet également de maintenir le taux de productivité des autres travailleurs en évitant la contagion.
- L’assurance maternité protège la santé des travailleuses et de leurs enfants.
- Les régimes d’assurance contre les accidents du travail – forme la plus ancienne et la plus répandue de sécurité sociale – jouent un rôle de plus en plus important dans la prévention des accidents liés au travail et des maladies professionnelles et dans le rétablissement des travailleurs qui en sont victimes. Ces régimes présentent un intérêt particulier au regard de la productivité, étant donné le nombre considérable de jours d’arrêt imputables à des risques évitables.
- Les prestations de chômage offrent aux sans-emploi le répit dont ils ont besoin pour trouver un travail convenable correspondant le mieux à leurs compétences et à leur potentiel; les services connexes d’emploi et de formation sont aussi extrêmement importants à cet égard.
- Les allocations pour enfant à charge (et autres prestations en espèces fournies quand le soutien de famille est dans l’incapacité de travailler) contribuent à assurer que les parents disposent d’un revenu suffisant pour offrir à leurs enfants une alimentation appropriée et un cadre de vie sain. Dans les pays en développement, ces allocations peuvent aussi constituer un outil très utile pour lutter contre le travail des enfants et promouvoir la fréquentation scolaire. Les enfants peuvent ainsi recevoir une instruction qui leur permettra à long terme d’atteindre des niveaux élevés de productivité et de revenu.
Les effets indirects sur la productivité ne sont pas non plus négligeables. L’existence d’un bon régime d’assurance chômage crée un sentiment de sécurité parmi la main-d’œuvre qui peut faciliter dans une large mesure des changements structurels et des innovations technologiques que les travailleurs pourraient sans cela considérer comme une grande menace pour leur subsistance. Ce lien a été illustré en République de Corée par l’accord tripartite de 1998 en vertu duquel les organisations de travailleurs ont accepté une plus grande flexibilité du marché du travail, y compris des licenciements, en échange d’une meilleure protection sociale.
La sécurité sociale contribue à créer un état d’esprit plus favorable non seulement aux changements structurels et technologiques mais aussi aux défis de la mondialisation et à ses avantages potentiels du point de vue de l’efficience et de la productivité. Les pays dont l’économie est relativement ouverte (rapport élevé des échanges au PIB) et qui sont fortement exposés aux risques extérieurs (grande variabilité des prix relatifs des importations et des exportations) fournissent semble-t-il des prestations élevées de sécurité sociale. Les sociétés fortement exposées aux risques extérieurs requièrent un degré plus élevé de protection sociale. Mondialisation et sécurité sociale semblent donc se renforcer mutuellement.
La sécurité sociale peut contribuer notablement à soutenir la demande effective et à entretenir la confiance des entreprises. Cette influence se fait le plus sentir dans le cas des prestations de chômage, qui contribuent à maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs ayant perdu leur emploi. D’autres prestations de sécurité sociale exercent aussi un effet d’amortissement sur le plan économique en période de récession ou de crise. Sans elles, une première série de pertes d’emploi pourrait avoir un effet multiplicateur et être suivie d’une deuxième et d’une troisième série qui risqueraient d’entamer profondément le tissu social et de conduire de larges pans de l’économie à fonctionner bien en deçà de leurs capacités. La sécurité sociale contribue donc à empêcher une trop forte baisse de la production, facilite le maintien des entreprises en activité, sans compression d’effectifs, et leur permet ainsi de se tenir prêtes à participer à la reprise dès qu’elle s’amorcera.
Cotisations des employeurs et compétitivité internationale
Beaucoup se sont inquiétés, dans les milieux politiques et économiques, de l’incidence des charges sociales sur la compétitivité des entreprises nationales, thèse fréquemment exposée lors de discussions sur la mondialisation. La plupart des économistes estiment cependant que la charge retombe en dernière analyse, par le jeu normal des mécanismes du marché, sur les travailleurs sous forme d’une réduction de la rémunération (par rapport à celle qu’ils toucheraient dans les mêmes conditions économiques en l’absence de tels prélèvements). En conséquence, les charges sociales sont probablement sans incidence en longue période sur le coût total du travail, ce que semble confirmer le tableau 2.1 où les pays de l’OCDE sont classés selon les coûts de main-d’œuvre (salaire brut, plus charges sociales). Sur les dix pays ayant les coûts du travail les plus élevés, deux seulement ont des charges sociales importantes (20 pour cent au plus). Parmi les dix pays suivants, cinq ont des charges sociales élevées. C’est en fait parmi les pays ayant les coûts de main-d’œuvre les plus faibles que l’on trouve la plus forte proportion de pays (cinq sur neuf) ayant des charges sociales élevées.
Tableau
2.1 Impôt
sur le revenu et cotisations de sécurité sociale à la charge
des salariés et des employeurs (en pourcentage
des coûts de main-d’œuvre), 19981
Pays2 |
Impôt |
Cotisations de sécurité sociale |
Total4 |
Coûts de |
|
|
|||||
Salarié |
Employeur3 |
||||
Belgique |
22 |
10 |
26 |
57 |
40 995 |
Allemagne |
17 |
17 |
17 |
52 |
35 863 |
Suisse |
9 |
10 |
10 |
30 |
32 535 |
Italie |
14 |
7 |
26 |
47 |
32 351 |
Pays-Bas |
6 |
23 |
14 |
44 |
32 271 |
Danemark |
34 |
10 |
1 |
44 |
32 214 |
Canada |
20 |
5 |
6 |
32 |
32 211 |
Norvège |
19 |
7 |
11 |
37 |
31 638 |
Etats-Unis |
17 |
7 |
7 |
31 |
31 300 |
Luxembourg |
10 |
11 |
12 |
34 |
31 102 |
Autriche |
8 |
14 |
24 |
46 |
29 823 |
Suède |
21 |
5 |
25 |
51 |
29 768 |
Australie |
24 |
2 |
0 |
25 |
29 590 |
Finlande |
22 |
6 |
21 |
49 |
29 334 |
Royaume-Uni |
15 |
8 |
9 |
32 |
29 277 |
France |
10 |
9 |
28 |
48 |
28 198 |
Japon |
6 |
7 |
7 |
20 |
27 664 |
Irlande |
18 |
5 |
11 |
33 |
24 667 |
Espagne |
11 |
5 |
24 |
39 |
24 454 |
Nouvelle-Zélande |
20 |
0 |
0 |
20 |
24 332 |
République de Corée |
1 |
4 |
9 |
15 |
22 962 |
Islande |
20 |
0 |
4 |
25 |
22 545 |
Grèce |
2 |
12 |
22 |
36 |
17 880 |
Turquie |
21 |
8 |
11 |
40 |
15 825 |
République tchèque |
8 |
9 |
26 |
43 |
15 781 |
Portugal |
6 |
9 |
19 |
34 |
13 903 |
Pologne |
11 |
0 |
33 |
43 |
12 696 |
Hongrie |
12 |
8 |
32 |
52 |
9 916 |
Mexique |
0 |
2 |
20 |
22 |
8 662 |
1 Célibataire disposant d’un salaire unique égal à
celui de l’ouvrier moyen. 2 Pays classés par ordre décroissant des
coûts de main-d’œuvre. 3 Les cotisations de sécurité sociale des
employeurs incluent les charges sociales déclarées. 4 Les chiffres
étant arrondis, le total peut différer d’un point par rapport
à la somme des colonnes «impôt sur le revenu» et «cotisations
de sécurité sociale». 5 Dollars convertis
à l’aide des parités de pouvoir d’achat. Les coûts de main-d’œuvre
comprennent les salaires bruts plus les cotisations obligatoires de sécurité
sociale des employeurs. |
|||||
En courte période toutefois, l’augmentation des charges sociales se traduit par la hausse du coût du travail. L’effet pourra se faire sentir un certain temps, notamment en cas de fonctionnement imparfait du marché du travail et du marché des produits ou dans les périodes de faible croissance et de faible inflation où les employeurs ont en général peu de marge de manœuvre dans les négociations salariales. Il importe donc d’éviter de fortes hausses des cotisations: l’économie pourra bien plus facilement absorber plusieurs petites augmentations échelonnées sur un certain nombre d’années qu’une seule et forte hausse.
Il apparaît que les cotisations de sécurité sociale n’ont pas d’incidence à long terme sur le chômage(6). On comprend mieux alors que le Danemark, seul pays d’Europe qui n’opère pour ainsi dire pas de prélèvement social sur les salaires, n’en retire pas d’avantage particulier du point de vue de l’emploi, le chômage correspondant à la moyenne européenne. Les gouvernements estiment souvent qu’une réduction des cotisations de sécurité sociale se traduira par une baisse des coûts du travail. On a étudié l’expérience du Chili avant et après la réforme de son régime de sécurité sociale afin de déterminer l’impact d’une forte réduction des cotisations. Le taux moyen de l’impôt sur les salaires dans l’échantillon des entreprises manufacturières couvertes par la recherche est tombé de 30 à 5 pour cent pendant la période allant de 1979 à 1985. Tout indique que cette baisse a été entièrement compensée par une hausse des salaires, et, de ce fait, les coûts de main-d’œuvre n’ont pas diminué(7).
Tout cela ne doit pas donner à penser que le niveau des cotisations de sécurité sociale n’a pas de limites. Dans toute société démocratique, les préférences politiques de la majorité imposent très certainement une limite. Suivant ce que les gens jugent souhaitable et juste, cette limite est bien plus basse dans certains pays que dans d’autres. De plus, une très forte hausse du niveau des cotisations peut créer des incitations à ne pas s’acquitter de ces cotisations, qui, si elles ne sont pas maîtrisées, porteront gravement atteinte au système.
Prestations de chômage, chômage et emploi
L’idée que la durée moyenne de perception des prestations de chômage est liée au niveau de ces prestations (taux de compensation) et à la période maximale pendant laquelle les prestations peuvent être obtenues a fait l’objet de nombreuses études. Plusieurs ont confirmé que le lien existe mais que son incidence est faible(8).
Une question importante laissée sans réponse par bon nombre de ces études est celle de savoir ce qui arrive aux gens qui cessent de recevoir des prestations de chômage. On ne peut se contenter de supposer qu’ils trouvent un emploi stable. Des travaux récents ont été consacrés à cette question. En Bulgarie, les non-bénéficiaires de prestations sont plus nombreux que les autres à sortir du chômage déclaré, mais pour demeurer inactifs plutôt que pour reprendre un emploi. En Slovaquie, la modification de la durée des prestations influe sur la sortie du chômage pour «d’autres raisons» que la reprise d’un emploi régulier. En Suède, les non-bénéficiaires de l’assurance chômage sont plus nombreux à sortir de la population active ou à participer à des programmes d’appui au marché du travail(9). Dans d’autres pays, les personnes ne recevant plus de prestations de chômage se tournent souvent vers des activités informelles, voire criminelles, ce qui occasionne des fraudes fiscales de grande ampleur et d’autres coûts pour la société. Etant donné que l’absence de droits à prestations peut simplement inciter les gens à quitter la population active, il est peut-être plus important d’examiner le rapport entre prestations de chômage et emploi. Finalement, ce que l’on craint surtout, c’est que des gens vivent des prestations de chômage alors qu’ils pourraient occuper un emploi. Une étude récente(10) conclut qu’il n’existe pas de rapport entre les prestations de chômage et l’emploi total. Elle fait aussi ressortir qu’un niveau élevé de chômage est lié à l’absence de politiques actives du marché du travail.
Ces dernières années, les effets préjudiciables que les dispositions en matière de retraite anticipée peuvent avoir sur l’emploi et sur le coût des pensions ont suscité de vives inquiétudes. Ces dispositions ont été introduites à une période où le chômage était élevé, surtout parmi les travailleurs âgés, dans l’espoir d’accroître les débouchés des jeunes. Le chômage ayant baissé, ces dispositions sont devenues plus restrictives ou ont été supprimées. Cependant, le comportement à l’égard de la retraite n’a guère ou pas évolué. Ce paradoxe s’explique par un certain nombre d’éléments:
- la proportion des travailleurs âgés touchant des prestations de chômage demeure relativement élevée et inclut nombre de personnes qui, de fait, ont déjà pris leur retraite;
- les régimes de pension des employeurs contiennent souvent de fortes incitations à prendre une retraite anticipée;
- même des travailleurs n’ayant ni prestations de chômage ni pensions au titre d’un régime privé quittent la vie active avant l’âge légal de la retraite; beaucoup d’entre eux sont des travailleurs manuels qui n’ont guère de débouchés et dont la santé est souvent précaire.
Prestations de chômage et promotion de l’emploi
Selon les estimations, à la fin de 1998, environ 1 milliard de travailleurs – soit le tiers de la population active mondiale – étaient soit au chômage, soit sous-employés. Le nombre effectif de chômeurs – c’est-à-dire de personnes à la recherche d’un travail ou disponibles pour travailler mais incapables de trouver un emploi – était de 150 millions environ. De plus, 25 à 30 pour cent des travailleurs sont sous-employés – ils travaillent moins qu’ils le souhaiteraient ou ne gagnent pas de quoi vivre. Il s’agit de chiffres impressionnants. La rapidité avec laquelle la situation peut évoluer est elle aussi impressionnante. Par exemple, par suite de la crise financière qui a frappé l’Asie, un travailleur sur 20 a perdu son emploi en République de Corée en l’espace de neuf mois (de novembre 1997 à juillet 1998) et le chômage déclaré a bondi de 2,3 à 8 pour cent entre la fin de 1997 et le début de 1999.
Les systèmes d’allocations de chômage protègent les salariés dans les pays industrialisés et dans un certain nombre de pays en développement à revenus intermédiaires. Dans la plupart des pays en développement, il n’existe aucune prestation de chômage en tant que telle, mais certains chômeurs ont parfois la possibilité d’obtenir quelques heures de travail rémunérées dans des programmes à fort coefficient de main-d’œuvre. Sur l’ensemble des travailleurs sans emploi dans le monde, la proportion de ceux qui ont droit à une allocation de chômage ne dépasse probablement pas 25 pour cent.
Normes internationales du travail
Les instruments les plus récemment adoptés sont la convention (no 168) et la recommandation (no 176) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988. Les éventualités couvertes par la convention comprennent le chômage complet «défini comme la perte de gain due à l’impossibilité d’obtenir un emploi convenable […] pour une personne capable de travailler, disponible pour le travail et effectivement en quête d’emploi». Les Etats Membres doivent s’efforcer d’étendre la protection de la convention à deux autres éventualités:
- la perte de gain due au chômage partiel (travail de courte durée);
- la suspension ou la réduction du gain due à une suspension temporaire de travail, ainsi que dans le cas des travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d’un emploi à plein temps.
Les personnes protégées par la convention «doivent comprendre des catégories prescrites de salariés formant au total 85 pour cent au moins de l’ensemble des salariés». Par rapport aux conventions antérieures ayant trait aux prestations de chômage, la convention (nº 44) du chômage, 1934, et la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention no 168 contient un élément novateur, en ce sens qu’elle prévoit l’octroi de «prestations sociales» à trois au moins des dix catégories de personnes suivantes en quête d’emploi: les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle; les jeunes gens ayant terminé leurs études; les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire; toute personne à l’issue d’une période qu’elle a consacrée à l’éducation d’un enfant ou aux soins d’une personne malade, handicapée ou âgée; les personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu’elles n’ont pas droit à une prestation de survivant; les personnes divorcées ou séparées; les détenus libérés; les adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation; les travailleurs migrants à leur retour dans leur pays d’origine, sous réserve de leurs droits acquis au titre de la législation de leur dernier pays de travail; les personnes ayant auparavant travaillé à leur compte.
Les prestations doivent être fixées à 50 pour cent au moins du gain antérieur dans les systèmes basés sur les gains; dans d’autres types de système, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du salaire minimum légal ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.
Dans le monde industrialisé, les régimes de protection contre le chômage sont très variables. Un groupe de pays se caractérise par le haut niveau et la longue durée des prestations d’assurance chômage, par la couverture extensive de cette assurance et par l’existence d’un système de prestations de dernier recours – l’assistance chômage – qui couvre les travailleurs n’ayant plus droit aux prestations de l’assurance chômage. Ce groupe de pays comprend l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse. En général, ces pays n’accordent pas seulement de bonnes prestations mais aussi un niveau élevé de protection de l’emploi.
Un deuxième groupe de pays comprenant l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, est doté de systèmes qui offrent un niveau plus bas de prestations. Selon le classement de la législation protectrice de l’emploi établi par l’OCDE, les dispositions légales en vigueur dans ces pays n’assurent apparemment guère de protection(11).
Les pays d’Europe centrale et orientale ont introduit vers la fin des années quatre-vingt des régimes de protection contre le chômage qui étaient au départ assez généreux mais qui ont depuis lors été restreints, particulièrement du point de vue de la durée des prestations. Le niveau des prestations, en pourcentage des gains, est du même ordre qu’en Europe occidentale, mais la proportion de chômeurs qui en bénéficient est beaucoup plus faible – par exemple, un tiers environ des chômeurs déclarés en Pologne.
Les systèmes de prestations de chômage deviennent de plus en plus inadaptés à mesure que les formes d’emploi sont de plus en plus incertaines. Ces systèmes doivent donc être suffisamment flexibles pour répondre aux changements et incertitudes auxquels se heurtent les travailleurs et doivent s’inscrire dans des stratégies plus vastes concernant l’emploi et le développement économique.
Dans les pays industrialisés, les politiques de protection de l’emploi ont notamment visé les travailleurs non qualifiés, lesquels sont particulièrement menacés par le chômage. Une approche a consisté à s’efforcer d’améliorer le niveau d’instruction et de formation de ces travailleurs afin qu’ils acquièrent les qualifications qui sont demandées dans une économie à salaire élevé et forte productivité. Une autre approche a consisté à utiliser la protection sociale pour subventionner la main-d’œuvre non qualifiée soit en versant des prestations soumises à une condition de ressources aux travailleurs pauvres, soit en exonérant (partiellement ou totalement) leurs employeurs du paiement des cotisations sociales (le coût étant pris en charge par l’Etat).
Pays en développement à revenus intermédiaires
Les systèmes de prestations de chômage en sont au mieux au stade de la gestation dans les pays en développement à revenus intermédiaires: la durée et le niveau des prestations sont généralement faibles et la couverture est bien plus restreinte que dans les pays industrialisés. Toutefois, les salariés du secteur formel sont protégés par diverses dispositions législatives dans nombre de ces pays, y compris ceux qui ne possèdent pas de système de prestations de chômage. La législation prévoit d’ordinaire une indemnité de licenciement de nature à aider les travailleurs au chômage pendant leur période d’inactivité. Toutefois, il s’agit de prestations forfaitaires dont le montant dépend de l’ancienneté et non de la perte de l’emploi ou de la durée du chômage. Les indemnités de licenciement sont généralement financées par les employeurs. Toutefois, dans certains pays d’Amérique latine, elles ont été transformées dans les années quatre-vingt-dix en régimes d’épargne obligatoire. Les fonds sont ainsi investis sur le marché des capitaux au lieu de rester dans l’entreprise. Cette formule introduit une certaine incertitude quant au montant des prestations qui seront versées aux travailleurs mais ceux-ci sont prémunis contre le risque de ne pas percevoir leur indemnité de licenciement en cas d’insolvabilité de leur employeur.
Dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés, la plupart des régimes d’assurance chômage sont financés par les cotisations des employeurs et des salariés, encore que dans certains pays d’Amérique latine, comme le Brésil et le Chili, ils soient financés par les recettes fiscales. Quand des prestations de chômage existent, peu nombreux sont généralement les chômeurs qui en bénéficient. Le taux de compensation (prestations par rapport aux gains antérieurs) varie entre 40 et 80 pour cent dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes et s’élève à 45 pour cent en Afrique du Sud. La durée des prestations, en général assez limitée, est souvent liée à la durée de l’affiliation. En Chine, les taux appliqués localement sont généralement bas. A Hong-kong, Chine, des prestations sont versées sous condition de ressources, dans le cadre du système d’aide sociale, aux chômeurs déclarés comptant une année au moins de résidence. La République de Corée a étendu son régime d’assurance chômage à la moitié environ des salariés, mais ceux qui travaillent dans les petites entreprises, et qui sont souvent les plus vulnérables, ne sont pas encore protégés.
La crise financière qui a récemment frappé l’Asie a fait apparaître que les régimes d’assurance chômage auraient pu jouer un rôle important dans l’atténuation de la misère occasionnée par la montée du chômage. Ils auraient aussi contribué à freiner la chute de la demande des consommateurs et la perte de confiance des chefs d’entreprise qui n’ont fait qu’aggraver la crise. Comme il ressort d’une récente étude de faisabilité effectuée par le BIT pour le compte du gouvernement de la Thaïlande, le taux de cotisation requis pour financer un modeste régime d’assurance chômage serait à long terme inférieur à 1 pour cent des gains.
Faire fonctionner un régime d’assurance chômage dans un pays en développement représente un défi considérable. Les services de l’emploi, pour autant qu’ils existent, demeurent rudimentaires et doivent être modernisés pour aider véritablement les chômeurs à trouver un autre emploi, et pour vérifier s’ils sont effectivement disposés à travailler et disponibles pour un emploi. Une autre difficulté réside dans le fait que, dans ces pays, beaucoup d’emplois ne sont pas couverts par la sécurité sociale – soit que la législation dispose, par exemple, que seuls les salariés des entreprises à partir d’une certaine dimension y seront affiliés, soit que les employeurs et les travailleurs ne respectent pas la loi.
En réalité, la plupart des travailleurs des pays en développement, y compris les pays à revenus intermédiaires, ne sont pas couverts parce qu’ils travaillent à leur compte ou parce qu’ils travaillent dans le secteur informel ou dans de petites entreprises. Pour les protéger en cas de chômage, d’autres mesures s’imposent – par exemple, la possibilité d’obtenir un emploi dans des travaux publics à fort coefficient de main-d’œuvre. Il est à noter que les travailleurs qui perdent leur emploi et n’ont droit à aucune prestation sont en général obligés de se tourner vers le secteur informel pour survivre: dans leur cas, plus que de chômage, il faudrait parler de sous-emploi.
Les mesures éventuellement prises par les autres pays en développement pour offrir une certaine protection aux chômeurs et aux sous-employés prennent généralement la forme de programmes à fort coefficient de main-d’œuvre. Ceux-ci sont principalement entrepris pendant la morte-saison, lorsque les petits agriculteurs et les travailleurs sans terre sont désœuvrés. En milieu urbain, des programmes de ce genre peuvent aussi être lancés en période de récession ou de crise. Ils permettent de créer des emplois et d’atténuer notablement la pauvreté en mobilisant beaucoup de main-d’œuvre pour la réalisation de grands programmes d’équipement principalement axés sur les besoins sociaux des catégories à bas revenu. De tels programmes peuvent prendre une ampleur considérable. Par exemple, en Inde, le programme Jawahar Rozgar Yojana s’étendait, au milieu des années quatre-vingt-dix, à plus d’un tiers des districts sous-développés du pays et assurait une vingtaine de jours de travail par an à chaque participant. Des programmes analogues mais plus modestes ont été lancés dans des pays tels que la Bolivie, le Chili, le Honduras, le Botswana, le Kenya, la République-Unie de Tanzanie et, récemment, l’Afrique du Sud. L’organisation faitière AFRICATIP regroupe 18 agences d’exécution qui, dans les pays francophones et lusophones d’Afrique, organisent des travaux publics confiés à de petits entrepreneurs locaux, en vue de stimuler l’emploi.
L’un des traits saillants des programmes à fort coefficient de main-d’œuvre réside dans l’autosélection des travailleurs qui y participent. Ces programmes ne versent que de bas salaires (salaires agricoles en vigueur dans la région pour un travail similaire ou salaire minimum s’il est suffisamment réaliste) et ne peuvent donc intéresser que les travailleurs appartenant à des familles à bas revenus. Cela évite les dispositions administratives coûteuses et lourdes qui seraient nécessaires si l’aide fournie à ces travailleurs était subordonnée à une condition de ressources. L’avantage de ces programmes est qu’ils sont ouverts tant aux salariés qu’aux personnes qui travaillent d’ordinaire à leur compte (dont les besoins sont parfois tout aussi importants). Les programmes à fort coefficient de main-d’œuvre peuvent être conçus de telle manière que les travailleurs aient un emploi garanti pendant un certain nombre de jours, ce qui est donc une forme de sécurité du revenu. Cette garantie est particulièrement solide lorsque des emplois sont créés à la demande.
Le présent chapitre a montré qu’il existe un lien complexe entre la sécurité sociale, l’emploi et le développement. Au niveau macroéconomique, tout au moins dans les pays industrialisés, il ne semble pas y avoir de rapport bien défini entre dépenses de sécurité sociale, productivité et chômage mais, au niveau sectoriel et à celui des entreprises, tout porte à croire qu’il existe une corrélation positive entre la productivité et la sécurité sociale. Tel est particulièrement le cas pour l’assurance maladie, qui accroît la productivité des travailleurs, et pour les allocations pour enfant à charge, lorsqu’elles sont liées à la fréquentation scolaire. Par ailleurs, les cotisations des employeurs ne semblent pas avoir un impact à long terme sur les coûts de main-d’œuvre et sur la compétitivité internationale, vu que la charge de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale retombe en dernière analyse sur les travailleurs sous forme d’une réduction de la rémunération. Enfin, il apparaît – dans certains pays industrialisés – que le niveau et la durée des prestations de chômage ont certains effets négatifs au niveau du chômage, effets qu’il est possible d’atténuer par une meilleure définition des prestations et de bonnes politiques du marché du travail.
Sur les 150 millions de chômeurs que l’on dénombre dans le monde, il est probable que pas plus du quart bénéficie d’une assurance chômage, et ces bénéficiaires se concentrent dans les pays industrialisés. Les travailleurs du secteur informel, rural ou urbain des pays en développement ne bénéficient pratiquement d’aucune protection contre le chômage. Dans les pays industrialisés, le plus important est probablement d’élargir la couverture personnelle des régimes d’assurance chômage – en coordination avec les politiques du marché du travail. Dans la plupart des pays en développement à revenus intermédiaires, l’assurance chômage peut, à un coût relativement faible, jouer un rôle important dans l’atténuation de la misère occasionnée par une montée rapide du chômage. Cependant, la majorité des travailleurs qui n’appartiennent pas au secteur formel ne pourront être protégés contre le chômage que par des politiques macroéconomiques visant notamment à stimuler la demande et par des mesures de promotion directe de l’emploi telles que l’aide à la création d’entreprises, la formation et les programmes à fort coefficient de main-d’œuvre.
Les politiques adoptées en matière de sécurité sociale font partie intégrante, et sont interdépendantes, d’une large gamme de politiques sociales – investissements dans des services sociaux de base, législation protectrice du travail, respect des droits fondamentaux. Elles sont aussi étroitement liées à la politique de l’emploi, étant donné que la plupart des régimes d’assurance sociale sont financés par les revenus du travail et assurent une protection contre les risques concernant la capacité de travail, tels que le chômage, la maladie, l’infirmité et le vieillissement. Les résultats en matière de sécurité sociale et d’emploi dépendent beaucoup du développement économique et contribuent à favoriser le processus de développement socio-économique.
Comme il est indiqué au chapitre I, la sécurité sociale est de plus en plus considérée comme une partie intégrante du processus de développement. Il est donc nécessaire de rechercher des synergies entre politiques de protection sociale, politiques de l’emploi et politiques du développement. Ces synergies existent dans divers secteurs de la politique sociale – santé, éducation, logement, bien-être social – et également dans certains domaines de la politique économique – notamment politiques macroéconomiques et sectorielles (par exemple, promotion de la petite entreprise). Néanmoins, les synergies potentielles sont probablement plus fortes aux niveaux des politiques de l’emploi et du marché du travail.
Le présent chapitre était axé sur l’économie, eu égard aux répercussions que la sécurité sociale peut avoir sur le plan économique. La question fondamentale est celle de savoir quel est le but de l’activité économique. Les concepts de travail décent et de développement axés sur l’être humain, qui englobent la sécurité sociale, doivent occuper le devant de la scène.
Extension de la couverture sociale
Les instruments internationaux adoptés par l’OIT et par les Nations Unies proclament que tout être humain a droit à la sécurité sociale. Dans la Déclaration de Philadelphie (1944), la Conférence internationale du Travail reconnaît l’obligation de l’OIT de promouvoir «l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets». La recommandation (no 67) sur la sécurité du revenu, 1944, dispose que: «l’assurance sociale devrait accorder sa protection, dans les éventualités auxquelles ils sont exposés, à tous les salariés et travailleurs indépendants ainsi qu’aux personnes à leur charge» (paragr. 17). La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) proclame que «toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale» (art. 22), et cite expressément le droit aux soins médicaux et aux services sociaux nécessaires, à la sécurité en cas de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse, de chômage, et à une assistance et à une aide spéciales pour la maternité et l’enfance (art. 25). Le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (1966) reconnaît «le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales» (art. 9).
Il va sans dire que la mise en pratique de ce droit exige un engagement important de la part de l’Etat et de la collectivité. Les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale admettent que cet idéal peut être difficile à atteindre. C’est ainsi que la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, dispose dans le cas des indemnités de maladie et des prestations de vieillesse, par exemple, que les personnes protégées doivent comprendre:
- soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés;
- soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidents;
- soit tous les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas les limites prescrites.
Cette possibilité de choix vise à faciliter la ratification de la convention par tous les pays, quel que soit leur régime de sécurité sociale. Les conventions ultérieures telles que la convention (no 128) sur les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, contiennent des normes plus rigoureuses, mais offrent la même possibilité de choix.
La convention (no 110) sur les plantations, 1958, s’applique aux travailleurs employés par les exploitations agricoles situées dans les régions tropicales ou subtropicales. En termes de sécurité sociale, elle est moins rigoureuse que la convention no 102. Elle exige que les travailleurs des plantations aient droit à des indemnités et à une protection de la maternité, y compris douze semaines de congé payé au minimum. Elle contient également des dispositions relatives aux soins médicaux.
Pendant les années quatre-vingt-dix, l’OIT a adopté de nouveaux instruments visant, entre autres objectifs, à promouvoir la sécurité sociale des personnes sans emploi salarié régulier. C’est ainsi que la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, dispose que la politique nationale sur le travail à domicile doit promouvoir, autant que possible, l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, y compris en matière de sécurité sociale et de protection de la maternité. La recommandation nº 184, qui l’accompagne, propose que cette protection sociale soit assurée par l’extension et l’adaptation des régimes existants de sécurité sociale et/ou le développement de caisses ou de régimes spéciaux. La recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, recommande de revoir la législation sociale et du travail pour déterminer, entre autres, si la protection sociale s’étend aux travailleurs de ces entreprises, s’il existe des dispositions adéquates en vue d’assurer que la législation en matière de sécurité sociale est respectée et s’il est nécessaire de compléter les mesures de protection sociale prévues pour ces catégories de travailleurs. La convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994, dispose que les régimes de sécurité sociale doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps comparables.
Problème de l’absence de couverture
Une très forte proportion de la population ne bénéficie, dans la plupart des régions, d’aucune protection sociale ou n’est couverte que très partiellement. C’est le cas de la grande majorité des habitants des pays en développement et, même dans certains des pays industrialisés les plus riches, on constate des lacunes importantes et croissantes en matière de protection sociale.
Pour diverses raisons, les travailleurs de l’économie informelle n’ont pas de sécurité sociale. L’une de ces raisons est que le recouvrement des cotisations auprès de ces travailleurs et, le cas échéant, de leurs employeurs, est extrêmement difficile. L’autre problème est que, le financement des prestations de sécurité sociale représentant pour beaucoup d’entre eux un pourcentage relativement élevé de leur revenu, ils ne sont ni en mesure de cotiser ni disposés à le faire lorsque ces prestations ne répondent pas à leurs besoins prioritaires. En général, les soins de santé font d’autant plus partie de leurs priorités immédiates que les mesures d’ajustement structurel ont réduit l’accès aux services gratuits. Ils ressentent moins le besoin de bénéficier d’une retraite, par exemple, la vieillesse leur paraissant souvent très éloignée, et l’idée de la retraite quasi irréelle. Leur méconnaissance des régimes de sécurité sociale et leur méfiance à l’égard de la manière dont ces régimes sont gérés ajoutent à leur réticence.
Le problème n’a rien de nouveau, surtout dans les pays où une forte proportion de la population travaille dans l’agriculture de subsistance. Toutefois, ces dernières années, les chances de le résoudre, ou du moins de l’atténuer, se sont fortement réduites, car la part de la main-d’œuvre urbaine qui travaille dans l’économie informelle est allée en augmentant, le processus d’ajustement structurel aidant.
En Amérique latine et dans beaucoup d’autres régions en développement, l’augmentation de la main-d’œuvre urbaine ces dernières années a été due essentiellement à l’économie informelle. Dans la plupart des pays d’Afrique, une proportion croissante de la main-d’œuvre urbaine est active dans l’économie informelle, ce qui s’explique par la stagnation de l’emploi salarié, par l’exode rural et par le fait que les salariés doivent compléter leurs revenus en baisse par les gains qu’ils tirent de l’économie informelle. C’est ainsi qu’au Kenya l’emploi informel représentait en 1996 près des deux tiers de l’emploi urbain total, contre 10 pour cent à peine en 1972(12). Même si dans plusieurs pays en développement d’Asie l’emploi salarié a beaucoup progressé, l’économie informelle demeure très importante un peu partout. En Inde, plus de 90 pour cent des travailleurs relèvent de l’économie informelle (agriculture comprise).
On notera que l’économie informelle n’est pas un «secteur» à proprement parler: elle s’étend à pratiquement tous les secteurs et englobe toutes les catégories de travailleurs: salariés, travailleurs indépendants, travailleurs à domicile, travailleurs familiaux non rémunérés, etc. Ce phénomène ne se limite pas aux petites entreprises. En Argentine et au Brésil, par exemple, près de 40 pour cent des travailleurs salariés urbains relèvent de l’économie informelle.
Dans beaucoup de pays, il y a plus de femmes que d’hommes dans l’économie informelle, notamment parce que, là, elles peuvent plus facilement concilier travail et responsabilités familiales, mais aussi pour d’autres raisons qui sont liées en particulier à la discrimination dont elles font l’objet dans le secteur structuré. Les statistiques du BIT montrent que, dans les deux tiers des pays pour lesquels on dispose de données à ce sujet, la proportion de main-d’œuvre urbaine féminine relevant de l’économie informelle est plus forte que celle de la main-d’œuvre urbaine masculine(13). Les femmes ont tendance à rester dans l’économie informelle pendant une grande partie de leur vie professionnelle, alors que les hommes y restent moins, du moins dans les pays industrialisés. Pour ce qui est de la sécurité du revenu à long terme (durant la vieillesse, par exemple), cette différence a des implications particulièrement importantes dans la mesure où les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes.
Les travailleurs de l’économie informelle n’ont pratiquement ni sécurité de l’emploi ni sécurité du revenu. Leurs revenus sont généralement très faibles et ont tendance à fluctuer davantage que ceux des autres travailleurs. Il suffit d’une brève période d’incapacité de travail pour que le travailleur et sa famille aient du mal à survivre financièrement. Il suffit qu’un membre de la famille soit malade pour que l’équilibre délicat du budget familial soit rompu. Le travail dans l’économie informelle comporte souvent des risques que l’environnement – non réglementé – dans lequel il se déroule ne fait qu’accroître. Les femmes sont confrontées à des problèmes supplémentaires – par exemple, le licenciement en cas de grossesse ou de mariage. Les femmes qui travaillent dans l’économie informelle ne bénéficient d’aucune des protections et prestations dont bénéficient en principe les femmes salariées dans l’économie formelle pour élever leurs enfants (allocations familiales, congé de maternité payé, pauses d’allaitement, aide financière pour la garde des enfants).
Il est aujourd’hui largement admis qu’il est urgent de trouver des moyens efficaces d’étendre la couverture sociale. La proportion de la main-d’œuvre qui bénéficie d’une couverture sociale stagne depuis quelques années. Etant donné les tendances économiques actuelles, l’absence de mesures entraînera très probablement une diminution du taux de couverture, voire du nombre de travailleurs assurés, comme c’est déjà le cas dans certaines régions d’Afrique subsaharienne.
Politiques propres à étendre la couverture sociale
En dehors du monde industrialisé, les responsables ont trouvé bien peu de remèdes au problème de l’absence de couverture sociale. Trois explications possibles à cela: les politiques de protection sociale adoptées ne conviennent pas, on n’a pas fait suffisamment d’efforts pour les appliquer, ou encore l’absence de protection sociale est liée à des problèmes économiques, sociaux et politiques beaucoup plus larges. Si les dirigeants définissent le problème de façon trop restrictive, leurs chances de trouver des solutions réalistes diminueront. Le contexte dans lequel s’insèrent les régimes de sécurité sociale doit donc être dûment pris en considération.
Contexte économique, social et politique
Le premier point à considérer est la manière dont un pays est dirigé. En ce qui concerne les économies de marché, l’expérience montre que, à de rares exceptions près, il y a corrélation entre le degré de démocratie et le degré d’adéquation de la protection sociale. Il est essentiel, pour que les catégories les plus vulnérables puissent voir satisfaits leurs besoins en matière de soins de santé et de sécurité du revenu, qu’elles puissent se faire entendre. Une démocratie qui n’assure pas une protection sociale appropriée a peu de chance de survivre.
Le deuxième point à considérer est la situation macroéconomique et l’état du marché du travail. La protection sociale n’a de chances de s’étendre naturellement (on verra plus loin par quels moyens) que si le marché du travail est solide. Tant que la demande de main-d’œuvre demeurera faible, rares sont ceux qui auront un emploi décent; la plupart ne pourront compter que sur un travail mal rémunéré et non protégé dans l’économie informelle. Inversement, si la demande de main-d’œuvre augmente, il y aura plus de travailleurs à pouvoir espérer un jour un emploi mieux payé et généralement mieux protégé dans l’économie formelle. Toutefois, l’économie informelle, sous ses nombreuses manifestations, n’est pas près de disparaître, il faut donc absolument que les gouvernements œuvrent en faveur d’une politique de la protection sociale, novatrice et imaginative, propre à améliorer la condition de ces travailleurs.
Troisième point: il ne faut pas attendre des régimes de sécurité sociale plus qu’ils ne peuvent offrir. Ils ne peuvent ni remplacer de bonnes politiques macroéconomiques, régionales, d’éducation, de logement, etc., ni assurer à eux seuls une répartition équitable du revenu. Il est vrai que les régimes de sécurité sociale permettent souvent de redistribuer les revenus en faveur des plus pauvres mais ce n’est pas leur objectif principal. Leur objectif principal est d’assurer la sécurité des individus lorsqu’ils sont malades, handicapés, chômeurs, à la retraite, etc. Les régimes qui permettent à chacun d’y trouver son compte sont généralement les mieux appliqués. Si importante qu’elle soit, la sécurité sociale n’est qu’une des mesures à prendre pour atténuer la pauvreté et améliorer la répartition des revenus.
Il est également indispensable, si l’on veut qu’ils aient et gardent une couverture large, que les régimes de sécurité sociale aient la confiance de la population. Cela suppose non seulement une administration efficace et une grande probité financière, mais aussi que l’Etat s’engage à assurer la viabilité du système sur le long terme. Si la confiance fait défaut, les gens trouveront toujours un moyen de tourner la loi, même si leur besoin de protection sociale est très élevé.
Stratégies d’extension de la couverture sociale
Pour étendre la couverture sociale, on peut:
- étendre les régimes d’assurance sociale;
- encourager la microassurance;
- introduire des prestations ou des services universels financés par les recettes générales de l’Etat;
- établir ou étendre des prestations ou services assujettis à condition de ressources et financés par les recettes générales de l’Etat (aide sociale).
Aucune de ces approches n’est à exclure a priori. Il faut les combiner en fonction du contexte national. Le rôle que joue chacune de ces approches et le lien qui les relie doivent être examinés soigneusement. Rien ne peut être fait sans une bonne analyse, ce qui suppose recherches, expériences et innovations. Bien entendu, des distinctions doivent être faites entre les différents groupes de pays en fonction de leur niveau de développement économique et social. En ce qui concerne les pays en développement, il convient de mettre à part les pays à revenus intermédiaires, dont certains ont déjà des institutions de sécurité sociale bien développées. Ces pays, mais aussi les pays industrialisés où la couverture est incomplète, pourraient choisir d’étendre la couverture obligatoire à la totalité ou, en tout cas, à la majeure partie de la population, en utilisant les régimes d’assurance sociale existants ou en les modifiant de manière à répondre aux besoins des nouvelles catégories à couvrir. Dans les pays à bas revenus, il faudra, pour étendre véritablement la couverture sociale, recourir à certains des autres moyens mentionnés plus haut.
Régimes d’assurance sociale
Pratiquement chaque fois qu’ils ont rendu obligatoires les régimes d’assurance sociale pour telle ou telle catégorie de la main-d’œuvre de l’économie formelle, les législateurs ont envisagé d’étendre leur couverture ultérieurement. La limitation initiale de la couverture a presque toujours été justifiée par des contraintes d’ordre pratique, comme l’absence d’infrastructure administrative permettant le recouvrement des cotisations des travailleurs des petites entreprises ou des travailleurs indépendants, ou le manque de services de santé en milieu rural, qui interdisait de demander aux travailleurs de cotiser. Ces raisons étaient, et demeurent, dans bien des cas, parfaitement valables. Reste à savoir ce que l’on fait pour supprimer ces contraintes.
Malheureusement, dans bien des cas, la réponse est que l’on a fait très peu de choses, et ce pour différentes raisons:
- l’absence de possibilité de pression politique efficace de la part de ceux qui ne sont pas protégés et leur méconnaissance des avantages que peut apporter la protection sociale;
- l’absence d’un partenariat social efficace dans certains pays et au niveau international;
- la réticence ou l’incapacité des gouvernements à prendre des engagements nouveaux et potentiellement coûteux;
- l’inertie institutionnelle.
La première raison et, jusqu’à un certain point, la deuxième tiennent au niveau d’organisation relativement faible des personnes qui ne bénéficient pas d’une protection sociale. La troisième tient au fait que le coût des subventions, que les gouvernements accordent aux personnes – une minorité – qui sont couvertes par le système existant, augmenterait fortement si la protection était sensiblement étendue. Pour ce qui est de la quatrième raison, les institutions chargées d’administrer le système existant ont souvent le plus grand mal à s’acquitter de leur mission et ne sont donc guère tentées de recommander une extension du système.
En supprimant les obstacles qui s’opposent à la liberté d’association et en renforçant les institutions démocratiques, on contribuerait à résoudre le premier problème, et on contribuerait à régler le deuxième en prenant des mesures pour promouvoir la négociation collective et les institutions tripartites. Pour atténuer les répercussions sur le budget de l’Etat d’une extension de la couverture sociale, on pourrait réduire, réorienter, voire, si nécessaire, éliminer les subventions de l’Etat, surtout lorsqu’elles profitent à une minorité et qu’elles ne peuvent pas être étendues à la majorité de la main-d’œuvre. Pour ce qui est de l’inertie institutionnelle, on peut y remédier en partie en affranchissant les institutions de sécurité sociale des règles de la fonction publique lorsque celles-ci imposent des limites irréalistes pour les effectifs et les rémunérations, et en leur donnant des instructions claires pour l’élaboration, dans des délais précis, de propositions de lois visant à étendre la couverture sociale.
L’extension de la couverture sociale obligatoire se fait le plus souvent par étapes, en y intégrant des entreprises de plus en plus petites. A chaque étape on accroît évidemment le nombre des travailleurs assurés, mais on accroît aussi de manière disproportionnée le nombre des entreprises auxquelles le régime de sécurité sociale s’applique. Les petites entreprises posent parfois des problèmes supplémentaires, en raison du caractère rudimentaire de leur système de comptabilité et de rémunération des travailleurs, et de leur tendance à contourner la loi. Comme on peut le comprendre, beaucoup de régimes de sécurité sociale peu développés hésitent à couvrir l’ensemble des salariés, dont ceux des petites entreprises. Cela est pourtant faisable, comme le montre l’expérience de nombreux pays. Il peut même y avoir des avantages à ne pas fixer de plafond afin de ne pas inciter les employeurs à sous-déclarer leurs effectifs. En effet, beaucoup d’entreprises indiquent des effectifs légèrement inférieurs au plafond fixé par la loi, et il est très difficile dans les faits d’apporter la preuve qu’il y a sous-déclaration. Par ailleurs, toute règle qui encourage les entreprises à rester de petites entreprises risque de freiner leur développement et la croissance de leur productivité. Le principal argument en faveur d’un système qui couvre jusqu’aux plus petites entreprises est que, en général, ce sont justement ceux qui travaillent dans les petites entreprises qui sont les moins bien payés et dont la sécurité de l’emploi est plus faible, et qui, par conséquent, ont le plus besoin d’une couverture sociale.
Les efforts qui ont été faits pour étendre les régimes d’assurance sociale aux travailleurs indépendants n’ont pas toujours été couronnés de succès. Rares sont ceux qui adhèrent à des régimes facultatifs, faute, souvent, de pouvoir payer à la fois la cotisation patronale et la cotisation à la charge des travailleurs. Ce n’est que dans certains cas que les personnes non couvertes par une assurance obligatoire ont tout intérêt à contracter une assurance facultative, par exemple pour préserver leurs droits à pension ou pour obtenir la période minimum donnant droit à pension. Pour ce qui est de l’assurance obligatoire des travailleurs indépendants, elle est difficile à mettre en place, car il n’est pas facile de recenser les travailleurs indépendants et de savoir ce qu’ils gagnent. Certains régimes spéciaux destinés aux travailleurs indépendants ont plus de succès, surtout si l’Etat est disposé à les subventionner. Les régimes d’assurance sociale spéciaux peuvent tenir compte de la faible capacité contributive de la plupart des travailleurs indépendants et offrir un ensemble de prestations plus limité que le régime destiné aux salariés. Le taux de cotisation étant plus faible, et seules les prestations qui intéressent le plus les travailleurs indépendants étant offertes (d’après les travaux de recherche récents du BIT sur plusieurs pays en voie de développement, ce sont, en plus des soins de santé, les pensions de survivants et l’assurance invalidité), on a moins de problèmes d’application.
Le soutien financier apporté aujourd’hui (sous forme d’abattements fiscaux) aux régimes d’assurance facultatifs profite essentiellement aux régimes de pensions et d’assurance maladie privés complémentaires, et favorise donc dans l’ensemble les groupes à revenus supérieurs. Le soutien que l’Etat apporte à ces régimes doit absolument être quantifié. Ces données permettront d’éclairer le débat public sur la protection sociale et de définir les priorités pour l’utilisation des ressources publiques en vue d’un meilleur ciblage du soutien de l’Etat.
Voici quelques exemples récents de régimes d’assurance obligatoires qui ont été étendus avec succès.
En 1995, la Namibie a institué un nouveau régime qui comporte des prestations de maternité, de maladie et de décès (funérailles). En 1999, on estimait à 80 pour cent le pourcentage des travailleurs du secteur formel qui étaient assurés. Le régime garantit trois mois de prestations de maternité à 80 pour cent du salaire assuré et jusqu’à deux ans de congé de maladie à 60 pour cent du salaire pendant six mois, puis à 50 pour cent. On attribue le succès de ce régime au fait qu’il est administré de manière efficace, à ses cotisations peu élevées et à l’absence d’intérêts financiers organisés s’y opposant(14).
A la suite de la première élection de Bill Clinton à la présidence des Etats-Unis, l’une des personnes qu’il avait nommées à un poste important ayant admis qu’elle n’avait pas assuré la personne qui lui gardait son enfant, et beaucoup d’autres personnes se trouvant dans le même cas, le Congrès a modifié la loi de manière à faciliter le paiement des cotisations et à punir sévèrement ceux qui ne s’en acquitteraient pas. Cela a fait beaucoup augmenter le nombre d’assurés parmi les gens de maison.
Le système de pensions de la République de Corée, qui couvrait 7,8 millions de travailleurs, a été étendu en 1999 à 8,9 millions d’autres personnes, comme les travailleurs indépendants urbains et les salariés des entreprises employant moins de 5 personnes. L’année précédente, le régime d’assurance chômage, qui ne s’appliquait depuis 1995 qu’aux salariés des entreprises employant au minimum 30 personnes, avait été étendu aux entreprises employant 10 travailleurs au moins, puis, sur décision de la commission tripartite, aux entreprises employant 5 travailleurs au moins. En 1999, il a été étendu aux travailleurs à temps partiel.
En Espagne, depuis la loi de 1986, les soins de santé sont accessibles à 99,8 pour cent de la population, y compris les personnes à la charge des assurés (quel que soit leur âge), les bénéficiaires d’une pension et les personnes qui devaient auparavant faire appel à l’aide sociale pour les soins de santé.
Microassurance et régimes destinés aux travailleurs de l’économie informelle
Ces dernières années, différents groupes de travailleurs de l’économie informelle ont créé leurs propres régimes de microassurance. Dans ces régimes, l’assurance est gérée au niveau local et l’unité locale s’intègre parfois dans des structures plus grandes qui sont à même d’optimiser la fonction d’assurance et le soutien nécessaires à une meilleure gestion. Ces régimes présentent, du moins en général, les avantages de la cohésion et d’une participation directe. Les coûts administratifs peuvent également être faibles, mais les avis sont très partagés quant au rapport coût/efficacité. Ces régimes s’inscrivent parfois dans le cadre d’un programme de crédit, comme la Banque Grameen, qui a déjà une bonne expérience du recouvrement des contributions et de l’administration des paiements. Par ailleurs, dans des pays comme l’Argentine, les régimes d’assistance mutuelle peuvent mettre en place des systèmes de crédit pour subventionner leur activité en matière de soins de santé. Dans certains cas, les systèmes se sont développés conjointement avec des organisations comme la SEWA (Association des travailleuses indépendantes) en Inde, qui connaissent bien les besoins de leurs membres.
Le mot microassurance renvoie à l’aptitude à gérer des flux de trésorerie (recettes et dépenses) modestes et non à la taille des systèmes, même si ceux-ci sont en fait souvent des systèmes locaux comprenant peu de membres. Le principal objectif de beaucoup de ces systèmes est d’aider leurs membres à supporter des frais médicaux imprévisibles. En général, ils ne visent pas à offrir une assurance maladie complète, et encore moins des prestations qui remplacent le revenu.
Là où ils existent, ces systèmes n’attirent généralement pas plus de 25 pour cent de la population cible. Les seuls à obtenir un taux plus élevé (entre 50 et 100 pour cent) sont ceux des collectivités particulièrement soudées ainsi que ceux auxquels tous les membres du groupe cible (par exemple, syndicat ou association professionnelle) sont tenus de s’affilier. Bien que peu satisfaisants, les pourcentages sont nettement supérieurs à ceux obtenus par les régimes d’assurance sociale facultatifs ouverts à tous les travailleurs indépendants. La raison en est sans aucun doute que les cotisations de microassurance sont beaucoup plus faibles et que ces systèmes n’offrent que les prestations jugées indispensables par les intéressés.
Ces systèmes ont le potentiel d’accroître considérablement la couverture sociale en collaborant les uns avec les autres ainsi qu’avec les régimes légaux d’assurance sociale, les autorités locales ou nationales et d’autres grands organismes. Il y a différentes manières, pour l’Etat, de promouvoir les régimes de microassurance:
- soutien financier (aide au démarrage, appui pour la réassurance, subventions sous forme de contributions de contrepartie, etc.);
- création d’un cadre législatif et réglementaire propre à permettre à ces systèmes de fonctionner de manière démocratique et saine sur le plan économique.
Le potentiel des régimes de microassurance reste à confirmer dans la pratique. On peut considérer qu’ils mériteraient de bénéficier d’un soutien plus grand. En tout cas, ils devraient faire l’objet de recherches approfondies.
Comme exemple de systèmes financés par l’Etat et destinés aux travailleurs de l’économie informelle, on peut citer, en Inde, les programmes qui sont financés par les recettes d’un impôt sur la production d’environ 5 millions de personnes travaillant dans l’industrie des cigarettes et l’industrie cinématographique, ainsi que dans certaines mines. Il y a un système semblable aux Philippines pour les travailleurs de l’industrie sucrière. Toutefois, les ressources sont généralement modestes, et la couverture sociale limitée.
Prestations ou services universels financés par les recettes générales de l’Etat
Des prestations universelles en espèces sont offertes dans un certain nombre de pays industrialisés, mais rarement dans les pays en développement, Maurice, par exemple, faisant exception. Les services universels, en particulier les services de santé publique, sont plus courants. Toutefois, ces dernières années, le caractère universel de ces services de santé a été fortement érodé par la participation obligatoire des usagers aux frais, à laquelle n’échappent que les plus démunis.
Par définition, les régimes universels couvrent 100 pour cent de la population cible, par exemple tous ceux qui dépassent un certain âge, sans conditions de cotisations ou de revenus. Ils évitent bien des problèmes que rencontrent les régimes contributifs. Naturellement, ils sont généralement plus coûteux, dans la mesure où ils fournissent des prestations à davantage de personnes. Toutefois, on ne doit pas oublier que les conditions imposées, comme l’âge de la pension, peuvent être tout à fait restrictives, et les prestations plutôt faibles. Les systèmes de soins de santé universels permettent une bien meilleure maîtrise des coûts que les autres systèmes de soins de santé et les frais administratifs sont moindres. Les régimes contributifs diffèrent également des régimes universels par le fait que ces derniers n’assurent pas de prestations en espèces supérieures aux personnes qui gagnent plus, mais un montant forfaitaire à tous les ayants droit. Cela permet également de contenir les coûts.
Les régimes universels peuvent beaucoup contribuer à l’égalité entre hommes et femmes. Chacun peut en bénéficier, quels que soient sa situation au regard de l’emploi et ses antécédents professionnels, et les femmes perçoivent des prestations égales à celles des hommes. Les prestations généralement offertes par les régimes universels revêtent une importance particulière pour les femmes, qu’il s’agisse des pensions de vieillesse (les femmes ont une espérance de vie plus longue), des allocations familiales (les femmes s’occupent généralement davantage que les hommes des enfants) ou des soins de santé (la santé des enfants et les problèmes de santé génésique intéressant tout particulièrement les femmes).
Le vrai problème des régimes universels, régimes que l’on trouve surtout dans les pays industrialisés, n’est pas tant leur coût global (généralement inférieur à celui des régimes contributifs) que le fait qu’ils sont financés par les recettes générales de l’Etat, lequel doit faire face à de multiples priorités. Il suffit que les politiques ou les conditions économiques changent pour que ce qui est considéré comme acceptable une année le soit moins l’année suivante.
La prestation universelle en espèces la plus large que l’on puisse imaginer est le revenu qui serait versé à tous les citoyens, c’est-à-dire non seulement à des groupes tels que les enfants et les personnes âgées, qui ne sont pas censés gagner leur vie, mais aussi aux personnes valides en âge de travailler. Cette option a suscité un grand intérêt ces dernières années. Pour certains de ses partisans, elle remplacerait les prestations assujetties à condition de revenu telles que l’aide sociale; pour d’autres, elle remplacerait tous les autres régimes de sécurité sociale, y compris l’assurance sociale.
Création ou extension des prestations ou services
assujettis à condition
de ressources (aide sociale)
L’aide sociale existe dans pratiquement tous les pays industrialisés, où elle sert à combler (du moins en partie) les lacunes des autres systèmes de protection sociale et à atténuer ainsi la pauvreté. Dans les pays en développement, l’aide sociale est beaucoup moins répandue. Là où elle existe, elle se limite d’ordinaire à une ou deux catégories, par exemple les personnes âgées.
L’indigence relative des systèmes d’aide sociale dans les pays en développement témoigne des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux gouvernements. La faiblesse du revenu national ou des recettes de l’Etat n’explique pas tout. On peut se demander si les gouvernements accordent toujours suffisamment d’importance, dans leur liste de priorités, aux systèmes d’aide sociale, dont les bénéficiaires ont rarement un grand poids politique.
L’aide sociale est réservée aux personnes qui sont dans le besoin, et rien n’empêche en principe de rendre l’évaluation des ressources suffisamment rigoureuse pour exclure tous les autres, mais, en général, les choses se passent tout autrement, même dans les systèmes d’aide sociale les plus aboutis. Tout d’abord, aucune évaluation n’est infaillible, et il y a toujours des gens qui, bien que n’y ayant pas droit, arrivent à percevoir des prestations, surtout dans les pays où l’économie informelle occupe une grande place. Cela coûte cher et suscite en outre de la défiance. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui, alors qu’ils sont dans le besoin, ne reçoivent aucune aide, et ce pour une ou plusieurs des raisons suivantes:
- ils répugnent à solliciter une aide;
- ils ne sont pas au courant de leurs droits;
- ils se heurtent à des formalités longues et compliquées;
- l’aide sociale dépend souvent du bon vouloir de l’administration, ce qui ouvre la voie au favoritisme, au clientélisme, à la discrimination.
Une évaluation rigoureuse des ressources risque de décourager les gens, y compris ceux qui sont dans le besoin. L’autosélection est souvent préférable, surtout dans les pays en développement. C’est la méthode généralement utilisée dans les projets à forte intensité de main-d’œuvre et pour l’aide alimentaire de base.
L’aide sociale assujettie à condition de ressources présente un autre inconvénient majeur: elle risque de pousser les gens à ne pas épargner s’ils pensent que cette épargne les privera des allocations auxquelles ils auraient droit. Elle risque aussi de les dissuader de s’affilier à d’autres systèmes de protection sociale. Cette formule risque donc d’avoir des effets pervers.
Toutefois, l’aide sociale peut s’avérer utile pour certains groupes vulnérables, comme les personnes âgées et les enfants. C’est parfois la seule solution pour les veuves qui n’ont pas pu s’affilier à un régime de pensions ou dont le mari n’avait pas de pension de survivants. En outre, c’est souvent un moyen d’aider les ménages pauvres avec enfants; dans bien des pays, seules les familles dont les enfants vont à l’école ont désormais droit à ces allocations.
Liens entre les différentes composantes de la protection sociale
La plupart des systèmes de protection sociale sont des systèmes mixtes, avec des liens entre leurs différentes composantes. Certaines prestations servent à en compléter d’autres. Ainsi, les prestations des régimes contributifs obligatoires complètent parfois les prestations universelles. Les prestations des régimes contributifs facultatifs ont parfois pour but de compléter l’un ou l’autre de ces types de prestations, voire les deux. Le lien entre l’aide sociale et les autres composantes de la protection sociale est, bien sûr, tout à fait différent. Lorsqu’une personne a droit à la fois à l’aide sociale et à d’autres prestations, ces dernières sont automatiquement déduites du montant de l’aide sociale auquel elle a droit. Lorsqu’il s’agit de prestations de régimes contributifs, cette personne aura en fait cotisé pour rien.
Il faut donc bien réfléchir aux liens entre les prestations assujetties à condition de ressources et les systèmes contributifs. On s’interrogera notamment sur l’ordre dans lequel il faut instituer l’aide sociale et les régimes contributifs, sur l’importance relative des prestations fournies par chacun de ces deux systèmes, et sur la différenciation éventuelle des conditions d’octroi des prestations (comme l’âge de la pension). Ce sont des questions difficiles. Les décideurs qui sont au fait de ces problèmes seront sans doute davantage prêts à envisager des régimes universels afin de réduire les effets pervers.
La protection sociale est en évolution constante et son orientation dépend souvent étroitement du passé. Les décideurs doivent prendre conscience de ces liens dynamiques, s’ils ne veulent pas que le résultat final de leurs décisions soit contraire à leurs intentions. Ils peuvent, par exemple, vouloir encourager la mise en place de systèmes contributifs, compte tenu des nombreux avantages de ces systèmes. Toutefois, si ces systèmes échouent – ce qui risque fort d’arriver dans un environnement non réglementé – la confiance de la population s’en ressentira durablement. Autre exemple: les politiques fiscales peuvent aboutir à la création de régimes contributifs facultatifs pour certains travailleurs, créant ainsi des intérêts (notamment parmi les institutions financières qui les gèrent) qui s’opposeront à la création d’un système de sécurité sociale national s’appliquant à l’ensemble des travailleurs.
Etant donné ces différents liens, il est nécessaire d’élaborer une politique publique globale en matière de protection sociale, de définir des priorités et de préciser la participation financière de l’Etat. Il faut déterminer les institutions qui serviront de relais pour les subventions de l’Etat et définir les catégories de population qui en bénéficieront. Il faut également reconnaître les complémentarités possibles, comme celle qui existe entre le soutien à la création de services de soins de santé et le soutien à la création de mécanismes d’assurance.
Ce sont souvent les segments économiquement les plus faibles de la société qui ne bénéficient d’aucune protection sociale. A long terme, il faudrait s’efforcer de les intégrer dans un système national qui couvre la population tout entière (ou la main-d’œuvre tout entière, selon le cas) et où ils pourraient bénéficier d’un partage des risques et de la solidarité. A moyen terme, cela est peut-être possible pour les pays en développement à revenu intermédiaire, mais pas pour les pays à bas revenu. Ces systèmes sont difficiles à mettre en place, surtout pour certaines catégories de travailleurs indépendants, mais il faudrait prévoir (et inclure dans la législation) des mesures visant à étendre la couverture obligatoire de manière progressive, du moins à l’ensemble des salariés. L’Etat pourrait faciliter et soutenir les systèmes de microassurance destinés à ceux que les systèmes obligatoires sont incapables d’atteindre pour le moment, même si, de toute évidence, beaucoup de ceux qui sont le plus dans le besoin ne voudront ou ne pourront jamais contribuer à ces systèmes et ne bénéficieront donc pas des aides de l’Etat. Il faudrait aider les systèmes de microassurance à se développer d’une manière qui facilite leur intégration éventuelle dans le système national et, pour finir, la généralisation de la couverture obligatoire.
Les régimes contributifs mis à part, les autres grands types de protection sociale sont financés par les recettes générales de l’Etat et peuvent prendre la forme de prestations assujetties à condition de ressources ou de prestations universelles. Les gouvernements des pays en développement n’ont guère avancé sur ce plan, les programmes d’ajustement structurel les obligeant souvent à réduire leurs dépenses. Toutefois, ces prestations ne sont pas nécessairement coûteuses: la catégorie des ayants droit peut être définie de façon restrictive, du moins dans un premier temps, de façon à réduire l’impact sur le budget de l’Etat. Lorsque les prestations auront montré leur efficacité et obtenu l’appui des politiques, on devrait pouvoir leur consacrer davantage de ressources et délimiter la couverture de façon moins restrictive. Ces prestations fournies par l’Etat peuvent, les unes comme les autres, aider les plus démunis. Bien que plus coûteux dans l’ensemble, les régimes universels sont faciles à administrer et peuvent permettre aux particuliers de renforcer la sécurité de leur revenu et celle de leurs familles. Ces systèmes peuvent puissamment aider à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et généralement parlant, à renforcer l’autonomie des individus, car ils les libèrent de la pauvreté sans les soumettre aux restrictions et conditions qui vont généralement de pair avec l’aide sociale.
Le but de la protection sociale n’est pas la simple survie, mais l’inclusion sociale et le respect de la dignité humaine. Les gouvernements qui s’efforcent d’étendre la couverture sociale devraient étudier l’expérience des pays où la sécurité sociale est bien enracinée. L’extension de la protection sociale est une tâche énorme pour laquelle ils auront besoin de tout le soutien de la population. Il n’existe pas de solutions toutes faites, et les chances de succès des différentes stratégies dépendront du contexte national. Des travaux de recherche plus approfondis et accompagnés d’expériences et d’innovations pourraient apporter aux responsables les éclaircissements nécessaires pour que tous les travailleurs et leurs familles bénéficient d’une couverture sociale décente.
Egalité entre hommes et femmes
L’égalité entre hommes et femmes est une question qui se pose dans quasiment tous les domaines de la protection sociale. Vu que les problèmes relatifs à l’inégalité de traitement sont aussi examinés dans d’autres chapitres, nous nous bornerons ici à donner un aperçu du sujet dans sa globalité.
Il convient de souligner pour commencer que, pour assurer l’égalité entre les sexes dans le domaine de la protection sociale, il ne suffit pas de garantir une égalité de traitement formelle entre hommes et femmes. Il faut également tenir dûment compte du rôle social respectif des hommes et des femmes, un rôle qui diffère selon la société considérée et qui connaît depuis quelques années des transformations extrêmement importantes dans un très grand nombre de pays. Ainsi, les systèmes de protection sociale devraient à la fois garantir l’égalité de traitement entre hommes et femmes, prendre en compte leur rôle respectif et promouvoir l’égalité entre les sexes.
Après un bref examen des dispositions des conventions et recommandations de l’OIT relatives à la sécurité sociale qui ont trait à la discrimination fondée sur le sexe, nous examinerons le lien entre protection sociale et égalité entre les sexes, ainsi que les conséquences sur les différentes formes de protection sociale des inégalités qui persistent sur le marché du travail. Nous indiquerons ensuite les mesures qui ont été ou pourraient être adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes par le biais de la protection sociale.
Assurer l’égalité entre les sexes dans les systèmes de sécurité sociale est une affaire complexe, une discrimination indirecte venant en effet s’ajouter à la discrimination directe dans ce domaine.
La discrimination directe se traduit par les éléments suivants: i) différences dans le traitement réservé aux personnes actives mariées selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, le postulat étant que les femmes se trouvent dans une situation de dépendance par rapport à leur époux, si bien que leurs droits à des prestations d’assurance sociale sont des droits dérivés découlant de l’assurance du conjoint plutôt que des droits propres découlant de leur propre assurance; ii) différences dans les taux de prestation ou de cotisation, qui sont fondés sur des calculs actuariels établis séparément pour les hommes et pour les femmes au regard de facteurs tels que les différences en matière d’espérance de vie, de taux de morbidité et d’invalidité, de régimes de travail prévus, etc. Ces différences sont caractéristiques des systèmes de comptes d’épargne individuels qui ne connaissent ni le principe de la compensation des charges ni celui de la solidarité.
La discrimination indirecte découle de mesures qui, souvent, n’établissent pas de distinction entre les sexes mais ont dans la pratique des conséquences différentes pour les femmes et pour les hommes selon la nature de leur activité professionnelle, leur état civil ou leur situation de famille. Les femmes sont nettement plus nombreuses à travailler dans les secteurs qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale (travail domestique, travail à temps partiel ou intermittent, activité dans l’économie informelle par exemple). Certaines conditions telles que des périodes d’affiliation minimum prolongées pénalisent aussi les femmes.
Beaucoup de femmes n’occupent pas d’emploi rémunéré pendant une grande partie de leur vie et se trouvent de ce fait dans une situation de dépendance économique par rapport à leur conjoint. Dans les systèmes de sécurité sociale fondés sur l’activité professionnelle, le principe des droits dérivés permet au conjoint qui se trouve dans une situation de dépendance de bénéficier de soins de santé et d’une pension de survivants. A cet égard, il convient d’examiner les aspects suivants: l’adaptation du concept de droits dérivés à une structure familiale en mutation (multiplication des couples en concubinage, divorcés et séparés notamment); l’évolution des principes fondant la protection sociale, qui implique un traitement identique pour les veufs et les veuves; la mise en place de mesures destinées aux parents isolés (dont les veuves constituent une sous-catégorie).
Normes internationales du travail et égalité entre hommes et femmes
A l’origine, les normes de l’OIT relatives aux femmes visaient avant tout à protéger la santé et la sécurité des travailleuses, ainsi que leurs conditions de travail et à répondre aux besoins particuliers liés à leur fonction dans la procréation. Avec le temps, la nature des normes a changé: les conventions visant à fournir une protection ont cédé le pas à des conventions destinées à garantir l’accès des femmes et des hommes aux mêmes droits et aux mêmes chances. L’adoption de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, a marqué un tournant dans la perception du rôle de la femme, ces textes prenant acte du fait que les responsabilités familiales concernent non seulement les travailleuses mais aussi l’ensemble de la famille et la société. Au milieu des années soixante-dix, une nouvelle approche plus ambitieuse visant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans tous les domaines a fait son apparition, ainsi qu’en témoignent les débats et les textes de la 60e session de la Conférence internationale du Travail, tenue en 1975. Depuis, la protection accordée aux travailleuses est fondée sur le principe que les femmes doivent être protégées contre les risques inhérents à leur emploi ou à leur profession, au même titre, et en application des mêmes normes, que les hommes. Les mesures de protection particulières encore admises sont celles qui visent à protéger le rôle de la femme dans la procréation.
La plupart des instruments de l’OIT relatifs à la sécurité sociale ne contiennent aucune disposition spécifique interdisant la discrimination fondée sur le sexe car ils ont été adoptés à une époque où, selon l’opinion dominante (qui était déjà souvent en porte à faux avec la réalité), c’était l’homme qui pourvoyait aux besoins du ménage, les femmes restant pour leur part à la maison pour s’occuper des enfants. Deux conventions interdisent cependant la discrimination. Il s’agit tout d’abord de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, qui établit que toute contribution doit être payée d’après le nombre total d’hommes et de femmes employés dans les entreprises intéressées, sans distinction de sexe. La seconde de ces conventions est la convention (nº 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, qui consacre l’obligation de garantir l’égalité de traitement à toutes les personnes protégées, sans discrimination fondée sur le sexe, entre autres, tout en autorisant les Etats Membres à adopter les mesures spéciales justifiées par la situation de groupes déterminés qui rencontrent des problèmes particuliers sur le marché du travail.
Il va sans dire que d’autres conventions de l’OIT, qui ne portent pas spécifiquement sur la sécurité sociale, interdisent expressément la discrimination fondée sur le sexe. Il s’agit des conventions nos 100, 111 et 156 qui ont déjà été mentionnées plus haut. La convention no 156, qui vise à assurer une égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, dispose que toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales doivent être prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne la sécurité sociale. La recommandation (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dispose pour sa part que tout individu devrait jouir, sans discrimination, de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les mesures de sécurité sociale.
La protection de la fonction de procréation des femmes et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sont des questions étroitement liées. Les prestations d’assurance maternité sont indispensables pour que les femmes et leur famille puissent conserver leur niveau de vie quand la mère n’est pas en mesure de travailler. Tout au long de son histoire, de l’adoption en 1919 de la convention nº 3 sur la protection de la maternité à celle, en 2000, de la convention nº 183 sur la protection de la maternité, et de la recommandation no 191, l’OIT s’est efforcée de garantir l’accès des travailleuses à de telles prestations.
Lien entre la protection sociale et l’égalité entre hommes et femmes
La plupart des régimes de sécurité sociale étaient autrefois fondés sur l’homme qui subvenait aux besoins du ménage. Ainsi, ces régimes accordaient souvent aux veuves des prestations qui n’étaient pas prévues dans le cas des veufs et, dans certains pays, les femmes mariées occupant un emploi rémunéré n’étaient pas obligées de contribuer à un régime de sécurité sociale. La prescription d’un âge ouvrant droit à pension inférieur dans le cas des femmes était aussi, dans une certaine mesure, le reflet d’un modèle dans lequel la participation des femmes à la population active était considérée comme secondaire. Aujourd’hui, alors que les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire partie de la population active rémunérée, la perception du rôle revenant à chacun des deux sexes a changé et les régimes de sécurité sociale font l’objet d’une réforme progressive.
Dans le domaine de la protection sociale, les efforts visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes peuvent être rangés dans deux catégories complémentaires:
- prescriptions ou mesures visant à égaliser les chances et à assurer que le traitement réservé aux hommes et aux femmes est le même, l’objectif étant de mettre fin aux pratiques discriminatoires dès la conception des programmes. Cependant, tant que les prestations de sécurité sociale sont liées à l’emploi sur le marché du travail, où les inégalités entre les sexes sont toujours nombreuses, les femmes demeurent pénalisées;
- prescriptions ou mesures visant à égaliser le niveau des revenus et à compenser les discriminations et les inégalités générées à l’extérieur des systèmes de sécurité sociale, sur le marché du travail par exemple.
Impact des inégalités du marché du travail sur la protection sociale
Les femmes sont souvent désavantagées sur le marché du travail. Leur situation est déterminée par une division du travail qui les condamne à assumer une partie très importante des services (non rémunérés) dont ont besoin les membres de la famille. Cette charge empêche souvent les femmes d’occuper ou de conserver un emploi à plein temps. Elle a une influence sur la nature des postes qu’elles peuvent accepter et sur le nombre d’années pendant lesquelles elles occupent un emploi couvert par la sécurité sociale. En outre, elle nuit souvent à leur niveau de revenu, à la poursuite de leur formation et à leurs perspectives de carrière. Même les femmes sans responsabilités familiales peuvent souffrir de cet état de choses si les employeurs auxquels elles ont affaire partent de l’hypothèse qu’elles finiront un jour ou l’autre par devoir assumer de telles charges.
Les conséquences pour les femmes des inégalités dont elles souffrent sur le marché du travail varient considérablement selon les types de régime de protection sociale. Elles sont particulièrement lourdes dans le cas des régimes professionnels de retraite ou de soins médicaux, car les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être exclues de ces régimes, soit qu’elles exercent des fonctions subalternes, soit que leur ancienneté soit insuffisante, soit encore qu’elles travaillent à temps partiel. Les régimes professionnels excluent également les travailleurs qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas couverts par les régimes d’assurance sociale. Les prestations servies par les régimes professionnels dépendent du niveau des gains et de l’ancienneté, deux critères qui tendent à favoriser les hommes. En outre, dans certains de ces régimes, les prestations dépendent de la rémunération reçue en fin de carrière, ce qui avantage tout particulièrement les salariés qui ont bénéficié de nombreuses promotions au sein de l’entreprise et ceux qui ont accumulé une période prolongée de service ininterrompu. Encore une fois, les hommes sont plus nombreux que les femmes à remplir ces conditions.
Plusieurs types de plans d’épargne-retraite tendent à refléter, voire à amplifier, les inégalités observées sur le marché du travail. Les personnes occupant des emplois précaires et peu payés, parmi lesquelles on trouve un nombre disproportionné de femmes, ont une capacité d’épargne limitée et en arrivent souvent à ne rien mettre de côté du tout, même dans les pays où la loi dispose en principe que l’affiliation à un régime d’épargne-retraite est obligatoire. Les personnes qui ont peu cotisé ou effectué des versements irréguliers obtiennent en général un rendement net inférieur, car, en raison des frais plus élevés occasionnés par les comptes les plus modestes, les coûts administratifs représentent une partie proportionnellement plus importante de leurs économies. Le principe de la solidarité et celui de la redistribution sont étrangers à la philosophie des plans d’épargne. Les femmes, dont l’espérance de vie est plus longue, reçoivent une retraite inférieure à celle des hommes pour un même niveau d’épargne.
Les systèmes d’assurance sociale excluent fréquemment des catégories telles que les travailleurs à domicile, les employés de maison et les travailleurs à temps partiel, parmi lesquels on trouve une forte proportion de femmes. Les travailleurs du secteur informel, secteur qui emploie un grand nombre de femmes pendant la plus grande partie de leur vie active, sont eux aussi dépourvus de protection. Les interruptions de carrière, la moindre durée de la période de cotisation et le niveau moins élevé de la rémunération sont autant de facteurs qui limitent les droits des femmes dans les régimes d’assurance sociale et autres systèmes liés à l’activité professionnelle. Cette règle vaut non seulement pour les retraites, mais aussi pour les prestations de chômage auxquelles un grand nombre de femmes sans emploi n’ont pas accès. Il est vrai que les chômeuses célibataires peuvent avoir droit à une aide sociale, mais celle-ci est en général moins élevée et soumise à un grand nombre de conditions restrictives. Si les femmes vivent en couple, c’est l’ensemble des ressources du ménage qui sont prises en compte, ce qui exclut généralement les intéressées de l’aide sociale. Cependant, les régimes d’assurance sociale présentent certaines caractéristiques propres à atténuer les inégalités du marché du travail telles que la détermination d’un niveau de retraite minimum ou la formule de pondération des prestations qui favorise les revenus peu élevés.
S’agissant des travailleurs de l’économie informelle, et notamment dans les pays en développement, les régimes de microassurance, dont certains prennent en compte spécifiquement les besoins des femmes, peuvent contribuer à combler les failles de la protection sociale. Cependant, étant donné le caractère facultatif de ces régimes, la redistribution systématique des hommes vers les femmes est limitée.
Les régimes universels – services nationaux de santé, allocations familiales, prestations de vieillesse universelles – accordent généralement les mêmes droits aux femmes et aux hommes, quels que soient leur parcours professionnel et le niveau de leur revenu. Comme l’indique le chapitre III, de tels systèmes peuvent beaucoup favoriser l’égalité entre hommes et femmes.
De leur côté, les régimes d’aide sociale peuvent consacrer expressément le principe de l’égalité de traitement et, comme ils pourvoient aux besoins des plus démunis, ils tendent à redistribuer le revenu en faveur des femmes – des femmes célibataires du moins. Cependant, les prestations d’aide sociale sont subordonnées à des conditions de ressources, le revenu de l’époux ou du compagnon étant lui aussi pris en compte. Le revenu des hommes étant généralement supérieur à celui des femmes, il résulte de cette règle, dans la pratique, que les femmes mariées ont moins de chances d’avoir droit aux prestations que les hommes mariés. En outre, lorsque l’homme parvient, dans un couple, à prouver qu’il a droit à des prestations d’aide sociale, l’élément des prestations destiné à couvrir les besoins de sa compagne est versée à son nom et non à celui de l’intéressée.
Enfin, il convient de rappeler que, si les inégalités sur le marché du travail ont des conséquences sur la protection sociale, la protection sociale a elle aussi des conséquences sur les inégalités du marché du travail. Ainsi, un système de prestations de chômage digne de ce nom (prévoyant à la fois une assurance chômage et une assistance chômage pour ceux qui n’ont pas droit à une telle assurance) atténue les problèmes des personnes occupant des emplois peu rémunérés et peu productifs. Les services de garde d’enfants et autres services sociaux sont eux aussi fondamentaux car ils aident les femmes à affronter la concurrence sur le marché du travail en les mettant dans une situation de plus grande égalité avec les hommes.
Promotion de l’égalité dans la protection sociale
et par la protection sociale
Toutes sortes de mesures de protection sociale ont été ou pourraient être utilisées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Nous examinerons cette question sous les rubriques suivantes:
- pensions de survivants;
- divorce et partage des droits à pension;
- âge ouvrant droit à pension;
- droits à pension pour les personnes ayant des responsabilités familiales;
- taux de pension différent selon le sexe;
- congé parental, allocations parentales et services de garde d’enfants;
- allocations familiales.
Les pensions de survivants sont fondées sur la notion de dépendance: le droit à prestations dépend des cotisations versées par le conjoint décédé lui-même ou en son nom; ce droit est une assurance contre la perte du soutien de famille et, dans un grand nombre de pays, il peut être suspendu si le bénéficiaire se remarie. Autrefois, les prestations de survivants étaient réservés aux veuves et aux orphelins, les veufs n’étant pas couverts, à moins de souffrir d’un handicap les plaçant dans une situation de dépendance par rapport à leur femme. Cette discrimination a disparu des systèmes de sécurité sociale d’un grand nombre de pays, parmi lesquels figurent les Etats-Unis et la plupart des Etats membres de l’Union européenne. La Cour européenne de justice a rendu en 1993 une décision établissant que la discrimination à l’égard des veufs au sein des régimes professionnels de retraite était illégale.
Du fait, essentiellement, de cette évolution, les prestations de survivants prévues par la loi ont été subordonnées dans une certaine mesure à des conditions de ressources, notamment en France, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède. Dans d’autres pays, les prestations ne sont versées qu’aux survivants qui ont atteint un certain âge (à partir duquel l’accès à l’emploi est jugé difficile) ou qui ont de jeunes enfants à charge. Du fait de ces restrictions, certaines femmes se trouvent dans une situation plus difficile qu’auparavant. Celles qui n’ont pas encore atteint l’âge prescrit peuvent avoir des difficultés réelles à trouver un emploi. Celles qui sont salariées et qui n’ont pas droit à une pension de survivants sont nombreuses à être confrontées à de graves difficultés financières après la mort de leur mari, car, dans la plupart des cas, le budget du ménage diminue alors de plus de moitié. Les mesures de restriction visaient avant tout à limiter l’augmentation du coût des prestations de survivants que devait entraîner l’élargissement de la couverture aux veufs. Il n’est pas inutile de rappeler que les mesures visant à assurer un traitement égal à tous les survivants sont apparues à une époque où les systèmes de sécurité sociale connaissaient déjà des difficultés financières. Cet aspect a donné lieu à un débat entre ceux qui estiment raisonnable d’attendre des femmes d’aujourd’hui qu’elles gagnent leur vie et ceux qui rappellent que les femmes qui se sont mariées au cours des décennies passées étaient nombreuses à avoir un autre projet de vie. Les femmes qui deviennent veuves aujourd’hui doivent-elles subir les conséquences de la mutation des valeurs et des mentalités?
Dans un grand nombre de régimes de pension, les femmes qui vivent en couple sans être mariées n’ont pas droit à une pension de survivants lorsque leur compagnon décède. Cependant, dans certains pays, elles reçoivent une pension si elles peuvent apporter la preuve de la situation de dépendance dans laquelle elles se trouvaient ou de la cohabitation passée. C’est notamment le cas au Costa Rica, au Danemark, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Venezuela.
La situation des veuves est autrement plus difficile dans les pays en développement, et notamment en Afrique et en Asie du Sud, que dans les pays développés, d’abord parce que les systèmes de sécurité sociale sont plus rudimentaires et ensuite parce que les veuves sont souvent victimes de pratiques discriminatoires, d’isolement social, voire de violences physiques. L’existence d’un système de pension universel (ou de prestations d’aide sociale qui ne sont pas subordonnées à des conditions trop restrictives) améliore dans une très large mesure la situation des veuves âgées, dont beaucoup n’ont droit à aucune prestation dans le cadre de régimes contributifs. Il convient toutefois de rappeler que les veuves sont souvent trop jeunes pour avoir droit à une pension de vieillesse, notamment dans les sociétés où les femmes se marient à peine nubiles et dans les pays où le SIDA et la guerre ont fait des ravages. (Le taux de mortalité élevé dû au SIDA, qui touche à la fois les hommes et les femmes, se traduit aussi par un grand nombre d’orphelins dont la plupart n’ont droit à aucune prestation). Plusieurs Etats de l’Inde ont élargi le champ des plans de pension assujettis à un plafond de ressources de sorte à couvrir les veuves dans le besoin, mais des problèmes d’application ont limité l’impact de ces mesures.
Divorce et partage des droits à pension
Depuis trente ou quarante ans, le taux de divorce est en augmentation rapide dans un grand nombre de pays industrialisés. Ainsi, au Canada et au Royaume-Uni, ce taux était six fois plus élevé en 1990 qu’en 1960. En République de Corée, en Thaïlande et au Venezuela, il a doublé entre le milieu des années soixante-dix et le milieu des années quatre-vingt-dix. Cette évolution a des conséquences importantes, notamment dans les cas des femmes qui n’ont jamais occupé d’emploi ouvrant droit à pension. Si leur ex-époux se remarie, ce qui est le cas de figure le plus fréquent, ces femmes peuvent perdre tout ou partie de leurs droits à une pension de réversion.
Pour traiter ce problème, plusieurs pays ont adapté leur système en instituant le partage des droits à pension: tous les droits à pension acquis par les deux époux pendant la durée de leur union sont additionnés puis divisés par deux. Cette formule est en vigueur depuis près de vingt-cinq ans dans les régimes de sécurité sociale de l’Allemagne et du Canada. Elle a été mise en place plus récemment en Afrique du Sud, en Irlande et en Suisse. Depuis quelque temps, elle semble aussi susciter l’intérêt s’agissant des régimes de retraite professionnels.
Dans de nombreux pays, l’âge de la retraite des femmes est inférieur à celui des hommes ou l’était encore récemment, comme le montre le tableau 4.1. Pourquoi les législateurs de ces pays, des hommes pour la très grande majorité, ont-ils donc décidé d’instituer cette différence? Pour certains, cela tiendrait au fait que les hommes épousent généralement des femmes un peu plus jeunes qu’eux et que les couples souhaitent souvent prendre leur retraite à peu près au même moment. Une autre explication possible est que l’on a voulu compenser la double charge que les femmes assument en cumulant activité professionnelle et entretien du ménage, une activité dont elles assument la plus grande partie.
Tableau
4.1. Différences
entre l’âge de la retraite des hommes et celui des femmes en 1999
Pays |
Hommes |
Femmes |
Afrique du Sud |
65 |
60 |
Algérie |
60 |
55 |
Arménie |
62 |
57 |
Australie |
65 |
61,5 (passera à 65 d’ici à 2013) |
Autriche |
65 |
60 |
Belgique |
65 |
61 (passera à 65 d’ici à 2009) |
Brésil |
65 |
60 |
Bulgarie |
60 |
55 |
Chili |
65 |
60 |
Chine |
60 |
50; 55 (pour les salariées) |
|
|
60 (pour les professions libérales) |
Colombie |
60 |
55 |
Cuba |
60 |
55 |
Hongrie |
60 (62 d’ici à 2009) |
57 (passera à 62 d’ici à 2009) |
Iran, République islamique d’ |
60 |
55 |
Iraq |
60 |
55 |
Israël |
65 |
60 (65 pour les femmes au foyer) |
Italie (ancienne loi, pour les personnes |
|
|
travaillant avant 1996) |
64 |
59 |
Pakistan |
60 |
55 |
Pologne |
65 |
60 |
Roumanie |
60 |
55 |
Royaume-Uni |
65 |
60 (passera à 65 d’ici à 2020) |
Fédération de Russie |
60 |
55 |
Slovaquie |
60 |
53-57 |
|
|
(selon le nombre d’enfants) |
Slovénie |
63 |
58 |
Soudan |
60 |
55 |
Suisse |
65 |
62 (passera à 64 d’ici à 2005) |
Turquie |
55 |
50 |
Ukraine |
60 |
55 |
Uruguay |
60 |
56 (passera à 60 d’ici à 2003) |
Venezuela |
60 |
55 |
Viet Nam |
60 |
55 |
Source: United States Social Security Administration: Social security programs throughout the world - 1999, (Washington, 1999). |
||
L’institution d’un âge de la retraite inférieur pour les femmes constitue une discrimination à l’encontre des hommes. Cette différence, lorsqu’elle existe encore, est aujourd’hui largement remise en question. Il ne fait aucun doute que les femmes assument une double charge de travail, mais rien ne permet de conclure que cette particularité a des conséquences sur leur capacité à continuer d’occuper un emploi aussi longtemps que les hommes. Leur espérance de vie, plus élevée, pourrait au contraire porter à penser le contraire. Un consensus semble se dessiner en faveur d’un âge de la retraite commun, une formule qui est déjà en vigueur en Allemagne, au Canada, aux Etats-Unis, en France, au Japon et dans un grand nombre d’autres pays. Souvent, toutefois, le débat fait rage sur l’âge auquel il convient de fixer le début de la retraite. Beaucoup de femmes sont peu disposées à voir cet âge augmenter ou à recevoir une retraite moins élevée si elles décident de prendre leur retraite à l’âge actuellement fixé, ce qui est compréhensible. D’un autre côté, la décision d’abaisser l’âge de la retraite des hommes serait extrêmement onéreuse. En tous les cas, cette mesure serait malvenue si l’on tient compte des prévisions relatives au ratio actifs/inactifs, prévisions qui donnent à penser qu’il faudrait relever, et non abaisser, l’âge de la retraite.
Un grand nombre des pays dans lesquels l’âge de la retraite a été revu à la hausse ont laissé place à une certaine souplesse en permettant aux travailleurs de cesser leur activité à l’âge fixé précédemment au prix d’une réduction actuarielle. Dans l’ensemble, les femmes se sont déclarées opposées aux propositions visant à relever l’âge auquel elles peuvent prendre leur retraite ou à réduire le niveau des prestations versées si la retraite est prise à l’âge fixé précédemment. Cependant, certaines travailleuses pourraient sortir gagnantes d’une telle réforme, qui peut leur permettre d’occuper un emploi plus longtemps qu’auparavant et d’accumuler de ce fait des droits à pension plus importants. Pour les femmes qui ont cessé de travailler pendant un temps pour s’occuper de leurs enfants, cet aménagement peut constituer un avantage véritable, pour autant, bien entendu, que les intéressées souhaitent continuer de travailler et qu’elles sont effectivement contraintes, dans les circonstances actuelles, de prendre leur retraite à l’âge prescrit. Pour être équitable, la décision de relever l’âge de la retraite doit être appliquée de façon progressive. Ainsi, une formule couramment suggérée en Europe centrale et orientale consiste à augmenter l’âge de la retraite de trois mois par an, ce qui revient à échelonner une augmentation de cinq ans sur une période de vingt ans. De tels aménagements sont nécessaires pour laisser à la population active le temps de s’habituer au changement mais aussi pour que le marché du travail puisse s’adapter à son rythme. En effet, une augmentation plus rapide pourrait se traduire par une montée significative du chômage.
Droits à pension pour les personnes ayant des responsabilités familiales
Une fois à l’âge de la retraite, beaucoup de femmes se trouvent dépourvues ou presque de tout droit propre à pension, soit parce qu’elles se sont consacrées à leur famille sans en retirer la moindre rémunération et que cela les a empêchées d’intégrer la population active rémunérée, soit parce que leurs responsabilités familiales les ont reléguées à des emplois périphériques, qui sont peu rémunérés et ne sont pas couverts par les systèmes de sécurité sociale. Face à ce problème, un grand nombre de pays se sont dotés de dispositions en vertu desquelles les personnes qui restent au foyer pour s’occuper de jeunes enfants (ou d’autres personnes dépendantes) acquièrent des droits à pension pendant la période considérée au même titre que si elles avaient occupé un emploi et cotisé à la sécurité sociale. Parmi les pays dotés de telles dispositions figurent l’Allemagne, la Norvège, la Suède et la Suisse. L’Irlande et le Royaume-Uni ont mis en place une formule apparentée, par le biais d’une procédure au titre de la «protection des responsabilités familiales», en vertu de laquelle les années pour lesquelles le revenu est faible ou nul ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du montant de la pension. En 1996, l’Irlande a augmenté la durée de cette protection qui peut maintenant être accordée aux personnes s’occupant d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, contre 6 ans auparavant. Ces mesures contribuent à favoriser l’égalité entre les sexes, d’abord parce qu’elles accroissent la sécurité de revenu des femmes qui abandonnent leur activité professionnelle pour élever leurs enfants, et ensuite parce qu’elles sont aussi ouvertes aux hommes qui s’occupent de leurs enfants pendant que leur épouse poursuit sa carrière. Une autre démarche, qui contribue encore plus largement à l’égalité sur le marché du travail, consiste à offrir des services de garde d’enfants.
Taux de pension différent selon le sexe
Dans la plupart des systèmes d’épargne-retraite obligatoires en vigueur à ce jour, notamment en Amérique latine, les travailleurs qui décident de prendre leur retraite ont le choix entre deux formules: ils peuvent soit acheter une rente viagère, soit retirer l’argent accumulé sur leur compte de façon échelonnée. Dans ce type de système, et contrairement à ce qui est le cas dans les systèmes d’assurance sociale actuels, il n’y a ni compensation des charges ni solidarité entre les hommes et les femmes, dont l’espérance de vie moyenne est sensiblement plus longue. La législation en vigueur en Hongrie et en Pologne prévoit en revanche le versement obligatoire d’une rente viagère à un taux identique pour les hommes et pour les femmes. On peut penser toutefois qu’il pourra être difficile de faire appliquer cette législation par des sociétés privées qui affichent toutes une préférence marquée pour les clients de sexe masculin. Dans les pays d’Amérique latine considérés, l’écart entre la pension des hommes et celle des femmes peut encore augmenter non seulement du fait de l’introduction de paramètres liés au sexe – taux de pension moins élevés pour les femmes par exemple – mais aussi, peut-être, par suite du relèvement de l’âge prescrit pour le départ à la retraite des femmes et des réductions actuarielles qui en résultent pour les femmes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas retarder leur départ à la retraite.
Congé parental, allocations parentales et services de garde d’enfants
La sécurité sociale peut promouvoir l’égalité entre les sexes en prévoyant une compensation au profit des personnes qui se sont consacrées à l’entretien du ménage sans en retirer de rémunération et qui ont de ce fait été exclues pendant un certain temps de l’emploi ouvrant droit à pension. Elle peut aussi faciliter la vie des hommes et des femmes qui souhaitent s’occuper de leur famille sans pour autant renoncer à leur profession. Le congé parental et les allocations parentales (qui compensent la perte de gain) peuvent contribuer pour une part importante à la réalisation de cet objectif dans la mesure où:
- ils sont accessibles à la mère ou au père ou sont partagés par le couple;
- ils prévoient généralement un certain nombre de jours par an pendant lesquels l’un ou l’autre des parents peut s’absenter de son travail pour s’occuper d’un enfant malade.
La fourniture de services de garde d’enfants, de bonne qualité et à un prix raisonnable, souvent sous l’égide des institutions de la sécurité sociale ou d’organismes dispensant des services sociaux, joue également un rôle important pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Ces services sont devenus de plus en plus nécessaires au fur et à mesure de l’augmentation du taux d’activité des femmes. Dans un grand nombre de pays, la proportion de la population active qui a du mal à concilier activité professionnelle et responsabilités familiales est en hausse.
Les allocations familiales favorisent également l’égalité entre les sexes, et ce à plus d’un titre. C’est une prestation qui, de nos jours, est généralement versée à celui des parents qui s’occupe effectivement de l’enfant. C’est un point important vu que la répartition du revenu dans les familles où seul l’un des parents est rémunéré est souvent très inégale et que le parent soutien de famille peut abuser de sa position dominante. Les allocations familiales sont pratique courante dans les pays industrialisés mais sont l’exception plutôt que la règle dans les pays en développement.
Ces dernières années, la proportion de familles monoparentales a beaucoup augmenté. Depuis les années soixante, elle a plus que doublé dans des pays tels que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. Cette évolution découle de l’augmentation considérable des naissances chez les femmes non mariées (par exemple, multiplication par 5 ou plus dans les pays susmentionnés) et de la progression du taux de divorce. La grande majorité des parents isolés sont des femmes, jeunes pour la plupart. En raison du coût élevé des gardes d’enfants dans beaucoup de pays et de l’accès limité des jeunes mères à des emplois suffisamment bien rémunérés, les intéressées n’ont souvent d’autre solution que de rester à la maison avec leur enfant, leur subsistance étant assurée dès lors par l’aide sociale ou d’autres prestations subordonnées à un plafond de ressources. Toutefois, si une allocation familiale leur était versée, ces mères pourraient s’en sortir en ajoutant ces ressources au revenu d’un emploi. Pour celles qui essaient de se lancer dans une profession et en sont encore à leurs tout premiers pas, c’est-à-dire à une étape décisive, le fait de pouvoir décider d’accepter ou de conserver un emploi peut avoir une influence fondamentale sur le niveau potentiel de leur rémunération à venir.
Dans les pays en développement, le versement d’une allocation familiale subordonnée à la fréquentation scolaire peut contribuer efficacement à garantir l’accès à l’éducation des filles et des garçons et à lutter contre le fléau que constitue le travail des enfants. Les prestations peuvent prendre la forme de la gratuité des frais de scolarité; c’est sans doute le meilleur moyen de favoriser la scolarisation des enfants. L’expérience montre que le versement de subventions en espèces aux familles et aux enfants peut utilement contribuer à inciter les familles à soustraire leurs enfants du monde du travail pour les envoyer à l’école. Lorsque cela est possible, ces mesures devraient être soutenues par d’autres dispositions propres à encourager les enfants à se rendre à l’école et à faire preuve d’assiduité (par exemple distribution de repas, de livres, d’uniformes, de cahiers et de crayons et accès à des services de transport, de logement et d’orientation).
Ainsi, un programme mis en place au Brésil (Bolsa Escola) montre que l’octroi de bourses encourage les familles particulièrement démunies à scolariser leurs enfants. Ce programme a notamment permis à des enfants pauvres de continuer à fréquenter l’école malgré des résultats insuffisants, qui auraient pu les en chasser. Pour l’instant, il ne concerne qu’un très petit nombre de familles et ne suffit pas à tirer les intéressés de la pauvreté car le montant versé reste modeste, mais une évaluation approfondie a montré que ses conséquences sur la vie des bénéficiaires sont considérables.
Les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale reflètent les opinions dominantes au moment de leur adoption et ne prévoient donc pas, pour la plupart, l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, même si certains instruments évoquent brièvement cet aspect.
La sécurité sociale peut contribuer à l’égalité entre les hommes et les femmes:
- en s’étendant à l’ensemble des travailleurs ou, du moins, à l’ensemble des salariés, y compris les catégories dans lesquelles les femmes sont particulièrement nombreuses;
- en aidant les hommes et les femmes à concilier activité professionnelle et responsabilités familiales, notamment par le biais de congés parentaux et d’allocations familiales;
- en reconnaissant à sa juste valeur le temps passé à élever des enfants sans contrepartie financière, que ce soit en accordant aux intéressés certains droits à pension dans le cadre des régimes contributifs ou en fournissant des prestations universelles;
- en accordant aux conjoints qui se trouvent dans une situation de dépendance des droits propres, ce qui les protège en cas de séparation ou de divorce.
Les mesures visant à assurer l’égalité entre les sexes pour ce qui touche, par exemple, à l’âge de la retraite ou aux prestations de survivants peuvent avoir pour effet de réduire les droits des femmes. Lorsque de telles réformes sont jugées inévitables pour des raisons économiques ou autres, il faut veiller à ménager une transition suffisante.
Enfin, tout projet de réforme de la sécurité sociale doit faire l’objet d’un examen minutieux qui permettra d’identifier les conséquences néfastes qu’il pourrait avoir pour les femmes et pour l’égalité entre les sexes.
Financement de la sécurité sociale
Beaucoup de régimes nationaux actuels de sécurité sociale – régimes le plus souvent financés par répartition – sont aujourd’hui la cible des critiques: leur viabilité financière serait en péril, de même que leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions, et ce du fait du vieillissement de la population, de la concurrence qui caractérise la nouvelle économie mondiale et de l’expansion de l’économie informelle. Le présent chapitre s’attache avant tout à montrer que le niveau des dépenses considéré comme acceptable dans le cas de la protection sociale dépend bien plus des préférences nationales en matière de politique des revenus que des impératifs économiques. Certes, il est des pays qui ne peuvent se permettre certains transferts sociaux, mais rares sont ceux qui sont trop pauvres pour empêcher, par un partage des ressources, qu’une partie de leur population vive dans la misère. Cela dit, il est indubitable que la mondialisation a un effet sur les différentes options qui peuvent être prises.
Evolution des dépenses de sécurité sociale
Partout dans le monde, les dépenses de sécurité sociale sont en hausse depuis des décennies. En pourcentage du PIB, elles ont considérablement augmenté dans les pays à économie de marché durant les années soixante et soixante-dix avant de plus ou moins se stabiliser pendant la seconde moitié des années quatre-vingt et la plus grande partie des années quatre-vingt-dix. Au milieu des années quatre-vingt-dix, elles représentaient 18 pour cent environ du PIB dans les pays de l’OCDE pris dans leur ensemble (25 pour cent dans les Etats membres de l’Union européenne). Au cours des années quatre-vingt-dix, la transition économique a mis à rude épreuve les systèmes de transferts sociaux des pays anciennement planifiés, ce qui n’a pas empêché les dépenses de sécurité sociale de se maintenir aux alentours 15 à 20 pour cent du PIB (non compris la subvention de certains biens et services), alors même que le PIB diminuait. La situation des pays en développement est moins homogène. En règle générale, les dépenses ont augmenté au cours des dernières décennies. Cependant, avant le début de cette progression, leur niveau était dans l’ensemble dix fois inférieur à celui que les pays développés avaient atteint dès les années soixante, et les dépenses actuelles demeurent de trois à cinq fois inférieures à celles des pays développés. Le tableau 5.1 indique, en pourcentage du PIB, le niveau des dépenses de sécurité sociale dans le monde et dans les différentes régions en 1990, dernière année pour laquelle des données relativement complètes sont disponibles(15). Ces chiffres sont certes d’utiles indicateurs, mais ils ne permettent pas de savoir si les ressources sont redistribuées de façon équitable entre les différentes catégories de la population et si cette distribution est gérée de façon rationnelle.
Tableau
5.1. Dépenses
de sécurité sociale, en pourcentage du PIB, 1990
Région1 |
Dépenses totales |
Pensions |
Soins de santé |
Total mondial |
14,5 |
6,6 |
4,9 |
Afrique |
4,3 |
1,4 |
1,7 |
Amérique latine et Caraïbes |
8,8 |
2,1 |
2,8 |
Amérique du Nord |
16,6 |
7,1 |
7,5 |
Asie |
6,4 |
3,0 |
2,7 |
Europe |
24,8 |
12,1 |
6,3 |
Océanie et Australie |
16,1 |
4,9 |
5,6 |
1 Ces moyennes tiennent compte uniquement des pays pour lesquels
des données sont disponibles. Pour savoir quels sont les pays regroupés
dans les différentes régions, voir l’annexe statistique figurant
à la fin du présent rapport.
Source: Rapport sur le travail dans le
monde. 2000, op. cit., annexe statistique,
tableau 14.
Si les circonstances restent inchangées, les dépenses sociales devraient continuer d’augmenter pendant encore un certain temps. Dans les pays en développement, les régimes existants doivent encore parvenir à maturité, leur champ va s’élargir et de nouveaux régimes seront mis en place. Dans les pays plus avancés, les dépenses de sécurité sociale pourraient encore augmenter si le ratio inactifs/actifs continue de croître. Ce ratio restera élevé, voire augmentera, si le taux d’activité des femmes reste relativement peu élevé par rapport à celui des hommes dans certaines grandes économies, si l’âge moyen de l’entrée sur le marché du travail continue de s’élever et si l’âge de la retraite effective continue de diminuer.
On entend souvent dire qu’il existe une relation directe entre le niveau des dépenses sociales et le niveau du PIB, c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’en s’enrichissant les pays tendent à consacrer davantage de ressources à la sécurité sociale. La figure 5.1 montre que cette affirmation ne contient qu’une part de vérité. Dans cette figure, le problème est présenté au moyen d’une régression classique à deux dimensions. Si la méthode utilisée est simple, les résultats n’en sont pas moins instructifs.
Figure 5.1. Relation entre les dépenses de sécurité sociale et le PIB par habitant de différents pays au milieu des années quatre-vingt-dix
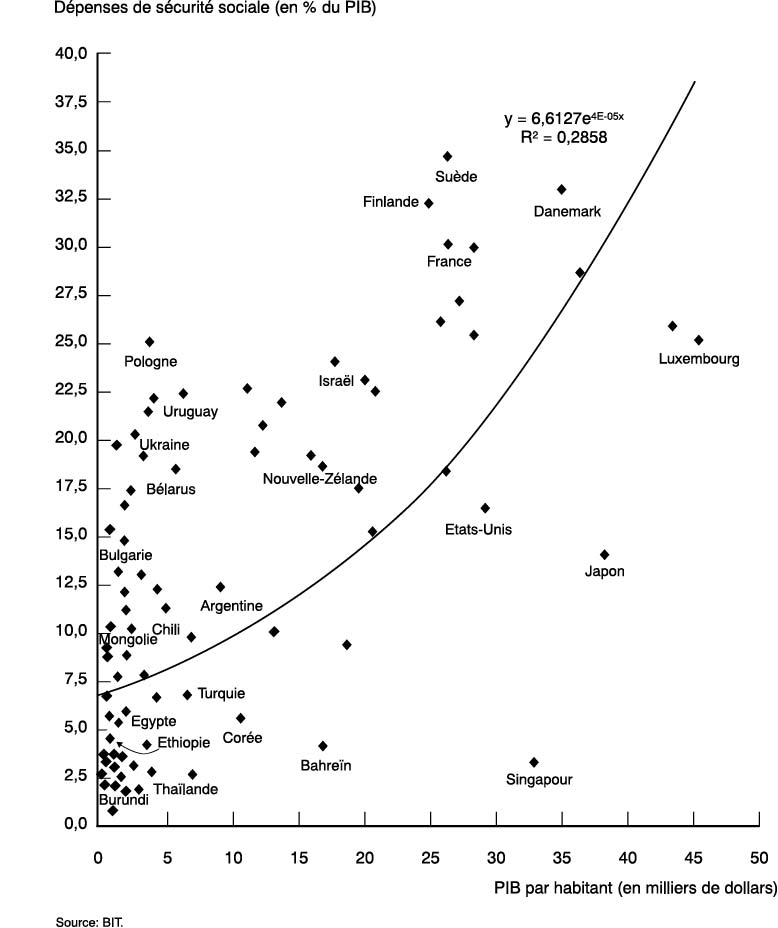
Il apparaît dans cette figure que la corrélation mathématique entre le PIB par habitant et les dépenses de sécurité sociale calculées en pourcentage du PIB est relativement faible (même alors que c’est une droite de régression non linéaire, c’est-à-dire exponentielle, qui est utilisée)(16). Le graphique montre que la situation est plus complexe qu’il n’y paraît. Certes, il ne fait aucun doute que le niveau des transferts assurés par la protection sociale est plus élevé dans les pays développés que dans les pays dont le revenu est faible. En effet, les pays à revenu très élevé et les pays à revenu très faible forment deux ensembles distincts autour de la droite de régression. Toutefois, aucun de ces deux ensembles n’est très dense, ce qui montre que le niveau des dépenses de sécurité sociale varie considérablement, même pour des pays ayant plus ou moins le même PIB par habitant. Il ne fait donc aucun doute que le niveau des dépenses sociales (mesuré en pourcentage du PIB) ne dépend pas du niveau du PIB, ou tout du moins pas exclusivement. Ainsi, des pays au revenu peu élevé peuvent décider de consacrer à la sécurité sociale un pourcentage de leur PIB comparable à celui que l’on observe dans des pays bien mieux lotis. Ces éléments tendent à prouver que les dépenses sociales sont dans une large mesure le reflet d’un choix politique.
Les systèmes actuels de financement de la protection sociale sont confrontés à trois grands défis. Certains disent qu’ils seraient inaptes à faire face au vieillissement de la population et à la mondialisation, et que la charge financière supportée par les cotisants et les contribuables aurait atteint le niveau maximum au-delà duquel elle ne serait plus supportable. Nous examinerons brièvement ces arguments, puis nous analyserons les options possibles au niveau national et international.
Vieillissement de la population
Le vieillissement – souvent présenté, à tort, comme le facteur clé pour le financement des systèmes de transferts sociaux – ne posera un problème majeur que si les sociétés qui connaissent un vieillissement rapide ne parviennent pas à maîtriser le taux global de dépendance sociale. Toutefois, même en Europe, où le processus de vieillissement en est à un stade relativement avancé, un relèvement de l’âge de la retraite et une augmentation du taux d’activité des femmes pourraient beaucoup réduire ce taux. Une société en phase de vieillissement n’est pas condamnée à la crise pour autant qu’elle parvient à fournir des emplois à des travailleurs toujours plus âgés. Grâce aux investissements massifs qui sont consacrés à la santé depuis plusieurs décennies par le biais de la protection sociale, la population reste en bonne santé jusqu’à un âge plus avancé et devrait donc être capable de travailler plus longtemps. En outre, la souplesse accrue des régimes de travail devrait permettre aux travailleurs qui ont des enfants ou qui ont atteint un âge avancé de bénéficier d’aménagements adaptés à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle. Des calculs du BIT montrent qu’en 1995, dans un pays européen ayant un taux de vieillissement rapide, un âge de la retraite effectif de 60 ans et un taux d’activité des femmes comparable à celui des Pays-Bas, le ratio de dépendance calculé en prenant en compte à la fois les chômeurs et les retraités aurait été de l’ordre de 62 dépendants pour 100 personnes occupant un emploi. Si, dans ce pays, l’âge de la retraite effectif passait à 67 ans d’ici à 2030 et que le taux d’activité des femmes atteignait un niveau comparable aux taux les plus élevés observés aujourd’hui en Europe (niveau de la Suède par exemple), le ratio de dépendance atteindrait, en 2030, 68 pour cent. Si rien ne venait à changer, il serait de 80 pour cent, soit près de 18 pour cent de plus. L’emploi est un élément déterminant pour le financement futur de la protection sociale dans tous les pays. Le vieillissement ne doit pas être considéré comme une menace mettant forcément en péril les systèmes de sécurité sociale mais comme un défi pour les politiques économiques et sociales et pour le marché du travail.
L’annexe statistique montre que c’est dans certains des pays dont l’économie est particulièrement ouverte que les dépenses sociales sont les plus élevées (c’est le cas, notamment, de la plupart des pays nordiques, de l’Allemagne, de l’Autriche et des Pays-Bas). Il n’y a aucune raison pour que la mondialisation conduise les économies nationales à réduire ces dépenses. C’est, au contraire, à un renforcement de la protection sociale que l’on pourrait s’attendre dans les pays qui sont particulièrement exposés aux risques extérieurs ou qui s’apprêtent à des ajustements structurels difficiles.
Les données de l’annexe reflètent la réalité économique du milieu des années quatre-vingt-dix. Depuis, le contexte politique s’est quelque peu modifié. La mondialisation, outre qu’elle se solde par des transferts de liquidités d’une région du monde à l’autre, a pour conséquence d’exposer des branches d’activité tout entières à une concurrence accrue qui se traduit par des pressions sur les coûts salariaux et sur les coûts de main-d’œuvre non salariaux et affecte dès lors les travailleurs. Les menaces de délocalisation ou la fermeture pure et simple des entreprises limitent la marge de manœuvre de l’Etat-nation sur le plan fiscal.
Face à ce problème, les pays infléchissent souvent leur politique fiscale en se tournant vers des sources de revenus qui ne sont pas soumises aux pressions de la mondialisation et dont l’imposition ne nuit pas à la compétitivité nationale ou en s’attachant à limiter les dépenses des régimes qui renchérissent apparemment les coûts de la main-d’œuvre. La plupart des pays les plus industrialisés ainsi qu’un grand nombre de pays en développement se sont fixé pour objectif de contenir le coût global de la main-d’œuvre. Pourtant, les économistes s’accordent très largement à penser que les cotisations sociales et les impôts ne déterminent pas le coût de la main-d’œuvre(17). Ce sont les marchés du travail qui établissent le niveau de la rémunération globale des salariés. Cependant, comme il est souvent difficile d’intervenir directement sur le niveau du salaire, qui constitue la part la plus importante de la rémunération globale, le débat sur le coût de main-d’œuvre se concentre souvent sur d’autres éléments, notamment sur les cotisations d’assurance sociale. En l’absence d’autres sources de financement, on tend à réduire le niveau des prestations des régimes publics de sécurité sociale.
La relative perte de souveraineté de l’Etat-nation en matière fiscale, du fait de la mondialisation, fait partie des grands défis auxquels les systèmes nationaux de protection sociale sont aujourd’hui confrontés.
Dans toutes les sociétés qui ont la volonté d’assurer à chacun des conditions de vie décentes, le revenu est partagé, à divers degrés et de façon plus ou moins transparente, entre ceux qui ont la capacité de gagner un revenu et les autres. Cependant, le niveau des transferts apparaissant dans les statistiques nationales ne semble pas totalement correspondre au potentiel économique des différents pays, ce qui laisse à penser que la mesure des transferts est très inexacte dans la plupart d’entre eux. La famille élargie et d’autres structures sociales fondées sur la parenté restent le principal véhicule des transferts dans certains pays; dans d’autres, les transferts passent essentiellement par des mécanismes institutionnels de redistribution – systèmes nationaux de retraite, par exemple. Dans l’ensemble, les écarts entre pays pour ce qui concerne les transferts sociaux sont certainement bien moins importants que ce qui apparaît dans les statistiques nationales ou internationales.
A titre d’illustration, supposons que la population active (chômeurs compris) gagne l’ensemble du revenu d’un pays (bénéfices et salaires) et qu’elle le partage avec les mineurs, les personnes inactives qui font partie du groupe d’âge des actifs et les retraités. Supposons aussi que la consommation d’une personne active par rapport à celle d’une personne inactive (dans une société assurant des conditions de vie décentes) soit de 1 pour 0,666(18). On peut alors calculer un ratio de transfert hypothétique pour des régions données. La figure 5.2 donne une estimation des transferts totaux (transferts figurant dans les statistiques, plus transferts informels, tels qu’estimés).
Figure 5.2. Estimation des transferts – total et composition – dans diverses régions au début des années quatre-vingt-dix
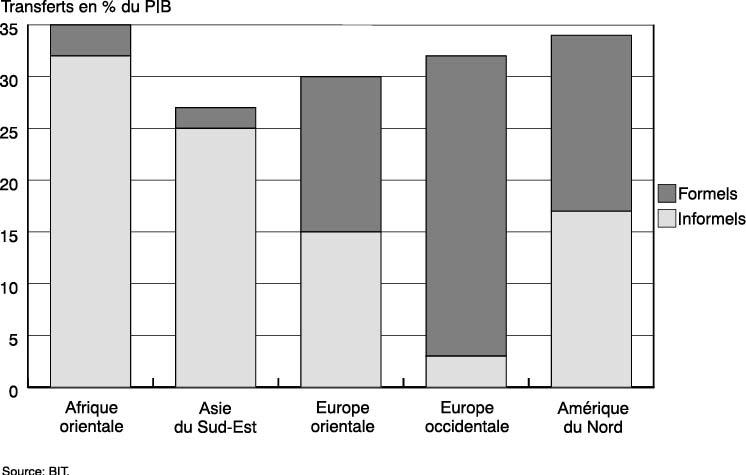
Il s’agit en partie d’une spéculation, les données disponibles étant insuffisantes. Il en ressort cependant que, dans le monde, à l’heure actuelle, seule la moitié environ de l’ensemble des transferts passe par les systèmes de protection sociale institutionnels et que la plupart de ces transferts institutionnalisés ont lieu en Europe. Dans les pays en développement, seule une petite partie des transferts passe par des systèmes organisés. Même dans les pays d’Europe occidentale, les dépenses institutionnelles de protection sociale sont inférieures à l’ensemble des transferts estimés.
On peut en conclure que, dans la plupart des pays (à l’exception peut-être des plus pauvres), la redistribution des ressources est plus importante que ce qui ressort des statistiques sur les transferts sociaux institutionnalisés. Rien ne permet d’affirmer que le niveau des transferts sociaux institutionnalisés ait atteint, dans quelque pays que ce soit, un niveau excessif par rapport au niveau de redistribution du revenu que la société juge nécessaire. La discussion sur le niveau de dépenses supportable en matière de protection sociale est donc en fait une discussion sur les mécanismes de redistribution auxquels il convient d’accorder la préférence.
Pour financer la protection sociale, chaque pays doit se doter de systèmes conformes à ses particularités sur le plan économique, à sa situation démographique et, plus important encore, aux préférences des citoyens. L’éventail des mécanismes de transfert possibles va des systèmes de transfert au sein des familles, dont toute composante institutionnelle est absente, aux systèmes universels financés par le budget général de l’Etat, en passant par toutes sortes d’autres options. Les choix et les objectifs de la nation transparaissent dans le système de financement choisi et dans le rôle respectif de l’Etat et du secteur privé. Ces choix et ces objectifs, souvent implicites, sont examinés ci-après.
Les paramètres suivants peuvent servir à différencier les systèmes de financement:
- degré de solidarité;
- niveau et mode de financement;
- sources de financement.
Solidarité
Le plus petit des groupes au sein desquels des transferts ont lieu est la famille nucléaire. On passe ensuite à la famille élargie ou au voisinage immédiat, puis aux associations locales ou professionnelles. A moins qu’ils ne soient prescrits par des dispositions légales particulières (dispositions du droit de la famille relatives au versement d’une pension alimentaire, par exemple), les transferts qui ont lieu au sein de la famille ou de la collectivité locale immédiate sont pour la plupart de nature non institutionnelle. L’importance de la solidarité au sein de ces entités varie beaucoup selon les valeurs qui les animent et les caractéristiques particulières de la famille ou de la collectivité considérée. Le droit de bénéficier de prestations n’est souvent pas clairement établi, même dans le cas des systèmes communautaires. Au sein de la collectivité, tout comme dans le cadre non institutionnalisé de la famille, le niveau des transferts dépend souvent du revenu total du groupe plutôt que des besoins particuliers des bénéficiaires potentiels.
Le système de l’assurance repose sur l’idée que la viabilité d’un régime s’accroît avec le nombre des personnes assurées. Les régimes nationaux ou les régimes d’assurances sociales qui couvrent un grand nombre de personnes peuvent normalement compter sur un revenu plus stable que les régimes qui ne concernent que des groupes de taille limitée et la variation du niveau total des prestations (c’est-à-dire le risque financier) est évidemment plus faible. Les petits groupes doivent souvent faire face à un cumul des risques – chômage dans un secteur, pauvreté dans une famille, épidémie dans une collectivité. Il apparaît en d’autres termes que, généralement, les grands systèmes sont plus efficaces, sous réserve d’être gérés de façon avisée. Lorsque la solidarité n’est plus le fait de la nation tout entière mais de groupes plus petits, la disparité des prestations s’accroît inévitablement. Dans de nombreuses régions du monde, il semble que la solidarité ne se retrouve plus qu’au sein de groupes de plus en plus restreints, une situation qui peut aboutir dans les cas extrêmes au système des comptes individuels. Une telle tendance débouche nécessairement sur un accroissement de l’incertitude et des inégalités de prestations.
Niveau et mode de financement
Les régimes de prestations à court terme (avec une exception non négligeable, celle des régimes d’assurance maladie privés) sont généralement financés par répartition quelle que soit l’importance de la compensation des risques. Les prestations à court terme correspondent à des engagements à court terme qui peuvent être modulés relativement rapidement lorsque les circonstances démographiques ou économiques changent. De ce fait, il n’est pas nécessaire d’accumuler des réserves importantes en prévision de responsabilités à assumer dans un futur éloigné. S’agissant des pensions, on distingue généralement trois systèmes de financement:
- répartition;
- capitalisation intégrale;
- capitalisation partielle.
Les régimes privés reposent généralement sur la capitalisation intégrale, c’est-à-dire qu’ils doivent disposer de ressources suffisantes pour pouvoir honorer leurs obligations dans l’hypothèse où la compagnie d’assurance, le régime professionnel de retraite ou l’organisme répondant d’un tel régime disparaîtrait. Les régimes publics de pension reposent sur un engagement social leur garantissant les liquidités nécessaires et, en principe, une durée de vie illimitée et n’ont pas besoin du même niveau de financement. Le niveau de financement des régimes de sécurité sociale dépend de considérations qui ne relèvent pas uniquement de la nécessité d’assumer financièrement les engagements pris en matière de pensions. La plupart de ces régimes sont en fait des régimes à capitalisation partielle. Même les régimes conçus à l’origine comme des régimes à capitalisation intégrale se sont souvent transformés en régimes à capitalisation partielle lorsque l’inflation a fait chuter la valeur de leurs réserves. Dernièrement, plusieurs pays dotés de systèmes de répartition à l’ancienne mode se sont adjoint un deuxième pilier à cotisations définies qui repose sur la capitalisation (Hongrie, Lettonie et Pologne). D’autres pays ont maintenant recours à des fonds de réserve dans le cadre de leurs régimes par répartition (Canada, France et Pays-Bas). D’un point de vue purement financier, il n’existe pas de différence véritable entre les régimes à prestations définies reposant sur la capitalisation partielle et les régimes de pension composés de deux piliers, dont l’un est fondé sur la capitalisation et l’autre non. En définitive, il s’agit dans les deux cas de régimes à capitalisation partielle.
Ces dernières années, on a beaucoup débattu au niveau international des avantages et des inconvénients d’un recours accru des régimes nationaux de pension à la capitalisation. A la différence des petits systèmes privés, les régimes de pension relevant de la sécurité sociale n’ont pas vraiment besoin de la sécurité financière que procure l’accumulation d’un volume de fonds important, mais des raisons d’un autre ordre sont souvent avancées pour défendre les bienfaits de la capitalisation appliquée à ce type de régimes. Selon ses partisans, la capitalisation peut augmenter l’épargne nationale. Il ressort pourtant du tableau 5.2 que cette affirmation n’est pas corroborée par les faits: il arrive que l’épargne nationale soit importante alors que les réserves accumulées par les systèmes de pension sont faibles, et vice versa. Il est souvent avancé, par ailleurs, que la capitalisation stimule la croissance des marchés financiers. Là encore, les données disponibles ne vont pas vraiment dans ce sens: dans plusieurs pays où les régimes de pension par capitalisation sont rares, voire inexistants, les marchés boursiers encore jeunes ont affiché des taux de croissance tout à fait remarquables.
Tableau
5.2. Taux d’épargne
nationale (1990-92) et réserve des régimes professionnels de retraite
(1990-91)
Pays |
Epargne
nationale |
Réserves
des régimes |
Allemagne |
23 |
4 |
Australie |
18 |
39 |
Canada |
15 |
35 |
Danemark |
19 |
60 |
Etats-Unis |
15 |
66 |
France |
21 |
3 |
Irlande |
20 |
37 |
Japon |
34 |
8 |
Pays-Bas |
25 |
76 |
Royaume-Uni |
14 |
73 |
Suisse |
30 |
70 |
Note: Le taux d’épargne correspond
à la somme de l’épargne publique et de l’épargne accumulée
par le secteur privé. |
||
On entend souvent dire que la capitalisation pourrait contribuer à mettre les régimes de retraite à l’abri des conséquences du vieillissement. Cette affirmation a sans doute du vrai dans le cas de petits groupes d’assurés mais elle perd de sa validité dès lors que l’on considère des sociétés nationales dans leur ensemble ou la totalité des habitants de la planète. Toute société doit consacrer un certain volume de ressources aux retraités pour que ceux-ci conservent un certain niveau de consommation. Le passage d’un système de financement fondé sur les salaires à un système fondé sur le capital ne change rien à l’essence du problème. Dans tous les cas, la consommation de la population retraitée doit être financée par le PIB généré par la population active (sauf vente d’actifs réels au reste du monde).
Il faut s’attendre à ce que les systèmes de retraite financés par capitalisation et ceux qui reposent sur la répartition soient tous les deux touchés par l’évolution démographique. Les systèmes par capitalisation sont fondés sur l’idée que, pour se constituer un revenu en espèces, les retraités peuvent, en quelque sorte, vendre leurs actifs aux générations encore en activité ou les utiliser comme garantie pour obtenir des prêts de ces générations. Si le nombre des acheteurs potentiels diminue, on peut s’attendre à ce que le prix des actifs diminue lui aussi, ce qui aura pour effet de faire chuter le revenu dont dispose la génération des vendeurs, c’est-à-dire les retraités.
Indépendamment du volume réel des transferts nécessaires pour financer la consommation des retraités, il se pourrait bien que les finances nationales soient mises à rude épreuve par l’abandon de la répartition au profit de la capitalisation, un cas de figure qui se présenterait par exemple dans les pays ayant décidé de remplacer leur système d’assurance sociale, dans sa totalité ou en partie, par des régimes au financement privé. En effet, pendant une phase de transition prolongée, il faudra à la fois que les travailleurs accumulent des fonds pour financer les retraites futures et que des pensions soient versées aux retraités. Pendant cette période, il n’est pas impossible que l’Etat révise les prestations d’assurances sociales à la baisse de sorte à réduire les frais et à limiter le volume des fonds manquants qu’il devra se procurer par le biais de l’impôt ou d’emprunts, ou encore en vendant des actifs.
Etant entendu que la capitalisation ne suffit pas en soi à accroître les ressources qui peuvent être allouées à la population dépendante et que les avantages économiques d’une telle formule ne sont pas certains, la seule raison pouvant justifier le passage d’un système par répartition à prestations définies à un régime par capitalisation à cotisations définies (comme c’est le cas en Amérique latine et dans certaines parties d’Europe de l’Est) est qu’une telle évolution permet de stabiliser le niveau de l’impôt ou des cotisations de sécurité sociale. Cependant, comme le niveau des prestations dépend dès lors de la performance des marchés financiers sur le long terme, la certitude quant au niveau des cotisations ou de l’impôt s’accompagne d’une incertitude s’agissant du niveau des prestations. Une telle évolution suppose un renversement absolu des priorités.
Sources de financement
En général, les systèmes nationaux de sécurité sociale sont financés principalement par les sources suivantes:
- cotisations versées par les employeurs et/ou les travailleurs;
- impôts (fraction des recettes budgétaires générales ou impôts affectés);
- revenu des placements;
- mises de fonds privés ou primes d’assurance.
Dans les faits, les systèmes nationaux de sécurité sociale sont pour la plupart financés par plusieurs sources à la fois (voir tableau 5.3). Cette règle vaut également dans le cas des sous-systèmes tels que les régimes de retraite.
Tableau
5.3. Taux de cotisation
actuel dans les régimes nationaux de retraite de la sécurité
sociale d’un certain nombre
de pays
|
Taux
de cotisationtotal |
Part employeur (%) |
Part |
Contribution de l’Etat |
Allemagne |
19,5 |
9,75 |
9,75 |
Coût des prestations autres que les prestations d’assurances |
Belgique |
16,36 |
8,86 |
7,5 |
Subventions annuelles |
Corée, République de |
9 |
4,5 |
4,5 |
Une partie des coûts administratifs |
Etats-Unis |
12,4 |
6,2 |
6,2 |
Coût des prestations spéciales et des allocations soumises à des conditions de ressources |
France |
14,75 |
8,2 |
6,55 |
Subventions de niveau variable |
Gabon |
7,5 |
5 |
2,5 |
Aucune |
Italie |
32,7 |
23,81 |
8,89 |
Coût des prestations d’assistance sociale plus déficit global |
Luxembourg |
24 |
8 |
8 |
8 % de la rémunération assurable |
Pakistan |
5 |
5 |
0 |
Selon les besoins |
Pologne |
32,52 |
16,26 |
16,26 |
Fonds destinés à financer |
|
(Invalidité y compris) |
|
|
la pension de retraite minimum |
Trinité-et-Tobago |
8,4 |
5,6 |
2,8 |
Tous les coûts entraînés par les prestations d’aide sociale |
Source: United States Social Security Administration, op. cit. |
||||
Le débat suscité aujourd’hui par le niveau élevé des dépenses publiques consacrées à la sécurité sociale ne doit pas faire oublier que, dans bien des pays, le budget de l’Etat a largement bénéficié de l’existence d’un régime national de sécurité sociale. En effet, en période de forte croissance, les régimes de retraite et d’assurance chômage dont la création est récente génèrent généralement des profits importants car le nombre de pensions versées est peu élevé, voire nul, alors que la collecte des cotisations a déjà commencé. Ces bénéfices ont parfois été tout simplement absorbés par le budget général de l’Etat, que ce soit par des transferts directs (ce fut le cas notamment en Europe centrale et orientale) ou par des prêts (dans beaucoup de pays africains notamment). Un grand nombre de transferts n’ont jamais été suivis de remboursement et les prêts s’assortissaient de taux d’intérêt peu élevés (et souvent négatifs en termes réels). Dans ces cas, on peut dire que, dans une large mesure, les cotisations de sécurité sociale ont constitué un impôt supplémentaire.
L’Etat se juge souvent incapable de financer les dépenses de protection sociale par les recettes fiscales générales. Il décide donc habituellement d’adopter une législation spéciale en vertu de laquelle la sécurité sociale est financée par des cotisations obligatoires qui ne peuvent être affectées qu’aux objectifs précisés par ladite législation. L’Etat peut aussi charger des organismes privés de financer et de fournir des prestations de sécurité sociale ou abandonner la fourniture de l’ensemble des prestations à l’initiative privée. La fourniture de prestations par le secteur privé, qu’elle soit obligatoire ou volontaire, est souvent considérée comme une solution propre à limiter les dépenses publiques (qui comprennent, au sens large, les dépenses de sécurité sociale financées par des cotisations). Il serait toutefois erroné de penser que la fourniture de prestations par des acteurs privés reste sans effet sur les finances publiques, car il existe une relation indirecte évidente entre les différents instruments de financement de la protection sociale, que celle-ci soit dispensée par le secteur public ou par des acteurs privés. En effet, l’Etat est le garant de dernier ressort de la plupart des transferts sociaux. En outre, il existe un niveau maximum de charges sociales (publiques et privées) que la population peut accepter. Il semble probable que la plupart des citoyens qui sont contraints par la loi de verser une certaine somme d’argent n’auront pas de préférence quant à la nature de ces versements – cotisations ou impôt destinés à une institution publique ou primes encaissées par une institution privée – pour autant qu’ils se voient offrir des garanties équivalentes. Les citoyens sont prêts accepter un niveau global donné de charges sociales s’ils bénéficient en retour d’un certain niveau de protection. Si les charges dépassent un niveau acceptable, les finances publiques commencent à pâtir des retombées d’une évasion fiscale accrue. Il n’existe pas de règle générale permettant de savoir quel est le niveau acceptable des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt cumulés. Ce niveau doit être établi de façon empirique, sur le long terme, par le biais de processus visant à susciter un consensus politique.
Cependant, il semble que les différences entre les pays, ou tout du moins entre les pays présentant un niveau de développement identique, sont moins prononcées que ce que l’on pourrait penser. C’est ce que montre la figure 5.3, qui compare les dépenses sociales (en pourcentage du PIB) de deux pays industrialisés, les Etats-Unis et la Suède. Si les dépenses publiques brutes sont deux fois plus importantes en Suède qu’aux Etats-Unis, les dépenses sociales totales nettes atteignent plus ou moins le même ordre de grandeur dans ces deux pays. Deux éléments permettent d’expliquer ce phénomène: aux Etats-Unis, une part relativement importante des dépenses sociales, notamment dans le domaine de la santé et des retraites, est financée de façon privée, alors qu’en Suède une part assez considérable des dépenses sociales publiques est financée par l’impôt. Pour un montant total net comparable, ces deux pays présentent une situation très contrastée sur le plan social, notamment parce que les dépenses sociales privées sont réparties de façon bien plus inéquitable que les dépenses publiques.
Figure 5.3. Dépenses sociales en pourcentage du PIB, 1995
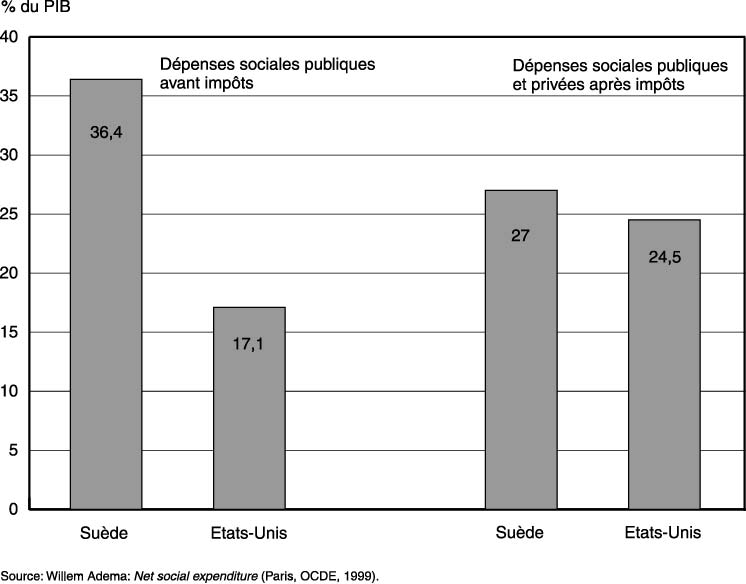
Rôle indispensable de l’Etat en tant que garant de dernier ressort
Outre la charge financière directe qu’il assume à titre ordinaire, l’Etat peut assumer des coûts indirects ou prendre en charge des coûts imprévus. Il joue un rôle important en tant que garant financier, ou assureur de dernière instance, dans le cas des régimes de sécurité sociale, voire des systèmes de sécurité sociale administrés par des organismes privés(19). La responsabilité de l’Etat peut se présenter sous différentes formes, explicites pour certaines, implicites pour d’autres. Il y a responsabilité explicite lorsque la loi relative à l’assurance sociale dispose que l’Etat a l’obligation de renflouer les déficits éventuels du régime. C’est le cas dans plusieurs pays, à la fois en Europe occidentale et en Europe centrale et orientale (en Bulgarie par exemple). L’Etat a aussi une responsabilité explicite lorsqu’un niveau minimum de prestations est prescrit car il doit alors compléter les pensions inférieures à ce niveau dès lors que le bénéficiaire répond aux conditions requises. Le poids de ces responsabilités éventuelles peut considérablement augmenter en cas de déclin généralisé du taux de rendement des réserves accumulées par les régimes de retraite et de diminution du prix des actifs que les crises boursières peuvent entraîner.
On peut parler de garantie implicite lorsque la pression politique est telle que l’Etat se trouve dans l’obligation de renflouer les régimes de sécurité sociale, les régimes restreints à un groupe donné ou les systèmes privés qui ne sont pas rentables (c’est ce qui s’est produit par exemple en Turquie dans le cas du régime Bag-Kur, le régime public destiné aux travailleurs indépendants). Même les Etats qui refuseraient, malgré les pressions, de renflouer un système confronté à de graves difficultés financières peuvent être contraints, pour finir, de débourser des sommes bien plus importantes sous la forme de prestations d’aide sociale accordées aux personnes dont les autres prestations (retraites ou prestations en espèces à court terme par exemple) ont été revues à la baisse ou demeurent impayées.
De la sorte, que ce soit par le biais de garanties financières explicites ou de garanties implicites, l’Etat se charge de la réassurance des systèmes de transferts sociaux publics et privés, même s’il ne finance pas directement les prestations correspondantes. L’Etat reste le garant de dernier ressort des régimes nationaux de sécurité sociale et doit exercer ses fonctions de contrôle en conséquence.
Mondialisation et financement de la sécurité sociale
Pendant longtemps, les Etats ont choisi leurs systèmes de protection sociale et leurs instruments de financement public en fonction de leurs seules préférences et du consensus auquel ils étaient parvenus à ce sujet. Aujourd’hui, la réalité du monde extérieur influe sur un grand nombre des décisions de politique intérieure. Pour l’instant, seule l’action gouvernementale peut contrebalancer cette influence extérieure, quoique de façon limitée. Or les Etats n’ont peut-être pas épuisé l’ensemble des mesures de politique intérieure qui pourraient leur permettre d’accroître les recettes et de limiter les coûts sans réduire de façon pure et simple le niveau de protection. Ainsi, le financement nécessaire pourrait être assuré désormais par les recettes fiscales ordinaires et par des impôts à la consommation spéciaux. Par ailleurs, des mesures visant à réduire le ratio de dépendance pourraient être adoptées (relèvement de l’âge de la retraite par exemple). Dans le même temps, les processus de production doivent être adaptés aux caractéristiques d’une main-d’œuvre plus âgée qu’auparavant.
Cependant, tout porte à croire que l’interdépendance accrue des marchés mondiaux modifiera encore la façon dont la protection sociale est financée. La mondialisation financière a progressé à vive allure ces dernières années et, dans le même temps, le rôle des marchés des capitaux dans le financement des régimes de retraite a gagné en importance. Plusieurs grands régimes de retraite dotés d’un second pilier jouent déjà un rôle considérable sur les marchés internationaux des capitaux, et les fonds de réserve des régimes de retraite publics (ceux du Canada, de la France et de l’Irlande par exemple) sont promis au même avenir. Comme les performances de ces marchés sont interdépendantes, les pensions de retraite d’un grand nombre de travailleurs du monde entier sont déjà étroitement liées. Si une grande place boursière s’effondre ou que le prix des actifs baisse sur plusieurs places boursières à la fois, des millions de travailleurs seront touchés en même temps dans le monde. Par ailleurs, un grand nombre d’emplois dépendent directement ou indirectement des décisions prises en matière d’investissement par les régimes de retraite des pays industrialisés. Les institutions financières internationales sont de plus en plus souvent amenées à accorder des prêts destinés à financer la mise en place ou la réforme de régimes de sécurité sociale. Prêts et dons internationaux alimentent des fonds de protection sociale nationaux ou régionaux. L’aide internationale peut prendre la forme de secours en cas de catastrophe et de subventions destinées à soutenir les systèmes nationaux de santé. Dans le cadre de l’initiative des pays pauvres très endettés (PPTE), le FMI et la Banque mondiale subordonnent tout allégement de la dette à la mise en place de mesures efficaces de lutte contre la pauvreté au niveau national. Pour l’instant, ces différents aménagements et initiatives ne sont pas coordonnés.
Selon des estimations récentes du BIT, une petite fraction du PIB mondial suffirait à tirer de leur condition la plupart des personnes qui vivent dans la misère dans les pays les plus pauvres de la planète. Pour les dirigeants, aux niveaux national et mondial, l’organisation ou la canalisation des transferts et la distribution des prestations constituent toujours un énorme défi. Avec leur campagne en faveur de l’allégement de la dette, les institutions financières internationales ont fait un premier pas. En 2000, lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies désignée sous le nom de «Sommet social + 5», les Etats intéressés ont été encouragés à envisager de créer un fonds mondial de solidarité, dont le financement serait facultatif et qui devrait soutenir la lutte contre la pauvreté et promouvoir le développement social dans les régions les plus pauvres du monde.
Il convient toutefois de souligner que c’est avant tout à chaque nation de veiller à élargir le champ de la sécurité sociale. La communauté internationale peut certes fournir une assistance sociale lorsque des crises éclatent et, bien sûr, une aide au développement, mais c’est à chaque pays de fournir l’effort continu qui est nécessaire.
Les dépenses de sécurité sociale sont appelées à augmenter en proportion du PIB, notamment dans les pays en développement, au fur et à mesure que les systèmes parviendront à maturité et que leur champ s’étendra. Dans les pays industrialisés, elles pourraient également continuer d’augmenter s’il se révèle impossible d’accroître le taux d’activité des femmes, des jeunes et des travailleurs âgés et de stabiliser ce faisant le ratio de dépendance entre personnes actives et personnes retraitées. Les solutions doivent dans tous les cas venir du marché du travail. Il faut trouver un emploi à tous les travailleurs.
La sécurité sociale repose essentiellement sur le principe de la mise en commun des risques et, d’une façon générale, plus les participants sont nombreux, plus le système est fiable. Le recours à des régimes visant des groupes limités ou à des plans d’épargnes individuels se traduit par une plus grande disparité des prestations et par un accroissement de l’incertitude, sauf si ces systèmes ont atteint une certaine stabilité ou qu’ils sont subventionnés par des ressources nationales, voire internationales.
Le recours à la capitalisation sera plus ou moins nécessaire et répandu selon la nature des prestations et les caractéristiques du régime considéré. Cependant, la capitalisation ne saurait résoudre en soi les problèmes financiers structurels des systèmes de transferts sociaux nationaux. D’un point de vue financier, budgétaire, économique et social, la seule stratégie fiable et propre à maintenir les dépenses de sécurité sociale à un niveau acceptable sur le long terme est celle qui vise à réduire les ratios de dépendance.
La protection sociale peut être fournie par des régimes de sécurité sociale ou par des régimes privés. Les pouvoirs publics jouent un rôle indispensable en leur qualité de garants financiers des régimes de sécurité sociale, et ils ont souvent des responsabilités explicites ou implicites lorsque les prestations sont fournies par le secteur privé. Les liens entre les différents instruments nationaux qui peuvent être utilisés pour financer la protection sociale sont nombreux. Ainsi, les décisions relatives au rôle des régimes privés ont des implications financières très importantes pour le financement des régimes publics, et pour le budget de l’Etat. Enfin, il n’existe pas de règle générale quant au niveau maximum que peuvent atteindre les cotisations de sécurité sociale obligatoires et l’impôt. L’importance des transferts sociaux qui ont cours dans un pays est le reflet des valeurs défendues par la société considérée plutôt que de ses moyens économiques.
Toutefois, le financement de la protection sociale pose à long terme un problème d’envergure mondiale et non pas simplement nationale. Si les acteurs économiques présents sur la scène mondiale peuvent saper librement, et dans une large mesure, la liberté d’action des Etats-nations s’agissant de la collecte de l’impôt et des cotisations de sécurité sociale, il faut s’attendre à ce que la sécurité sociale, dont le progrès a été si remarquable au XXe siècle, soit confrontée à des incertitudes considérables au XXIe siècle. Les Etats doivent unir leurs efforts pour tenter de protéger leur souveraineté dans ces domaines fondamentaux.
Renforcement et élargissement du dialogue social
La protection sociale, qui s’est développée sous différentes formes, en fonction des besoins des collectivités et de leur mode d’organisation socio-économique, peut être assurée par la famille ou par des réseaux de solidarité locale, par diverses institutions de la société civile, par les entreprises et le marché, par l’Etat. En outre, depuis quelques années, comme l’ont montré le Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) et les réunions organisées pour lui donner suite, la communauté internationale se soucie de plus en plus de la dimension sociale de la mondialisation.
Comme on l’a vu dans de précédents chapitres, la protection sociale, jusqu’ici limitée pour l’essentiel aux salariés du secteur formel, tend à s’étendre aux travailleurs indépendants et aux travailleurs occasionnels du secteur informel. Une gamme élargie d’acteurs sociaux pourrait donc devoir être prise en compte dans le financement et la gestion de la sécurité sociale. Dans ce chapitre, nous passerons en revue différents types de partenariat et de dialogue social qui pourraient aider à étendre à toute la population le champ de la protection sociale et accroître l’efficacité de celle-ci.
La protection sociale vise essentiellement à assurer la sécurité du revenu ainsi que l’accès aux soins de santé et à des services sociaux indispensables. Plusieurs acteurs interviennent: famille et réseaux de solidarité locale, institutions de la société civile, entreprises et marché, Etat et organismes de sécurité sociale, communauté internationale. Les partenaires sociaux – organisations d’employeurs et de travailleurs – jouent souvent un rôle important dans le développement et la gestion de la sécurité sociale ainsi que des régimes professionnels ou complémentaires dans le secteur formel. Les syndicats doivent s’attacher à étendre leur action au secteur informel. Les travailleurs de ce secteur peuvent-ils adhérer aux syndicats actuels? Dans la négative, que faut-il faire? Des structures et des stratégies de recrutement particulières sont-elles nécessaires? Pour être véritablement utiles à ces travailleurs, les syndicats doivent offrir des avantages tangibles et une protection accrue.
Dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, la famille joue un rôle clé dans la sécurité du revenu. Le partage des ressources à l’intérieur de la famille nucléaire pourvoit aux besoins des jeunes ainsi que des adultes – en général des femmes – qui s’occupent du foyer sans être rémunérés. C’est aussi de la famille que dépendent les enfants et, dans une moindre mesure, les parents âgés ou invalides. Dans certains pays d’Afrique et d’Asie, la famille élargie continue à jouer un rôle très important dans la sécurité du revenu des vieux, des malades et des invalides; ailleurs, son importance a beaucoup décru du fait de l’évolution sociale et démographique récente. Par le passé, une famille nombreuse était souvent la meilleure protection contre le dénuement durant la vieillesse, ce qu’elle demeure pour beaucoup de gens encore privés de toute sécurité sociale. Toutefois, il ne suffit pas que la famille soit nombreuse et ses revenus équitablement partagés: il faut aussi que ces revenus soient suffisants. Les familles les plus démunies peuvent parfois compter sur des mécanismes de solidarité locale.
Groupes d’entraide (pour des prestations en nature ou sous forme de travail), associations, coopératives, cantines, mutuelles, organismes caritatifs, églises: il existe dans la société civile toutes sortes d’institutions qui concourent à la sécurité du revenu des individus. Leur rôle et leur but diffèrent selon les pays et les conditions locales. Certaines garantissent des prestations qui s’ajoutent à celles des institutions publiques; d’autres assurent un minimum de protection à des gens par ailleurs totalement démunis. Leurs activités sont généralement régies par la loi et contrôlées par les pouvoirs publics, encore que certaines n’aient pas d’existence juridique (les groupes d’entraide par exemple).
Les prestations susceptibles d’être assurées sont très diverses: secours alimentaires, aide aux malades ou aux personnes âgées, assistance en cas d’invalidité ou de décès, etc. Les institutions sont généralement financées par les cotisations des membres, auxquelles s’ajoutent parfois des aides d’autres sources. Très proches des bénéficiaires, elles sont généralement en mesure de leur offrir des prestations qui répondent bien à leurs besoins prioritaires.
C’est de la mutualité, qui avait pris une grande extension, que sont nés certains régimes d’assurance sociale, lesquels ont fini par céder la place à des systèmes obligatoires de sécurité sociale. Dans certains pays, les mutuelles jouent toujours un rôle important, ajoutant leurs prestations à celles des régimes obligatoires, pour les soins médicaux ou la retraite par exemple. Dans d’autres, leur protection se limite à certains groupes. Dans l’ensemble, leur importance s’est accrue ces dernières années face aux phénomènes de marginalisation et aux carences de la protection instituée par la loi.
Entreprises commerciales et régimes professionnels
Il est possible de s’assurer un revenu stable, face à des éventualités telles que la vieillesse, l’invalidité ou le décès, en passant contrat avec des entreprises commerciales. Individuelle, la prévoyance comporte sous cette forme des coûts de transaction élevés et n’est généralement pas très répandue, sauf lorsqu’elle est rendue obligatoire ou lorsqu’elle s’assortit d’importants avantages fiscaux. Elle peut néanmoins avoir son importance pour les travailleurs indépendants, à défaut d’autres moyens de s’assurer une certaine sécurité.
La sécurité du revenu est aussi assurée, dans le secteur privé, par des régimes professionnels organisés au niveau de l’entreprise ou dans un cadre plus large. La gestion peut en être assumée directement par les entreprises ou confiée, dans le cas des plus petites, à des compagnies commerciales. Les coûts de transaction sont beaucoup moins élevés dans ces régimes que pour les contrats individuels. L’adhésion est en principe limitée au personnel des entreprises; il n’y a pas de frais commerciaux et le recouvrement des primes ou des cotisations ne pose pas de problème.
Généralement institués au départ à l’initiative des employeurs, les régimes professionnels le sont souvent aujourd’hui par voie de convention collective, quand ils n’ont pas été rendus obligatoires par la loi. Les organisations d’employeurs et les syndicats ont joué un grand rôle dans l’établissement de ces régimes, non seulement au niveau des entreprises mais aussi au niveau des secteurs ou branches. Ils ne se limitent pas à négocier l’établissement de tels régimes: ils participent aussi à leur gestion. Les régimes institués aux Etats-Unis dans certains secteurs sont entièrement administrés par les syndicats. Les fonds de pension pèsent de plus en plus lourd sur les marchés financiers – ils représentent des milliards de dollars – et beaucoup de syndicats nationaux s’efforcent d’obtenir que ces fonds soient placés au mieux des intérêts.
Etat et organismes de sécurité sociale
Dans la plupart des pays, la protection sociale relève essentiellement de l’Etat. Historiquement, le développement des systèmes nationaux de protection sociale traduit la volonté de garantir progressivement les mêmes droits à l’ensemble de la population, en harmonisant les régimes qui s’étaient mis en place dans certaines entreprises ou certains secteurs et en les rendant obligatoires.
La structure des régimes de sécurité sociale détermine souvent leur mode d’administration. Ainsi, les régimes qui offrent des prestations universelles soumises à condition de ressources sont le plus souvent administrés directement par l’Etat. Toutefois, plusieurs formules sont possibles, depuis l’administration directe par un ministère jusqu’à la gestion par le secteur privé. Dans les pays où l’assurance sociale (ou le principe contributif) est de tradition – France, Allemagne, majorité des pays d’Afrique, Asie, beaucoup de pays d’Amérique latine et des Caraïbes –, les régimes sont généralement administrés par une institution publique placée sous le contrôle d’un conseil de direction ou d’administration dont l’autonomie est toujours reconnue par la loi. Ce conseil est normalement bipartite ou tripartite; outre les employeurs, les travailleurs et l’Etat, d’autres parties prenantes (banquiers, médecins, etc.) peuvent y être représentés. L’administration quotidienne du régime est confiée à un directeur exécutif qui peut être nommé par le conseil ou par le ministre.
Dans certains pays en développement, en particulier, le morcellement de l’administration des régimes a été l’une des causes principales du manque de cohérence de la politique de protection sociale. Le ministère des Finances, notamment intéressé par le régime des retraites, a souvent une voix prépondérante. Divers autres ministères – Travail, Santé, Affaires sociales, etc. – peuvent être chargés de tels ou tels régimes, souvent gérés par des organismes distincts. En fonction du degré de décentralisation, les autorités locales peuvent aussi jouer un rôle propre, notamment en ce qui concerne l’aide sociale.
Depuis la fin des années quatre-vingt, il est de mieux en mieux admis que la communauté internationale a un rôle à jouer dans le domaine humanitaire et social. Sa mission humanitaire a été la première à être reconnue car, comme l’indique la résolution no 43/131 du 8 décembre 1988 de l’Assemblée générale des Nations Unies, «le fait de laisser les victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre sans assistance humanitaire représente une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de l’homme».
L’idée que la mondialisation de l’économie doit reposer sur un socle social a pour la première fois été évoquée au Sommet social de 1995, qui a reconnu la pertinence à cet égard des conventions fondamentales de l’OIT, lesquelles font désormais partie intégrante de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1998. L’idée de socle social peut être étendue à la garantie des droits fondamentaux en matière d’éducation, de santé et de protection sociale. En ce qui concerne l’éducation et la santé, le Sommet de Copenhague s’est fixé pour objectifs que, d’ici à 2015, l’enseignement primaire soit universel et le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans inférieur à 45 pour mille et, à sa session extraordinaire de l’an 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a recommandé de «renforcer les modalités d’affiliation aux systèmes de protection sociale … pour répondre aux besoins des personnes exerçant des formes d’emploi souples» mais sans fixer d’objectifs quantitatifs ni de calendrier(20).
Le rôle des différents acteurs que nous venons de mentionner doit se renforcer; des partenariats peuvent aussi se former entre eux en vue de rendre plus efficace la sécurité sociale et d’étendre le champ de la protection sociale.
Moyens de renforcer l’efficacité de la sécurité sociale
L’Etat peut agir sur les régimes de sécurité sociale et les rendre plus efficaces de différentes manières:
- organisation et fourniture de prestations sociales;
- réglementations imposant aux employeurs de servir certaines prestations ou obligeant les compagnies d’assurance ou les fonds de pension privés à respecter certaines normes;
- politique fiscale, notamment abattements fiscaux pour les prestations ou les cotisations de sécurité sociale;
- ratification des conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale et signature d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
L’importance relative accordée à ces différents modes d’intervention influe sur la structure de la sécurité sociale. Il appartient à l’Etat de définir son rôle, ceux du marché et de la collectivité, les mécanismes financiers à mettre en œuvre et l’organisation et la gestion des régimes.
Il est depuis longtemps admis que les partenaires sociaux, notamment les représentants des travailleurs directement intéressés, doivent être associés à la conception et à la gestion des régimes de sécurité sociale. La recommandation (nº 67) sur la garantie des moyens d’existence, 1944, indique que «la gestion des assurances sociales devrait être unifiée ou coordonnée dans un système général de services de sécurité sociale et les cotisants devraient être représentés par l’entremise de leurs organisations aux organes qui arrêtent ou conseillent les lignes générales de la gestion et qui présentent des projets législatifs ou établissent des règlements». La convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, précise: «Lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques». Des prescriptions analogues figurent dans des instruments ultérieurs, par exemple dans la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dans la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et dans la convention (nº 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988.
L’une des raisons de la participation des partenaires sociaux est que les régimes – en tout cas les régimes d’assurance sociale – sont financés entièrement ou essentiellement par les cotisations des employeurs et des travailleurs. Toutefois, même dans le cas des régimes financés par les recettes fiscales et gérés par un ministère, le tripartisme a un rôle important à jouer: il aide en effet à adapter les prestations aux besoins véritables des travailleurs. La participation d’autres parties prenantes peut aussi avoir un effet positif (par exemple, comités consultatifs de patients dans le cas des services publics de santé). La convention no 168 dispose que, quand l’administration de la promotion de l’emploi et de la protection contre le chômage est assurée par un département gouvernemental, «les représentants des personnes protégées et des employeurs doivent … être associés à celle-ci à titre consultatif».
Dans les régimes contributifs de sécurité sociale, les entreprises sont presque toujours investies d’importantes responsabilités en ce qui concerne la déduction et le versement des cotisations. Dans certains pays, la législation du travail les oblige à servir elles-mêmes certaines prestations ou à prendre des dispositions appropriées avec une compagnie d’assurance. Cette formule a très souvent été utilisée par le passé pour la réparation des accidents du travail et pour les prestations de maternité mais, du fait de ses inconvénients, elle a généralement cédé la place à l’assurance sociale. Il n’empêche que, depuis quelques années, il est de plus en plus courant que les employeurs soient tenus de verser des indemnités de maladie durant les premiers jours ou les premières semaines d’absence, les recherches ayant montré que les absences de courte durée pour maladie diminuent beaucoup si les employeurs ont intérêt, financièrement, à prendre des mesures pour améliorer la qualité de la vie des travailleurs et pour surveiller l’absentéisme.
Dans beaucoup de pays, les entreprises doivent assumer des responsabilités dans le domaine de la protection sociale, notamment en ce qui concerne les pensions de retraite et les soins de santé, non pas parce qu’elles y sont obligées par la loi mais parce que les prestations servies par le régime légal sont insuffisantes. En général, l’Etat fait bénéficier ces entreprises (et, dans une moindre mesure, les salariés) d’importants avantages fiscaux. Les travailleurs les moins bien payés, qui occupent les emplois les moins stables, et notamment les femmes, sont ceux qui profitent généralement le moins de ces systèmes. Cette formule entraîne beaucoup plus d’inégalité que la sécurité sociale.
Dans certains pays, l’Etat, par voie législative ou d’une autre manière, a étendu les régimes privés ou professionnels de retraite à l’ensemble des entreprises et travailleurs d’une branche, voire d’un secteur tout entier. Le système qui en résulte se situe entre les régimes obligatoires d’assurance sociale et les régimes privés volontaires et il présente l’avantage d’une large couverture et d’une large autonomie excluant toute intervention directe de l’Etat. Il repose sur des bases financières solides et est obligatoirement cogéré par les employeurs et les représentants des travailleurs, ce qui crée des conditions favorables à son fonctionnement. L’expérience de pays tels que la Finlande, la France ou les Pays-Bas donne à penser que ces caractéristiques allègent grandement la fonction réglementaire de l’Etat. A l’inverse, dans les pays qui font une grande place aux régimes institués individuellement par les entreprises, la réglementation est très détaillée. Elle s’accompagne dans certains cas de mécanismes de garantie des pensions. Cette réglementation est généralement jugée très pesante par les employeurs et il est difficile de la faire respecter.
Certains pays, notamment d’Amérique latine, ont avancé plusieurs raisons pour la privatisation de leurs régimes de pension. Dans quelle mesure la privatisation est-elle une réponse propre à améliorer la gouvernance de la sécurité sociale? Le débat se situe essentiellement à deux niveaux: celui de la structure et celui de la gestion.
Sur le plan structurel, ceux qui sont contre le principe de l’assurance sociale font valoir qu’elle assure aux intéressés une protection excessive et leur enlève toute liberté de choix. Selon eux, l’Etat devrait se contenter de garantir une protection sociale minimale et mettre en place des conditions propres à favoriser les arrangements privés.
En ce qui concerne les aspects administratifs ou institutionnels, ils font valoir que les organismes d’assurance sociale ne se sont soumis à aucune concurrence (il s’agit effectivement de monopoles) et qu’ils ne sont pas tenus de faire des bénéfices. De ce fait, ils n’accordent pas suffisamment d’attention aux conséquences financières des décisions qu’ils sont obligés de prendre. On a souvent postulé que le libre jeu des forces du marché aurait un effet généralement bénéfique. Or l’expérience montre qu’il est beaucoup plus coûteux d’administrer des comptes d’épargne individuels que des dossiers de sécurité sociale, que les sociétés qui gèrent les fonds de pension (par exemple les Administratoras de Fondos de Pensiones dans divers pays d’Amérique latine) ont des frais commerciaux élevés, que la concentration est importante parmi les fonds de pension et qu’on ne peut pas compter sur les sociétés de gestion privées pour faire respecter les règles.
Beaucoup de régimes de sécurité sociale, conscients de la nécessité d’une meilleure gouvernance, ont, soit réformé leurs mécanismes institutionnels afin de parvenir à une plus grande autonomie, soit fait appel au secteur privé pour leur administration. Les régimes publics ont donc tendance à confier à l’extérieur certaines de leurs fonctions et à adopter pour leur gestion différents principes et pratiques du secteur privé afin d’être plus efficaces et transparents.
Vers une protection sociale pour tous
L’approche à adopter pour étendre la protection sociale dépend d’un certain nombre de facteurs et notamment du niveau de développement économique du pays, de l’état du régime de sécurité sociale et de l’importance du secteur informel. Certains pays industriels sont parvenus à une couverture universelle pour certaines éventualités mais pas pour toutes. Dans ces pays, l’extension de la protection sociale peut s’inscrire dans le cadre des systèmes existants. Les pays en développement à revenu intermédiaire pourraient aussi, pour certains risques, parvenir à une couverture universelle dans le cadre des systèmes en place. Dans d’autres cas, il pourrait être nécessaire de commencer par promouvoir des régimes visant spécifiquement les travailleurs de l’économie informelle. Vu la taille réduite du secteur formel dans les pays en développement à bas revenu, il est impératif d’y donner la priorité à des régimes destinés à répondre aux besoins des travailleurs de ce secteur.
Microassurance et systèmes locaux
Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre III, l’accès aux soins de santé est l’une des principales priorités des travailleurs de l’économie informelle, notamment dans les pays à bas revenu. Le succès ou l’échec des systèmes de microassurance dépend des caractéristiques des organismes qui les mettent en place, de la conception de ces systèmes et du contexte dans lequel ils opèrent. Il est indispensable que les participants se fassent confiance. Plusieurs facteurs peuvent y contribuer: une direction forte et stable, une base économique solide, l’existence de mécanismes de participation, des structures financières et administratives fiables. Il faut prévoir des mesures pour lutter contre la fraude et les abus, pour promouvoir une certaine forme de participation obligatoire, pour contenir les coûts, pour favoriser la prévention et l’éducation en matière de santé. Le contexte varie selon qu’il existe des services de santé (publics ou privés), de qualité et abordables ou des conditions favorables au développement de la microassurance.
La plupart des systèmes de microassurance demeurent d’ampleur relativement modeste et il importe donc de déterminer avec quels mécanismes et formes de partenariat on peut étendre leur champ d’application. Une possibilité est que ces systèmes se groupent en organisations afin d’atteindre divers objectifs – par exemple, renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis de l’Etat et des prestataires (publics ou privés) de soins de santé, mettre en commun leurs connaissances, stabiliser leur situation financière par la réassurance. Deuxième possibilité: consacrer plus d’efforts à promouvoir la microassurance. En effet, un fort pourcentage de la population cible est mal informé des avantages qu’elle procure. Il faut aussi renforcer la crédibilité de ces systèmes. Les subventionner est incontestablement un bon moyen d’étendre leur champ d’application mais cela dépend entièrement de la capacité et de la volonté de l’Etat de redistribuer le revenu dans le cadre de la fiscalité.
Parallèlement au développement des systèmes de microassurance, d’autres formes de partenariat peuvent être nécessaires. Ces systèmes peuvent s’associer à des organisations de la société civile (par exemple, coopératives et syndicats) ou simplement chercher à s’assurer leur appui. Ils peuvent aussi faire appel à des entreprises privées ou à des organismes de sécurité sociale déjà dotés d’une administration qui fonctionne efficacement. L’expérience montre que de tels rapprochements supposent des changements dans la culture et l’organisation des parties prenantes ainsi que des changements concernant les liens et les formes de coopération entre organisations.
L’Etat a un rôle capital à jouer dans le renforcement des systèmes de microassurance. Les autorités locales peuvent contribuer à la mise en place de dispositifs locaux de protection sociale – en partenariat avec la société civile (voir chapitre III). Au niveau national, l’Etat peut veiller à ce que les expériences qui ont donné de bons résultats soient étendues à d’autres métiers, secteurs ou zones. En outre, il peut créer un environnement propice au développement des systèmes de microassurance. Par la réglementation, il doit définir la relation entre ces systèmes et les systèmes obligatoires d’assurance sociale afin d’éviter tout effet préjudiciable sur les cotisations et de promouvoir, à plus long terme, des liens plus étroits entre les deux systèmes. Dans le cas de l’assurance maladie, plusieurs fonctions peuvent être distinguées:
i) promouvoir l’assurance maladie par des recommandations concernant les prestations, l’affiliation et l’administration et la mise en place d’un système d’information de gestion;
ii) contrôler et réglementer la microassurance, par exemple dans le contexte d’une législation propre à garantir une administration efficace et transparente;
iii) améliorer et décentraliser les services publics de santé, ce qui est une condition préalable indispensable au développement de la microassurance dans beaucoup de pays;
iv) entreprendre et organiser des formations, notamment sur la base des activités de promotion et de contrôle mentionnées aux alinéas i) et ii);
v) (co)financer l’accès des catégories à bas revenu à l’assurance maladie, le cas échéant par des subventions ou des contributions de contrepartie.
Les syndicats et les employeurs pourraient aussi jouer un rôle majeur, qu’il s’agisse de mettre en place de nouveaux fonds spéciaux au niveau des Etats, régions ou provinces – par exemple, pour les travailleurs du bâtiment – ou d’expérimenter des régimes locaux de protection sociale. Les syndicats veilleraient à ce que les prestations offertes correspondent aux priorités des travailleurs; pour leur part, les organisations patronales pourraient convaincre leurs membres de s’acquitter de leurs obligations en matière de cotisations.
Assurance sociale
Comme on l’a vu au chapitre III, il y a différents moyens de modifier ou réformer les programmes d’assurance sociale en vue d’étendre leur champ d’application. Le rôle de l’Etat, garant de ces programmes, est évidemment capital mais celui des partenaires sociaux est important aussi. Leur action doit viser à ce que tous les travailleurs du secteur formel, y compris les travailleurs occasionnels ou sous contrat, soient protégés. Les partenaires sociaux, notamment les syndicats, pourraient faire pression pour que des mesures soient prises en vue d’assurer une bonne couverture aux travailleurs des petites entreprises. Des activités de formation et de sensibilisation, suivies de consultations et d’un dialogue avec l’Etat, seraient un moyen idéal d’étendre la couverture sociale.
Prestations sociales à base fiscale
Il est généralement préférable que l’aide sociale et les prestations universelles soient principalement financées par l’administration centrale car, en période de crise par exemple, certaines régions et localités ont beaucoup plus de besoins que d’autres. Ce système garantit que les habitants de toutes les régions d’un pays ont accès aux mêmes prestations de base qui, si besoin est, pourront être ajustées en fonction du coût de la vie. Les autorités locales et régionales peuvent y ajouter d’autres prestations, par exemple pour le logement, la nourriture ou le travail. En outre, les autorités locales, en coopération avec des institutions locales, peuvent jouer un rôle important dans la distribution des prestations.
Comme on l’a vu au chapitre I, la demande d’une aide sociale temporaire – souvent financée par la communauté internationale – a augmenté dans différents pays du fait des guerres, des catastrophes, des crises. Toutefois, à long terme aussi, la communauté internationale a promis de contribuer à la réalisation d’objectifs sociaux, et notamment à la réduction de la pauvreté et à la généralisation de l’instruction primaire. Dans ce contexte, des ressources internationales pourraient être utilisées pour financer des prestations destinées aux enfants (notamment pour éviter qu’ils soient astreints à un travail et promouvoir la fréquentation scolaire) ainsi que des prestations d’aide sociale qui, conjointement avec d’autres politiques, contribueraient beaucoup à faire reculer la pauvreté.
Dans ce chapitre, nous avons examiné le rôle des différents acteurs qui concourent à la sécurité du revenu et à la protection sociale, depuis la famille jusqu’à la communauté internationale. L’Etat, les travailleurs et les employeurs sont les partenaires principaux, mais ce partenariat devra s’élargir pour que la sécurité sociale devienne plus efficace et pour que les travailleurs à bas revenu qui occupent un emploi indépendant ou qui travaillent dans le secteur informel bénéficient d’une protection sociale. Il faudrait améliorer les liens entre l’administration centrale et les autorités locales ainsi qu’entre différents ministères (Sécurité sociale, Travail, Santé, Finances, etc.). Un rôle important devra être joué par les autorités locales, par les associations qui représentent directement les travailleurs de l’économie informelle (par exemple, coopératives, mutuelles, services communautaires) et par les organisations intermédiaires qui œuvrent en faveur des salariés à bas revenu. En outre, on pourrait le cas échéant envisager des partenariats avec les institutions financières privées, par exemple dans le cas des régimes d’assurance sociale qui ont besoin d’une aide pour la gestion de leurs placements ou des systèmes de microassurance qui ont besoin de services spécialisés, par exemple en matière de réassurance. Enfin, la communauté internationale devra peut-être assumer de nouveaux rôles en ce qui concerne, par exemple, la définition de politiques sociales globales et le (co)financement de certaines prestations sociales de base.
Activités futures de l’OIT
Nous avons passé en revue dans les chapitres précédents plusieurs problèmes importants dont certains ont trait à l’application même du concept de sécurité sociale tandis que d’autres ont pour effet de limiter son efficacité. Dans beaucoup de pays, les besoins de protection sociale se sont accrus, et nombreux sont ceux qui considèrent que les mécanismes qui sont censés y répondre n’ont pas atteint leurs objectifs. Dans les pays en développement notamment, un grand nombre de gens qui exercent une activité rémunérée n’ont même pas accès à une protection sociale de base et vivent au jour le jour, à la limite de l’indigence. Cependant, il importe de relativiser et, sans occulter les problèmes, de prendre acte du succès que beaucoup de régimes de sécurité sociale ont connu dans toutes les régions du monde en assurant à des millions de personnes sécurité du revenu et accès aux soins de santé. Pour relever le défi de la sécurité sociale, il faut donc se concentrer sur ses faiblesses tout en les distinguant du concept qui, lui, reste valable et conserve toute sa force. Le présent rapport évoque les réformes à mettre en œuvre pour remédier à ces faiblesses.
L’OIT s’est fixé comme but fondamental que chacun, homme ou femme, ait la possibilité d’accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité. La sécurité sociale, qui fait partie des droits de l’homme, est un élément clé. L’un des quatre objectifs stratégiques de l’OIT – étendre à tous la protection sociale et renforcer son efficacité – vise à faire de ce droit une réalité. Par son mandat et sa structure, l’OIT est particulièrement bien armée pour relever ce défi et elle est consciente de la nécessité d’établir un lien entre politique de l’emploi et politique de protection sociale. Les conséquences pour le programme de l’OIT et sa structure, telle qu’elle est envisagée, sont examinées dans ce dernier chapitre.
Pour atteindre son objectif, l’OIT met actuellement en place un programme intégré dont les éléments de base sont les suivants:
- travaux de recherche et d’analyse des politiques;
- établissement d’un cadre normatif;
- coopération technique et autres moyens d’action.
Recherche et analyse des politiques
L’objectif est ici de renforcer les connaissances de l’OIT sur les moyens d’étendre la protection sociale, d’améliorer son efficacité et de la rendre plus équitable. Il faut pour cela étudier les problèmes d’efficacité, de financement et de gouvernance et établir des comparaisons avec les régimes qui ont été réformés avec succès. L’objectif est: i) de mieux comprendre la nature, les causes et les effets des déficiences des régimes; ii) d’élaborer des stratégies pour la mise au point de mécanismes de protection sociale efficaces; iii) d’élaborer un cadre pour les politiques de protection sociale.
i) Analyser les déficiences des régimes sur le plan de leur couverture et de leur efficacité:
- en examinant, d’un point de vue statistique, l’évolution des taux de couverture et des dépenses sociales afin d’évaluer le nombre de personnes exclues de la protection sociale;
- en collectant des données sur l’emploi, les revenus et les dépenses des groupes qui ne bénéficient pas de la sécurité sociale, y compris dans le secteur informel, afin de déterminer les besoins de protection sociale et la capacité contributive des ménages et de la collectivité;
- en identifiant les facteurs d’exclusion;
- en identifiant les facteurs qui limitent l’efficacité des régimes.
Le Secteur de la protection sociale a mis en chantier un programme spécial sur l’extension des régimes de sécurité sociale. Pendant la période biennale en cours, des recherches seront entreprises dans le cadre de ce programme sur les tendances statistiques de la couverture des régimes et des dépenses sociales ainsi que sur l’efficacité des efforts déployés pour étendre la protection sociale. Il pourrait être envisagé de créer un observatoire de la protection sociale afin de surveiller les progrès accomplis dans la mise en œuvre du concept de travail décent.
ii) Identifier et mettre au point des mécanismes de protection sociale efficaces:
- en évaluant l’efficacité des efforts entrepris pour étendre la protection sociale dans le cadre des régimes légaux de sécurité sociale et des régimes de microassurance et pour renforcer les liens entre ces régimes;
- en examinant le rôle des acteurs sociaux afin de déterminer dans quelles conditions ils peuvent œuvrer ensemble à l’extension ou à l’amélioration de la protection sociale;
- en testant différentes formules de protection et différents modes de financement pour évaluer la faisabilité de régimes:
–
destinés à des catégories particulières de la
population active;
–
financés par l’impôt plutôt que par les cotisations sociales;
– visant
à compléter les systèmes de microassurance par le biais,
par exemple, de la réassurance;
–
propres à obtenir un appui financier international dans les pays
les moins avancés;
- en étudiant différentes modalités d’intervention d’urgence pour répondre aux besoins de protection sociale des pays touchés par une crise ou une catastrophe naturelle et les aider par la suite à (re)construire leur système de protection sociale;
- en établissant des liens entre protection sociale et politique de l’emploi, par exemple entre la microassurance et les programmes de développement des micro-entreprises et entre les régimes d’assurance chômage, l’aide sociale et les politiques actives du marché du travail;
- en déterminant comment la protection sociale peut contribuer à l’égalité entre hommes et femmes par le biais de prestations garantissant l’égalité de traitement et réduisant les inégalités, tant sur le marché du travail que dans la division du travail entre les sexes.
iii) Elaborer un cadre qui tienne compte des résultats des recherches et de l’expérience, à l’intention des gouvernements qui souhaitent étendre la couverture sociale et améliorer l’efficacité des systèmes de protection sociale, ce qui pourrait exiger, entre autres, la mise au point de nouvelles stratégies nationales ou internationales de financement des systèmes de transferts sociaux.
En principe, tout un chacun a le droit d’être couvert par un régime de sécurité sociale, et les normes internationales devraient consacrer ce droit et en faciliter la mise en pratique. Cependant, la plupart des normes de l’OIT en matière de sécurité sociale visent les salariés du secteur structuré et ne sont pas véritablement adaptées aux besoins et à la situation des travailleurs indépendants ou de ceux qui travaillent de façon irrégulière en dehors d’une relation classique employeur-salarié. De quelle manière les normes de l’OIT devraient-elles contribuer à étendre la protection à ceux qui en sont actuellement exclus?
Il est impossible de répondre à cette question sans évoquer certaines contradictions, aggravées par la complexité et la variété des relations de travail ainsi que par le désir de nombreux employeurs, et même de certains travailleurs, d’échapper au paiement des cotisations. Le plus grand nombre possible de travailleurs devraient être couverts par des régimes de sécurité sociale fondés sur les principes de solidarité que sont l’affiliation obligatoire et l’égalité de traitement. Toutes les personnes qui doivent être considérées comme des salariés, y compris les travailleurs temporaires ou à temps partiel, devraient être traitées comme telles du point de vue de leur protection sociale, et leur employeur devrait être tenu d’assumer les obligations correspondantes.
Toutefois, cela est plus facile à dire qu’à faire, et la difficulté s’accroît à mesure que le travailleur s’éloigne de la définition classique du «salarié». Pour les travailleurs indépendants et ceux pour qui la relation d’emploi est extrêmement ténue, une approche différente pourrait se justifier. Le travailleur indépendant qui a un domicile professionnel pourrait être progressivement assujetti au même régime de sécurité sociale que les salariés, ou peut-être bénéficier d’un régime distinct fondé sur des principes semblables. Ceux qui travaillent à leur compte à un niveau inférieur seront peut-être mieux protégés par des régimes spéciaux, variables en fonction de la situation budgétaire et économique et de leur capacité contributive mais offrant une protection plus élémentaire. On pourrait donc envisager l’élaboration de normes visant à promouvoir l’extension de la protection sociale sur cette base. Ces normes pourraient réaffirmer le droit à la sécurité sociale tel qu’énoncé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, inviter les gouvernements et les partenaires sociaux à s’engager à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies d’extension de la protection sociale de base, et prévoir des indicateurs statistiques permettant de mesurer les progrès accomplis vers la couverture universelle. Elles pourraient en outre recommander des principes directeurs pour la conception, la gestion et l’administration des régimes de protection sociale et pour l’élaboration de politiques et de stratégies nationales et internationales.
Instituer différents niveaux de protection selon les catégories de travailleurs est une tâche délicate, tant sur le plan des principes que sous l’angle de la gestion des régimes. Il est indispensable de définir les catégories de façon aussi précise que possible, faute de quoi les employeurs ou les travailleurs pourront choisir le régime et le taux de cotisation qu’ils voudront, ce qui minera la solidarité et pourrait aboutir à une dégradation généralisée de la protection des personnes déjà couvertes.
On pourrait aussi envisager d’élaborer de nouvelles normes concernant l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Comme cela a été souligné au chapitre IV, les femmes sont très nombreuses à occuper des emplois à temps partiel, peu rémunérés, intermittents et précaires, qui souvent sont exclus du bénéfice de la sécurité sociale. La plupart assument aussi la plus grande part des responsabilités parentales et, par conséquent, disposent de moins de temps pour constituer leurs droits en matière de sécurité sociale. En outre, dans la plupart des sociétés, les femmes partent plus tôt à la retraite parce que la loi les y oblige et risquent ainsi d’avoir plus de mal à remplir les conditions requises pour bénéficier de prestations pleines. Les hommes, pour leur part, subissent aussi une inégalité de traitement car, dans beaucoup de pays, les pensions de réversion sont octroyées seulement aux veuves. Les sujets qui pourraient faire l’objet de nouvelles normes sont notamment les suivants: l’égalité de traitement pour ce qui est du droit aux prestations de vieillesse; l’égalité de traitement pour ce qui est des pensions de réversion; la division des droits à pension en cas de divorce; le calcul des prestations ou l’accès à des prestations pour les parents ayant des responsabilités familiales.
De toutes les branches de la sécurité sociale couvertes par la convention no 102, seules les prestations et allocations familiales ne font pas l’objet d’une norme particulière de l’OIT. Vu leur utilité pour combattre le travail des enfants et la pauvreté et pour promouvoir l’égalité entre les sexes, on pourrait envisager qu’elles fassent l’objet de futures activités normatives.
L’évolution de la situation sociale et démographique depuis l’adoption en 1952 de la convention no 102 a engendré de nouvelles dispositions en matière de sécurité sociale, en particulier:
- les prestations parentales, destinées à remplacer les revenus des parents qui prennent un congé pour s’occuper d’un enfant en bas âge ou malade, question brièvement abordée au paragraphe 10.3 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000;
- l’assurance dépendance, qui couvre les dépenses importantes liées à la perte d’autonomie et à l’incapacité d’effectuer les tâches de la vie courante.
Ces questions pourraient aussi donner lieu à des activités normatives.
Qu’il s’agisse de ces questions ou d’autres, il convient de garder à l’esprit que l’activité normative peut prendre différentes formes: élaboration d’une nouvelle norme, révision d’une norme existante, addition d’un protocole. On notera que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a décidé que sept conventions de sécurité sociale sont officiellement à jour et a demandé aux Etats Membres d’informer le Bureau des obstacles et difficultés qui pourraient empêcher ou retarder leur ratification et, le cas échéant, de la nécessité de réviser ces conventions. A ces sept conventions il convient d’ajouter la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.
Vu la complexité croissante, et l’interdépendance, des facteurs à prendre en compte pour promouvoir des régimes de sécurité sociale qui permettent d’atteindre l’objectif mentionné au début de ce chapitre, il serait malavisé d’engager telle ou telle forme d’action normative au cas par cas, sans avoir une idée claire de la direction générale de cette action. La discussion à laquelle donnera lieu le présent rapport fournira sans nul doute d’utiles indications à ce sujet mais une action beaucoup plus spécifique est nécessaire car le sujet est très complexe et technique. Les normes de sécurité sociale sembleraient parfaitement se prêter à l’application de la nouvelle approche intégrée de l’action normative que le Conseil d’administration a approuvée à titre expérimental à sa 279e session (novembre 2000)(21). La première étape consiste à faire l’inventaire des normes et des activités normatives dans le domaine considéré. Les résultats de cette analyse approfondie doivent ensuite faire l’objet d’une discussion tripartite lors de la Conférence internationale du Travail en vue de l’élaboration, pour le domaine en question, d’un plan d’action intégré. Ce plan doit indiquer les sujets qui pourraient se prêter à une action normative, préciser l’objectif et la forme de nouvelles normes ou de normes révisées, fournir une orientation pour la promotion des normes existantes et mettre en lumière les domaines dans lesquels des activités de coopération techniques seraient pertinentes. La discussion pourrait aussi mettre à jour des questions qui, de par leur nature technique ou pour d’autres raisons, peuvent difficilement faire l’objet d’une convention ou d’une recommandation et doivent plutôt être abordées dans des recueils de directives pratiques ou des manuels, par exemple. Au cours d’une troisième étape, le Conseil d’administration tirera les conclusions qui s’imposent de la discussion tenue par la Conférence, dans le cadre de ses procédures ordinaires, y compris le choix des questions à inscrire à l’ordre du jour de la Conférence pour l’adoption ou la révision de normes.
Etant donné l’importance du sujet examiné, la présente discussion pourrait être considérée comme un premier échange de vues sur les questions, défis et perspectives en matière de sécurité sociale, échange propre à permettre de préciser les activités futures de l’OIT dans ce domaine. A partir des résultats de cette discussion, et pour autant que la Conférence le juge approprié, le Bureau pourrait entreprendre un examen approfondi des activités normatives de l’OIT dans le domaine de la sécurité sociale, conformément à l’approche intégrée(22). Le Conseil d’administration pourrait examiner le calendrier de ce processus à la lumière des commentaires formulées par la Conférence.
Coopération technique et autres moyens d’action
Le Bureau international du Travail, par le truchement du Secteur de la protection sociale ou des spécialistes de la sécurité sociale qui font partie des équipes multidisciplinaires, fournit des services consultatifs techniques et exécute des programmes de coopération technique pour répondre aux demandes des Etats Membres. L’un des principaux objectifs du programme de sécurité sociale de l’OIT est de renforcer la capacité des gouvernements, des régimes de sécurité sociale, des partenaires sociaux et, le cas échéant, des ONG, d’assurer la viabilité à long terme des réformes et, dans la plupart des projets de coopération technique, un rang de priorité élevé est accordé à la formation. La politique de protection sociale doit s’appuyer sur des analyses financières, budgétaires et économiques solides, et le BIT continuera de fournir aux mandants des services d’actuariat et des analyses de budgets sociaux. En outre, le programme QUA Train contribuera à la formation de spécialistes du financement.
Des demandes de plus en plus nombreuses d’assistance technique sont adressées au BIT par des pays qui souhaitent étendre la protection sociale, soit à des catégories de la population active qui ne sont pas encore couvertes, soit à des risques jusqu’ici non protégés. A l’évidence, pour ce qui est de l’extension des régimes existants de sécurité sociale à un plus grand nombre de personnes et de risques, la marge de manœuvre est grande, mais souvent une assistance technique préalable est nécessaire pour remédier aux carences de l’administration et de la législation et mettre en place les moyens dont les institutions ont besoin pour pouvoir assumer de nouvelles responsabilités. Cela peut exiger une analyse approfondie de la structure financière du régime, qui peut être effectuée dans un contexte macroéconomique par le biais d’une analyse du budget social.
Deuxième domaine d’action: l’aide fournie aux gouvernements et aux acteurs sociaux pour l’élaboration d’une politique globale de protection sociale. Dans le domaine de l’assurance sociale obligatoire, le BIT apporte son assistance technique pour l’élaboration de politiques, la préparation de projets de lois, la mise en place de régimes d’assurance couvrant la maladie, la vieillesse, l’invalidité, le décès, les accidents du travail, la maternité et les prestations familiales. La plus haute priorité est accordée à l’extension de la protection sociale à des groupes jusqu’ici non protégés. Le BIT aide aussi à la mise en place et à l’administration de régimes d’aide sociale d’un coût abordable pour les pays à faible revenu et compatibles avec les autres mesures de lutte contre la pauvreté.
Dans certains pays, le BIT – et en particulier son programme STEP – a surtout fait porter ses efforts sur l’assurance maladie, qui est un des principaux besoins des travailleurs du secteur informel. Le BIT fournit une assistance pour la réalisation d’études de faisabilité, afin d’évaluer comment et dans quelles conditions des activités pilotes pourraient être exécutées et reprises ailleurs avec succès. Il élabore à l’intention des différents acteurs sociaux des outils et un matériel de formation à vocation pratique pour les aider à arrêter leur politique et à concevoir des activités dans le domaine de la microassurance, et il fournit également des services de réseaux aux groupes sociaux qui participent à la microassurance.
L’adoption de mesures en faveur des personnes qui ne sont pas encore protégées nécessitera probablement l’établissement de manuels pratiques et une large diffusion d’informations. Les normes de l’OIT doivent servir de cadre à la coopération technique, et des travaux de recherche devront être menés sur les synergies possibles entre normes, assistance technique, réunions et activités des structures extérieures à l’appui de la réalisation des objectifs de l’Organisation.
Points suggérés pour la discussion
- Quelles sont les répercussions de l’évolution du contexte mondial sur la capacité des Etats Membres de préserver le dispositif existant de sécurité sociale ou de l’étendre?
- Dans la plupart des pays, seule une minorité de la population bénéficie d’une sécurité sociale adéquate. Pourquoi cette situation se perpétue-t-elle? Que peuvent faire les gouvernements et les partenaires sociaux des Etats Membres de l’OIT pour que le droit à la sécurité devienne une réalité pour tous ? Comment prendre en compte les contraintes économiques et les niveaux de développement dans les stratégies visant cet objectif?
- Quelle priorité accorder à l’extension de la sécurité sociale au profit des travailleurs des petits établissements, des travailleurs indépendants, des migrants et de l’économie informelle ? Quels sont les instruments et politiques qui ont le plus de chance d’être efficaces pour ces catégories ? Quel pourrait être le rôle de la microassurance?
- Comment des systèmes de sécurité sociale solides peuvent-ils favoriser la flexibilité et le dynamisme du marché du travail et contribuer à une amélioration de la productivité des entreprises et de l’économie?
- Quel est le meilleur moyen d’assurer la sécurité du revenu des chômeurs à différents niveaux de développement et d’industrialisation? Comment combiner au mieux les mesures prises à cet effet et les mesures visant à faciliter l’accès au marché du travail et la réinsertion dans la vie active?
- Comment les politiques de protection sociale peuvent-elles favoriser l’égalité entre hommes et femmes? Suffit-il de garantir l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans les régimes de sécurité sociale? Quelles sont les réformes récentes qui ont le plus contribué à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes?
- La sécurité sociale est-elle confrontée à une crise du fait du vieillissement? Peut-on l’éviter en modifiant le système de financement des pensions? Ou bien est-il nécessaire de stabiliser le rapport actifs/inactifs par un accroissement des taux d’activité, notamment des travailleurs âgés et des femmes?
- Quels sont les avantages et inconvénients des différentes méthodes de financement de la sécurité sociale vu que la capacité de cotiser à des régimes d’assurance sociale varie? Les cotisations versées par les employeurs à la sécurité sociale ont-elles un effet sur les coûts de main-d’œuvre et sur l’emploi? Les dispositifs privés peuvent-ils rendre moins lourd le financement de la sécurité sociale sans nuire à la solidarité et à l’universalité?
- Comment l’élargissement du dialogue social, à l’échelon national et à l’échelon international, peut-il contribuer à l’extension et à l’amélioration de la sécurité sociale? Quel pourrait être le rôle des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs dans ce contexte?
- Comment promouvoir au mieux des synergies entre la sécurité sociale et d’autres aspects du travail décent?
- Quelles devraient être les priorités à long terme des recherches, de l’activité normative et de l’assistance technique de l’OIT dans le domaine de la sécurité sociale?
- Comment la nouvelle approche intégrée de l’activité normative, que le Conseil d’administration a approuvée en novembre 2000, devrait-elle s’appliquer dans le domaine de la sécurité sociale?
Dépenses publiques de sécurité
sociale
|
Dépenses totales |
Pensions |
Soins de santé |
Dépenses totales |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
Pays |
1985 |
1990 |
1996 |
185 |
1990 |
1996 |
1985 |
1990 |
1996 |
1990 |
1996 |
Total mondial* |
|
14,5 |
|
|
6,6 |
|
|
4,9 |
|
|
|
Afrique |
|
4,3 |
|
|
1,4 |
|
|
1,7 |
|
|
|
Asie |
|
6,4 |
|
|
3,0 |
|
|
2,7 |
|
|
|
Europe |
|
24,8 |
|
|
12,1 |
|
|
6,3 |
|
|
|
Amérique latine et Caraïbes |
|
8,8 |
|
|
2,1 |
|
|
2,8 |
|
|
|
Amérique du Nord |
|
16,6 |
|
|
7,1 |
|
|
7,5 |
|
|
|
Océanie |
|
16,1 |
|
|
4,9 |
|
|
5,6 |
|
|
|
Afrique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algérie 4 |
… |
7,6 |
... |
... |
3,3 |
... |
... |
3,4 |
... |
... |
... |
Bénin |
0,7 |
1,3 |
2,2 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
... |
0,5 |
1,7 |
... |
... |
Botswana 3, 6 |
4,0 |
2,5 |
2,7 |
... |
... |
... |
2,9 |
2,3 |
2,3 |
6,9 |
7,4 |
Burundi |
… |
1,8 |
2,2 |
0,1 |
0,2 |
... |
... |
0,8 |
0,8 |
... |
10,0 |
Cameroun 7 |
1,7 |
2,2 |
... |
0,4 |
0,2 |
... |
0,7 |
0,9 |
1,0 |
10,7 |
... |
Cap-Vert |
… |
5,0 |
... |
... |
0,2 |
... |
... |
3,6 |
... |
... |
... |
République centrafricaine |
… |
1,9 |
... |
... |
0,3 |
... |
... |
1,0 |
... |
... |
... |
Congo 3 |
… |
2,2 |
4,2 |
0,7 |
0,9 |
... |
... |
1,5 |
3,2 |
... |
... |
Egypte 2, 7 |
4,8 |
4,8 |
5,4 |
2,3 |
... |
... |
1,1 |
0,9 |
0,9 |
15,7 |
15,8 |
Ethiopie 7 |
3,4 |
3,2 |
3,7 |
1,1 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
11,1 |
14,9 |
Ghana |
… |
2,2 |
3,1 |
... |
0,0 |
1,1 |
... |
1,3 |
1,0 |
... |
18,9 |
Guinée |
… |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
1,2 |
1,2 |
... |
... |
Kenya |
… |
2,6 |
2,0 |
... |
0,4 |
0,3 |
... |
1,7 |
1,7 |
... |
7,5 |
Madagascar |
2,2 |
1,6 |
1,3 |
0,5 |
0,2 |
... |
... |
1,1 |
1,1 |
... |
... |
Mali |
1,6 |
3,1 |
... |
1,0 |
0,4 |
... |
... |
1,6 |
1,2 |
... |
... |
Maroc 2 |
1,7 |
2,4 |
3,4 |
1,6 |
0,5 |
... |
... |
0,9 |
1,0 |
8,4 |
10,1 |
Maurice |
3,4 |
4,8 |
6,0 |
3,2 |
3,2 |
1,8 |
... |
1,9 |
1,9 |
21,6 |
26,5 |
Mauritanie |
… |
1,0 |
0,8 |
... |
0,2 |
0,2 |
... |
... |
... |
... |
... |
Mozambique |
… |
... |
4,7 |
0,1 |
... |
0,0 |
... |
4,4 |
4,6 |
... |
... |
Namibie |
… |
... |
3,9 |
... |
... |
... |
... |
3,3 |
3,7 |
... |
... |
Niger |
… |
1,9 |
... |
... |
0,1 |
... |
... |
1,5 |
... |
... |
... |
Nigéria |
… |
1,0 |
... |
... |
0,0 |
... |
... |
1,0 |
... |
... |
... |
Sénégal 4 |
… |
4,3 |
... |
1,2 |
1,0 |
... |
... |
2,8 |
2,5 |
... |
... |
Seychelles |
… |
... |
11,6 |
... |
... |
... |
... |
3,5 |
4,1 |
... |
22,4 |
Togo |
1,2 |
... |
2,8 |
0,9 |
... |
0,6 |
... |
1,3 |
1,2 |
... |
... |
Tunisie |
6,0 |
7,0 |
7,7 |
3,6 |
2,3 |
... |
... |
2,1 |
2,2 |
20,3 |
23,6 |
Zambie |
0,8 |
... |
2,5 |
0,4 |
... |
... |
... |
... |
2,2 |
... |
... |
Asie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azerbaïdjan |
… |
9,5 |
8,4 |
... |
2,7 |
... |
... |
2,9 |
1,6 |
... |
40,8 |
Bahreïn 2 |
… |
3,4 |
4,2 |
0,2 |
0,6 |
... |
... |
2,6 |
2,9 |
10,0 |
13,7 |
Bangladesh |
… |
... |
... |
0,0 |
0,0 |
... |
... |
... |
1,2 |
... |
... |
Chine 2 |
… |
5,2 |
3,6 |
... |
2,6 |
1,5 |
... |
1,4 |
2,1 |
... |
23,9 |
Chypre 7 |
8,0 |
8,1 |
10,3 |
4,7 |
4,5 |
6,4 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
24,7 |
30,2 |
Corée, Rép. de |
… |
4,1 |
5,6 |
... |
0,9 |
1,4 |
... |
1,7 |
2,1 |
22,3 |
21,2 |
Inde |
… |
1,7 |
2,6 |
... |
... |
... |
... |
0,9 |
0,9 |
... |
24,7 |
Indonésie |
… |
... |
1,7 |
... |
... |
0,0 |
... |
0,6 |
0,6 |
... |
9,8 |
Iran, Rép. islamique d’ |
… |
4,7 |
6,1 |
... |
0,5 |
... |
... |
2,1 |
2,1 |
21,5 |
18,7 |
Israël |
15,2 |
14,2 |
24,1 |
... |
5,9 |
5,9 |
3,6 |
2,7 |
7,6 |
27,5 |
47,4 |
Japon 2 |
11,4 |
11,3 |
14,1 |
5,2 |
5,5 |
6,8 |
4,7 |
4,6 |
5,6 |
35,8 |
37,4 |
Jordanie |
… |
6,8 |
8,9 |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
... |
1,7 |
2,9 |
... |
... |
Kazakhstan 1 |
… |
... |
13,6 |
... |
... |
... |
... |
... |
3,3 |
... |
50,9 |
Koweït |
… |
9,4 |
9,6 |
1,5 |
3,5 |
... |
... |
3,5 |
2,7 |
20,7 |
23,2 |
Malaisie |
2,0 |
2,7 |
2,9 |
1,9 |
1,0 |
... |
... |
1,5 |
1,4 |
8,9 |
13,4 |
Mongolie 3 |
… |
... |
8,8 |
... |
... |
... |
... |
... |
4,1 |
... |
26,4 |
Myanmar |
… |
... |
0,7 |
0,0 |
... |
... |
... |
1,1 |
0,5 |
... |
6,1 |
Pakistan |
1,1 |
... |
... |
0,3 |
... |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
... |
... |
Philippines |
… |
1,7 |
... |
... |
0,5 |
... |
0,8 |
0,8 |
1,3 |
... |
... |
Singapour |
… |
... |
3,3 |
... |
... |
1,4 |
... |
1,8 |
1,3 |
... |
... |
Sri Lanka |
2,5 |
... |
4,7 |
2,4 |
... |
2,4 |
... |
1,6 |
1,5 |
... |
... |
Thaïlande |
… |
1,5 |
1,9 |
... |
... |
... |
... |
1,0 |
1,3 |
10,1 |
11,9 |
Turquie 2 |
3,9 |
5,9 |
7,1 |
1,9 |
3,3 |
3,8 |
1,1 |
1,0 |
2,3 |
... |
27,0 |
Europe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Albanie 2 |
… |
... |
10,9 |
... |
... |
5,7 |
... |
... |
2,4 |
... |
35,0 |
Allemagne |
26,3 |
25,5 |
29,7 |
11,1 |
10,3 |
12,4 |
7,2 |
6,7 |
8,3 |
54,3 |
52,1 |
Autriche 2 |
24,4 |
24,2 |
26,2 |
14,0 |
13,9 |
14,9 |
5,1 |
5,3 |
5,8 |
49,1 |
49,4 |
Bélarus |
… |
15,1 |
17,4 |
... |
5,5 |
8,8 |
... |
2,6 |
5,0 |
... |
50,0 |
Belgique 2 |
27,5 |
25,6 |
27,1 |
12,3 |
11,2 |
12,0 |
6,0 |
6,7 |
6,9 |
47,4 |
50,1 |
Bulgarie |
… |
16,5 |
13,2 |
... |
8,7 |
7,1 |
... |
3,7 |
3,3 |
25,3 |
24,3 |
Croatie |
… |
... |
22,3 |
... |
... |
8,2 |
... |
... |
7,2 |
... |
47,8 |
Danemark |
25,9 |
28,7 |
33,0 |
7,5 |
8,2 |
9,6 |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
47,9 |
52,5 |
Espagne |
18,5 |
19,6 |
22,0 |
9,2 |
9,4 |
10,9 |
4,6 |
5,4 |
5,8 |
45,8 |
56,7 |
Estonie 5 |
… |
13,1 |
17,1 |
... |
5,3 |
7,6 |
... |
2,8 |
5,8 |
40,3 |
50,6 |
Finlande |
23,4 |
25,2 |
32,3 |
10,3 |
10,6 |
13,2 |
5,7 |
6,5 |
5,4 |
53,8 |
53,8 |
France 2 |
27,0 |
26,7 |
30,1 |
12,0 |
12,2 |
13,3 |
6,5 |
6,6 |
8,0 |
53,4 |
55,3 |
Grèce 2 |
19,5 |
19,8 |
22,7 |
11,6 |
12,7 |
11,7 |
3,3 |
3,5 |
4,5 |
57,8 |
67,4 |
Hongrie |
… |
18,4 |
22,3 |
... |
10,5 |
9,3 |
4,1 |
5,9 |
5,4 |
35,4 |
35,8 |
Irlande |
22,9 |
19,2 |
17,8 |
6,6 |
5,9 |
5,1 |
6,6 |
5,9 |
5,1 |
47,0 |
50,2 |
Islande |
7,3 |
15,7 |
18,6 |
3,5 |
2,8 |
5,7 |
3,6 |
7,7 |
7,5 |
38,2 |
47,0 |
Italie 2 |
21,6 |
23,1 |
23,7 |
12,5 |
13,5 |
15,0 |
5,5 |
6,3 |
5,4 |
42,9 |
45,5 |
Lettonie |
… |
... |
19,2 |
... |
6,1 |
... |
... |
... |
4,0 |
... |
45,5 |
Lituanie |
… |
... |
14,7 |
... |
... |
7,3 |
... |
... |
4,0 |
... |
42,5 |
Luxembourg 2 |
24,0 |
23,4 |
25,2 |
13,0 |
11,9 |
12,6 |
5,5 |
6,1 |
6,5 |
48,4 |
51,4 |
Malte |
19,0 |
13,3 |
20,6 |
14,4 |
... |
... |
3,5 |
... |
4,2 |
... |
48,6 |
Moldavie, Rép. de |
... |
... |
15,5 |
... |
... |
7,4 |
... |
... |
6,3 |
... |
... |
Norvège 2 |
20,0 |
27,1 |
28,5 |
7,3 |
9,1 |
8,9 |
5,7 |
6,7 |
7,0 |
52,7 |
57,7 |
Pays-Bas |
28,9 |
29,7 |
26,7 |
12,2 |
13,6 |
11,4 |
5,9 |
6,1 |
6,8 |
51,6 |
51,4 |
Pologne |
17,0 |
18,7 |
25,1 |
... |
8,5 |
14,3 |
4,5 |
5,0 |
5,2 |
... |
52,1 |
Portugal |
13,2 |
14,6 |
19,0 |
6,4 |
7,4 |
9,9 |
3,9 |
4,3 |
5,0 |
34,9 |
... |
Roumanie |
… |
... |
12,4 |
... |
... |
6,8 |
... |
... |
2,9 |
... |
34,7 |
Royaume-Uni 2 |
21,1 |
19,6 |
22,8 |
8,3 |
8,9 |
10,2 |
4,9 |
5,2 |
5,7 |
46,4 |
54,9 |
Russie, Fédération de 2 |
… |
... |
10,4 |
... |
... |
... |
... |
... |
2,7 |
... |
26,9 |
Slovaquie |
… |
15,9 |
20,9 |
... |
7,8 |
8,3 |
... |
5,7 |
6,0 |
... |
... |
Suède |
31,1 |
32,2 |
34,7 |
10,1 |
10,3 |
13,8 |
8,1 |
7,9 |
6,1 |
53,0 |
50,0 |
Suisse 2 |
17,4 |
20,1 |
25,9 |
9,4 |
10,1 |
12,8 |
4,8 |
5,3 |
6,6 |
44,2 |
49,3 |
République tchèque |
… |
16,0 |
18,8 |
... |
7,3 |
8,1 |
... |
4,6 |
6,8 |
... |
38,6 |
Ukraine |
… |
... |
19,8 |
... |
... |
9,6 |
... |
... |
4,1 |
... |
... |
Amérique
latine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Argentine 6 |
6,6 |
9,8 |
12,4 |
... |
3,6 |
4,1 |
1,1 |
4,4 |
4,3 |
35,8 |
41,2 |
Bahamas |
5,8 |
4,2 |
... |
1,1 |
1,0 |
... |
3,3 |
2,7 |
2,5 |
23,7 |
... |
Barbade |
… |
8,6 |
10,0 |
4,0 |
3,4 |
4,1 |
... |
3,1 |
4,4 |
... |
... |
Belize |
… |
3,1 |
3,5 |
0,3 |
0,3 |
... |
... |
2,3 |
2,1 |
8,7 |
14,2 |
Bolivie |
… |
4,2 |
7,0 |
... |
2,0 |
... |
... |
1,1 |
2,3 |
23,8 |
29,3 |
Brésil 3 |
7,6 |
10,8 |
12,2 |
... |
... |
2,4 |
1,6 |
2,3 |
2,1 |
32,0 |
36,7 |
Chili |
13,5 |
16,2 |
11,3 |
... |
6,0 |
5,9 |
1,6 |
2,0 |
2,3 |
... |
45,6 |
Colombie 2 |
4,8 |
... |
6,1 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
1,8 |
... |
5,1 |
... |
... |
Costa Rica |
7,4 |
10,3 |
13,0 |
2,0 |
... |
... |
4,1 |
6,7 |
6,8 |
40,1 |
42,6 |
Cuba |
12,5 |
15,2 |
... |
6,7 |
7,0 |
... |
4,8 |
5,6 |
... |
... |
... |
République dominicaine 6 |
2,0 |
2,1 |
2,5 |
... |
... |
... |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
18,3 |
15,7 |
Dominique |
1,4 |
2,2 |
4,8 |
0,7 |
0,8 |
1,4 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
... |
... |
El Salvador |
1,3 |
1,9 |
3,6 |
0,5 |
0,7 |
1,3 |
0,6 |
0,8 |
1,3 |
... |
... |
Equateur |
2,8 |
2,1 |
2,0 |
1,8 |
1,1 |
1,2 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
... |
... |
Grenade |
… |
6,9 |
... |
1,8 |
2,6 |
... |
... |
3,7 |
2,8 |
... |
... |
Guatemala |
… |
2,4 |
... |
... |
0,3 |
... |
... |
1,5 |
1,7 |
... |
... |
Guyana |
|
4,5 |
5,8 |
1,1 |
0,6 |
0,9 |
... |
3,4 |
4,3 |
... |
... |
Jamaïque |
… |
4,0 |
4,5 |
... |
0,6 |
0,3 |
... |
2,9 |
2,5 |
... |
... |
Mexique |
3,4 |
2,8 |
3,7 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
2,9 |
2,1 |
2,8 |
23,7 |
22,6 |
Nicaragua 3 |
… |
7,8 |
9,1 |
... |
... |
1,4 |
... |
4,8 |
4,3 |
21,6 |
28,1 |
Panama |
8,0 |
... |
11,3 |
4,0 |
... |
4,3 |
3,5 |
... |
5,6 |
... |
41,3 |
Pérou |
… |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
1,2 |
2,2 |
... |
... |
Trinité-et-Tobago 2 |
... |
... |
6,6 |
... |
... |
0,6 |
... |
2,7 |
2,5 |
... |
22,7 |
Uruguay |
… |
14,2 |
22,4 |
... |
... |
8,7 |
... |
1,2 |
2,0 |
54,7 |
67,8 |
Amérique du Nord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Canada 2 |
16,4 |
17,6 |
17,7 |
4,2 |
4,8 |
5,4 |
6,1 |
6,7 |
6,6 |
36,9 |
40,1 |
Etats-Unis |
13,4 |
14,1 |
16,5 |
6,8 |
6,6 |
7,2 |
4,4 |
5,6 |
7,6 |
40,6 |
48,8 |
Océanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Australie 2 |
14,0 |
14,5 |
15,7 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
38,7 |
41,5 |
Fidji |
… |
6,1 |
... |
... |
4,0 |
... |
... |
2,0 |
... |
... |
... |
Nouvelle-Zélande |
17,6 |
22,2 |
19,2 |
7,9 |
8,2 |
6,5 |
4,4 |
5,8 |
5,4 |
... |
... |
Notes: Les dépenses totales
de sécurité sociale comprennent les dépenses relatives
aux pensions, aux soins de santé, aux accidents du travail et maladies
professionnelles, à la maladie, aux prestations familiales, au logement
et à l’aide sociale, en espèces et en nature, y compris les dépenses
d’administration. Les dépenses relatives aux pensions concernent les
pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Les dépenses
relatives aux soins de santé se rapportent aux dépenses des services
de soins de santé. |
|||||||||||
1 Document GB.274/3, Conseil d’administration, 274e session, Genève, 1999.
2 Pour un examen plus détaillé de ces questions ainsi que d’autres, voir BIT: Rapport sur le travail dans le monde 2000. Sécurité du revenu et protection sociale dans un monde en mutation (Genève, 2000).
3 BIT: Un travail décent, rapport du Directeur général, Conférence internationale du Travail, 87e session, Genève, 1999, p. 3.
4 Voir convention (nº 158) sur le licenciement, 1982 (brève étude), document GB.279/LILS/WP/PRS/1/3 (Genève, BIT, 2000).
5 Le faible accroissement de la productivité enregistré au cours de la période s’expliquerait en Suède, et peut-être dans d’autres pays de l’OCDE, par la très forte expansion des services, notamment des services à forte intensité de travail dans le secteur de la santé et des services aux personnes (le phénomène ne se vérifierait pas en d’autres termes dans les grands secteurs traditionnels).
6 Voir Rapport sur le travail dans le monde 2000. Sécurité du revenu et protection sociale dans un monde en mutation (Genève, BIT, 2000), p. 73 et S. J. Nickell, 1997: «Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America», Journal of Economic Perspectives (Minneapolis, Minnesotas) vol. 11, no 3, pp. 55-74.
7 J. Gruber: The incidence of payroll taxation: Evidence from Chile. Working paper No. W-5053 (Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research, 1995).
8 Voir, par exemple, A.B. Atkinson et J. Micklewright: «Unemployment compensation and labor market transitions: A critical review», Journal of Economic Literature (Nashville, Tennessee), vol. 29, no 40, 1991, pp. 1679-1727.
9 Rapport sur le travail dans le monde 2000, op. cit., p. 163.
10 Nickell, op. cit.
11 Rapport sur le travail dans le monde 2000, op. cit., p. 157.
12 BIT: Kenya: Meeting the employment challenges of the 21st century (Addis Abeba, Equipe consultative multidisciplinaire pour l’Afrique orientale, 1999).
13 Rapport sur le travail dans le monde 2000, op. cit., annexe statistique, tableau 7.
14 Elaine Fultz et Bodhi Pieris: Social security schemes in Southern Africa: an overview and proposals for future development, document no 11 de l’Equipe consultative multidisciplinaire du BIT pour l’Afrique australe (SAMAT), 11 décembre 1999, p. 28.
15 Voir l’annexe statistique pour des données plus détaillées.
16 R2 atteint 0,2858 seulement, un chiffre qui ne suffit pas, en principe, à conclure à l’existence d’une corrélation mesurable.
17 Voir Rapport sur le travail dans le monde, 2000, op. cit., p. 73.
18 Il s’agit bien évidemment d’une hypothèse, et l’on pose aussi que le degré de répartition de la consommation n’est pas lié à la proportion, parmi les dépendants, des mineurs et des retraités.
19 Il convient de souligner à cet égard qu’en application de la convention no 102 tout membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations et doit notamment s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et, en tout cas, préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
20 Nations Unies: Rapport du Comité plénier spécial de la vingt-quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale, A/S-24/8/Rev.1 (New York, 2000).
21 Pour plus de précisions, voir le document GB.279/4.
22 Il convient de rappeler qu’à sa 282e session (novembre 2001), le Conseil d’administration examinera la question du suivi des consultations relatives aux instruments sur la sécurité sociale, conformément aux décisions qu’il a adoptées sur recommandation du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail. Voir le document GB.279/11/2, annexe I, paragr. 54.
Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 29 mai 2001.